
FED, SYSTÈME BANCAIRE ET MARCHÉS FINANCIERS
- Au cœur de la crise -


LA RÉSERVE FÉDÉRALE AMÉRICAINE :
Le hasard fait bien les choses
SYSTÈME BANCAIRE ET MARCHÉS FINANCIERS :
Après le plongeon de 1929 La dérive commence
Les banques créent de la monnaie Liquidité et solvabilité Bilan Effet de levier
Glissade vers l'anarchie financière
Instruments spéculatifs Inefficacité des contrôles Opacité des marchés
Plan organisé ? Que faire ?
LA CRISE DE 2007-2013 :
Réformer les retraites Endettement
La dette publique, source d'enrichissement des banques privées
Dollar Le système monétaire international est-il en crise ?
Taux d'intérêts Interventions de la Fed Inflation Croissance ou récession
La bourse L'or et ses équivalents modernes Le pétrole
Hedge funds Private equity funds
Cross-border leasing Emprunts structurés Stupid German money
Oubliez tous les critères Crise passagère ou systémique ? L'affaire Eliot Spitzer
Chronologie de la crise : 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (page II)
ATS, HFT & Flash ou Goldman Sachs et l'arnaque informatisée Quote stuffing
Intérêts notionnels et paradis fiscal - une histoire belge peu connue
Europe, UE, zone euro (carte)
Bas de page
Page II
(Suite de la chronologie - à partir de 2012)
LA RÉSERVE FÉDÉRALE AMÉRICAINE
La Réserve fédérale des Etats-Unis (ou Fed) est au centre du système financier américain, pour ne pas dire au centre du système financier mondial. A la fois banque d'émission du fameux "billet vert", instance de contrôle du système bancaire US, organisme décideur en matière de politique monétaire (taux d'intérêts) et banque des banques, elle est en apparence placée sous le contrôle du gouvernement américain. C'est en effet la Maison Blanche qui nomme, avec l'accord du Sénat, les cinq gouverneurs qui la dirigent (Board of Governors).
En réalité, et contrairement aux banques centrales de la plupart des autres pays, la Fed est depuis sa fondation, en décembre 1913, une banque strictement privée. Organisée de manière fédérale (siège à Washington, DC), elle comporte douze banques régionales situées à New York, San Francisco, Chicago, Atlanta, Boston, Dallas, Cleveland, Philadelphie, Kansas City, Saint-Louis, Minneapolis et Richmond (Virginie). Chaque Reserve Bank régionale a pour actionnaires les principales banques privées de la région.
Toutefois, la liste complète des actionnaires, et surtout la part de capital que détient chacun d'eux, n'est pas publiée.
Compte tenu de l'influence prépondérante qu'exerce la Fed tant aux Etats-Unis qu'à l'échelle internationale, il serait extrêmement intéressant de connaître cette liste. Malheureusement, il s'agit là d'un secret bien gardé. Des listes circulent sur Internet ; le moins qu'on puisse dire, cependant, c'est qu'elles ne brillent pas par leur actualité. On y trouve des noms d'établissements bancaires depuis longtemps disparus ou fusionnés avec d'autres, tandis que les banques les plus importantes en ce début de 21ème siècle (Citigroup, Bank of America) n'y figurent pas du tout.
Edouard Mandell House et la Fed :
Aux sources du chaos mondial actuel
par Aline de Diéguez.
E.M. House (alias Colonel House) fut à la fois l'éminence grise du président démocrate Woodrow Wilson (à la Maison Blanche de janvier 1913 à janvier 1921) et le porte-parole discret mais efficace des banquiers de Wall Street et du lobby sioniste juif naissant.
Le hasard fait bien les choses
Bien entendu, les questions essentielles que chacun se pose (Qui est derrière ces banques ? A qui appartient Wall Street ? Qui possède et dirige le monde de la finance et de l'économie ?) ne seraient pas résolues au seul vu de la liste complète des actionnaires de la Réserve Fédérale. Ce serait cependant un pas dans la bonne direction.
Toujours est-il que les cinq gouverneurs de la Fed, les cinq hommes qui dirigent sans appel et sans concurrence cette institution - avec toutes les implications que cela comporte - sont tous, sans exception, des Juifs sionistes (un Juif non-sioniste n'accédera jamais à un tel poste de responsabilité). Dire cela à haute voix équivaut bien sûr à violer un tabou absolu -
voir ici.
On objectera peut-être que l'origine ethnique des gouverneurs est sans importance et qu'elle est tout simplement due au hasard. Cinq Juifs - et alors ?... On aurait pu, aussi bien, prendre cinq Noirs, ou cinq Arabes, ou cinq Chinois, ou cinq Italiens, ou cinq Mexicains, ou cinq Irlandais, ou cinq Polonais, ou pourquoi pas (dans les années 1930) cinq Allemands tout ce qu'il y a de plus nazis. Oui, on aurait pu, mais on ne l'a pas fait - et on ne le fera jamais. On aurait pu, à la rigueur, se donner la peine de diversifier la composition du Board. Mais quand on détient le monopole du pouvoir médiatique, la chose est parfaitement inutile. Si quelqu'un râle, il suffit d'invoquer l'Holocauste. D'ailleurs personne ne râle - on sait ce qu'il en coûte.
Evidemment, la Bande des Cinq roule pour Israël et pour son "inexistant" lobby. Elle jouit de la confiance et du soutien des banquiers les plus influents du district financier (eux aussi, pour la plupart, juifs et sionistes). Elle est là pour réaliser leur politique et pour veiller à ce qu'ils s'enrichissent encore plus. Lorsque les zabominables zantisémites reprochent aux milliardaires juifs de "contrôler" la Fed, ils sont encore en deçà de la vérité : la haute finance juive et la Fed, c'est en réalité la même chose - à 100 %.
En 2008, la Réserve fédérale fait beaucoup parler d'elle - comme d'ailleurs bien d'autres banques de par le monde, et comme l'ensemble des marchés financiers.
SYSTÈME BANCAIRE ET MARCHÉS FINANCIERS
On a cru très longtemps que le monde avait tiré les leçons de la grande crise des années 1930 et qu'une telle catastrophe ne se reproduirait plus jamais. On n'en est plus très sûr aujourd'hui. Pourquoi ?...
Après le plongeon : reprise en mains et capitalisme apprivoisé
Au lendemain de la grande secousse boursière de 1929-1930, qui ébranle l'économie mondiale et voit la faillite d'un grand nombre d'entreprises et de banques, le gouvernement Franklin Roosevelt met en œuvre le New Deal, un gigantesque plan de relance par l'investissement public et la consommation, inspiré par l'économiste britannique John Maynard Keynes. On veut à tout prix amortir les bouleversements sociaux avant qu'ils ne conduisent à une situation révolutionnaire. En effet, le socialisme soviétique, qui épargne à l'URSS les effets de la crise mondiale (ne parlons pas des autres problèmes), n'est pas sans exercer un certain attrait sur les "damnés de la terre" du monde occidental.
Le président américain, imité en cela par les pays européens, prend un ensemble de mesures destinées à assainir le secteur financier, afin d'empêcher qu'une catastrophe similaire ne se répète à l'avenir. Dès le milieu des années 1930, et surtout après 1945, on établit partout des mécanismes de contrôle et une séparation assez stricte entre banques commerciales (ou banques de dépôts) et banques d'affaires (ou banques d'investissement)*.
* La loi Glass-Steagall, promulgée sous Roosevelt, instaure ce principe et crée le système fédéral d'assurance des dépôts bancaires (FDIC). Elle sera peu à peu vidée de son contenu à partir de 1980 puis définitivement abrogée en 1999, ouvrant ainsi la porte à tous les excès. Cependant, le FDIC continue d'exister.
Les banques commerciales se contentent d'offrir à leurs clients (particuliers et entreprises) les services essentiels dont ils ont besoin (paiements, transferts, placements et opérations de bourse "simples", crédits "classiques", financement de la production, du commerce, de l'import-export). Elles ne sont pas autorisées à spéculer pour leur propre compte, mais peuvent se lancer dans des opérations à risque dans la mesure où un de leurs clients en assume la totale responsabilité financière.
Les banques d'affaires, elles, occupent le haut de gamme de la palette bancaire (clientèle privée triée sur le volet, gestion de patrimoine, grandes fortunes, gros portefeuilles boursiers, très grandes entreprises) et se consacrent à tout ce qui reste inaccessible aux banques commerciales : prises de participation, acquisitions d'entreprises, fusions, introductions en bourse, financement d'investissements importants.
Grosso modo on peut dire que la banque commerciale a les deux pieds solidement rivés au sol, tandis que la banque d'affaires se distingue de préférence dans les exercices de haute voltige (mais il y a encore un filet).
Dans la plupart des pays existent aussi des secteurs bancaires particuliers, en marge des circuits "standard" : caisses d'épargne publiques, banques coopératives ou mutualistes, banques hypothécaires, instituts spécialisés. Le morcellement du marché financier et le haut degré d'autarcie de chaque secteur minimise le risque d'une nouvelle crise généralisée. Le contrôle de l'Etat a du bon. Aux Etats-Unis, les banques ne sont autorisées à opérer que dans les limites de l'état où se trouve leur siège (les banques de Miami seulement en Floride, celles de San Francisco seulement en Californie, celles de Wall Street seulement dans l'état de New York).
A tout cela vient s'ajouter dans beaucoup de pays, et non des moindres, un contrôle des changes plus ou moins rigide. Chaque Etat a sa propre monnaie et s'efforce de la défendre contre la spéculation. Beaucoup de monnaies ne sont pas convertibles ou ne le sont que partiellement, En France, vers 1968-1969, un particulier doit encore solliciter une autorisation spéciale de la Banque de France s'il veut dépenser plus de 1.000 francs* hors de l'Hexagone - pas 1.000 francs par jour, ni par semaine, ni par voyage, mais 1.000 francs par an. Les entreprises, elles, ne peuvent transférer de l'argent à l'étranger que si elles justifient de l'importation effective de marchandises dans le cadre légal autorisé, et les exportateurs doivent obligatoirement rapatrier leurs fonds. Côté services, où par la force des choses un contrôle matériel aux frontières n'est pas possible, la procédure est encore plus lourde et compliquée. Quant aux investissements français à l'étranger (mais aussi étrangers en France), les barrières bureaucratiques sont très élevées. On est loin, très loin, de la libre circulation des capitaux que nous connaissons aujourd'hui.
* en pouvoir d'achat, environ 1.200 euros de 2008
Et même à l'intérieur d'un même pays, les autorités financières n'hésitent pas, quand elles le jugent utile, à imposer "l'encadrement du crédit", c'est-à-dire l'obligation pour les banques de limiter le montant global des crédits qu'elles consentent à leur clientèle. De la sorte, on réduit la masse monétaire, donc l'inflation (le fléau permanent de cette époque).
La dérive commence
Dans les années 1960, avec la hausse du pouvoir d'achat de la population dans la plupart des pays occidentaux, l'accès à la banque se démocratise. Tout le monde a désormais un ou plusieurs comptes, tout le monde (ou presque) commence à mettre de l'argent de côté, pense à s'acheter une maison et aimerait bien tenter sa chance au casino de la bourse. La clientèle populaire devient intéressante et promet de juteux profits, à condition que les strictes réglementations bancaires soient levées. Le grand capital a hâte de sortir du ghetto de la banque d'affaires pour avaler tous les autres domaines réservés. Il veut également briser toutes les entraves qui frappent encore ses propres opérations.
A partir de 1980, sous l'impulsion de l'administration Reagan, on assiste un peu partout dans le monde au décloisonnement, à la dérégulation et à la privatisation des réseaux bancaires,
là où ils n'étaient pas encore privatisés. En France, on nationalise d'abord le secteur privé en 1981*, avant de reprivatiser toutes les banques en 1986**, y compris les trois plus grandes, qui étaient aux mains de l'Etat depuis 1945.
* sous Mitterrand, avec un gouvernement d'union de la gauche
** également sous Mitterrand, mais avec un gouvernement de droite (cohabitation)
Parallèlement, les marchés s'ouvrent progressivement, l'argent se met à circuler librement par-delà les frontières, les frontières elles-mêmes commencent à s'estomper. On entre un peu dans la mondialisation, même si ce mot n'est pas encore en usage. En matière bancaire et monétaire, les pays de l'Union européenne adoptent d'abord les critères allemands de gestion et de comptabilité, puis tout le monde s'aligne sur les critères américains, dits "internationaux", suivant la devise : Vous nous ouvrez votre porte, très bien. Mais ayez au moins la courtoisie d'adopter notre style et nos méthodes... Et notre langue, bien sûr. Le jargon comptable et financier européen regorge d'expressions américaines sans équivalent dans les autres langues.
Les banques créent de la monnaie... et du risque
Dans un bilan, le passif est le côté où sont enregistrées les dettes d'une entreprise, qui sont aussi des ressources, puisqu'elles lui permettent de financer son activité. L'actif, lui, renseigne sur ce que possède l'entreprise, c'est-à-dire sur la manière dont elle emploie ses ressources.
Au passif d'un bilan bancaire on trouve, entre autres, les sommes que la banque doit à ses clients (dépôts), à d'autres banques, à des prêteurs (souscripteurs d'obligations par exemple), à des créanciers (comme les acheteurs de "produits" financiers émis par la banque) et à ses actionnaires (capital, réserves). L'actif enregistre les crédits consentis à la clientèle, les créances sur des tiers, les avoirs en caisse ou en compte auprès d'autres banques, les titres financiers que la banque a acquis pour son propre compte et les biens immobiliers dont elle est propriétaire.
Contrairement à ce que pense fréquemment "l'homme de la rue", les banques ne se contentent pas de recueillir l'argent de leurs clients pour le prêter à d'autres dans la limite des dépôts reçus. La réalité est sensiblement plus complexe.
En effet, tout nouveau crédit crée automatiquement un avoir en faveur de celui qui en bénéficie. Il en résulte donc un nouveau dépôt au passif de la banque (ou éventuellement au passif d'un autre établissement bancaire, si le bénéficiaire du crédit vire l'argent à un tiers). Il est donc impossible, quand on consulte un bilan bancaire, de savoir si les sommes déclarées comme avoirs de la clientèle représentent de véritables dépôts ou si, au contraire, elles proviennent d'une opération de crédit.
Le crédit étant la raison d'être de toute banque, l'augmentation des dépôts entraîne l'octroi de nouveaux crédits, qui à leur tour vont gonfler les dépôts, qui eux-mêmes etc... L'effet "boule de neige" qui en résulte - du moins en théorie - peut avoir des conséquences catastrophiques si on n'y prend garde.
Les banques participent donc à la création de monnaie. Elles y participent même dans une plus large mesure que la banque d'émission. A l'heure actuelle, la monnaie fiduciaire créée par celle-ci (les espèces) représente environ 7 % de la masse monétaire*. Le reste (93 %) prend en gros la forme d'avoirs en compte (monnaie scripturale), dont une bonne partie résulte d'un tour de passe-passe nommé crédit.
* Fin 2007, il y avait dans la zone euro pour 600 milliards de billets et pièces en circulation, pour une masse monétaire totale (M3) de 8.600 milliards. En février 2009, conséquence directe des "injections" opérées dans le cadre de la crise, ces chiffres sont passés à 740 et 9.427 milliards respectivement, et en novembre 2011 à 866 et 9.850 milliards.
On distingue divers agrégats monétaires : M1 (moyens de paiement au sens strict, c'est-à-dire monnaie fiduciaire + dépôts bancaires à vue) ; M2 (= M1 + la quasi-monnaie, c'est-à-dire les comptes d'épargne et les dépôts à terme à moins de deux ans) ; M3 (= M2 + les titres de placement et instruments négociables sur le marché monétaire émis par les banques et établissements financiers, comme par exemple les certificats de dépôt et les parts de SICAV ou de fonds communs).
Outre la monnaie fiduciaire mise en circulation par la banque centrale, il existe une monnaie scripturale "centrale" matérialisée par les avoirs des banques auprès de l'institut d'émission. Ce poste ne représente qu'une petite fraction du total.

IFM = Institutions financières monétaires
OPCVM = Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Pour pallier au problème résultant de la création de monnaie par le biais du crédit, on exige des banques qu'elles placent auprès de leur banque centrale, sous forme de réserves obligatoires, un certain pourcentage des dépôts à vue ou à court terme qu'elles reçoivent de la clientèle. Cette mesure, qui gèle en quelque sorte une partie des fonds reçus en même temps que leur équivalent à l'actif, constitue aussi un outil de régulation dans le cadre de la politique monétaire - tout comme le maniement des taux par la banque centrale ou son intervention directe sur le marché monétaire (le marché de l'argent à court terme) pour fournir aux banques les liquidités dont elles ont besoin ou, au contraire, pour éponger les excédents de liquidités.
Autre contrainte, servant indirectement de frein à la distribution du crédit - même si elle a avant tout pour fonction de sécuriser le système bancaire :
les autorités de contrôle imposent aux banques le respect de ratios comptables censés refléter le degré de liquidité (l'aptitude à satisfaire à un moment donné les demandes de retrait de la clientèle) et le degré de solvabilité (l'aptitude à satisfaire le remboursement de toutes les dettes du passif, quelle que soit leur échéance, au cas où une liquidation totale de la banque deviendrait nécessaire). Une cessation de paiement par manque de liquidités ne débouche pas fatalement sur l'insolvabilité - à condition toutefois que quelqu'un soit disposé à fournir ces liquidités : un repreneur qui y trouvera son compte ou... l'Etat-vache à lait.
Liquidité et solvabilité
Pour évaluer la liquidité, on compare, pour chaque échéance donnée, les postes correspondants de l'actif et du passif, en les décomptant soit à 100 % soit à un taux inférieur pour certains éléments du passif pour lesquels la réglementation considère que la probabilité d'une demande de retrait est moindre. Le fait de ne décompter certains de ces postes que pour 40, 20, 10, voire 5 % de leur valeur est passablement arbitraire. En cas de défaillance, on sera en droit de parler de maquillage légal.
Pour la solvabilité, on compare les fonds propres de la banque (capital, réserves) aux risques de l'actif pondérés de tel ou tel coefficient suivant la catégorie de risque et la "qualité" de l'emprunteur - ce coefficient étant lui aussi plus ou moins arbitraire. Le problème, en la matière, vient surtout du fait que de nouveaux éléments font régulièrement leur apparition, sans qu'on sache exactement dans quelle catégorie les classer et quel coefficient leur appliquer. En fait, beaucoup d'instruments ou "véhicules" financiers nouvellement mis en place sont nés de la volonté de tourner la réglementation existante. Lorsqu'une banque en détient dans ses actifs, il n'est pas rare que la part de fonds propres qu'elle est légalement tenue de posséder en contrepartie, soit tout à fait insuffisante.
Les engagements sur instruments financiers à terme, qui figurent hors-bilan, n'entrent en ligne de compte dans le ratio de solvabilité que pour une fraction infime de leur volume, sous prétexte que le risque qui en découle est infime, lui aussi. On a vu dans le cas de la Société Générale qu'il n'en est rien, les pertes effectives représentant alors 10 % de l'encours (voir plus bas). En appliquant les méthodes de calcul préconisées à l'échelle internationale par le
Comité de Bâle*,
on aboutit à un "équivalent risque" de moins de 1 %.
Lorsqu'une liquidation bancaire devient nécessaire, la valeur réelle des actifs s'avère toujours inférieure à leur valeur comptable figurant au bilan. La question qui se pose alors est de savoir si cette valeur réelle est suffisante pour permettre le remboursement intégral des dépôts et des autres dettes du passif découlant de l'émission de titres et "produits" financiers (obligations, ABS, etc. -
voir plus bas), ces titres se retrouvant bien sûr en grande quantité dans les portefeuilles d'autres banques.
Les fonds propres servent à amortir une diminution éventuelle de l'actif et devraient donc, de ce fait, toujours être supérieurs au potentiel de dépréciation de celui-ci. Quand ce n'est plus le cas, une recapitalisation doit en principe intervenir. Pour atteindre un haut niveau de sécurité, il n'y a en fait que deux alternatives : 1) éviter systématiquement les crédits à risque et les "produits" financiers douteux, ou 2) augmenter ses fonds propres de telle manière qu'on sera toujours en mesure de faire face à une dépréciation des actifs, aussi grave soit-elle. Bien entendu, aucun de ces deux critères "durs" n'est imposé aux banques.
Plus grave encore, il arrive fréquemment que les établissements financiers émetteurs de titres et autres "instruments innovatifs", ne les fassent pas du tout figurer à leur bilan - parfois en toute légalité, par exemple parce qu'ils les ont externalisés (voir plus bas).
* Selon l'accord Bâle II de 2004, les fonds propres d'une banque doivent représenter au minimum 8 % de ses risques, le "paquet risques" à prendre en considération étant composé de la manière suivante : 75 % de risques de crédit + 5 % de risques de marché + 20 % de risques opérationnels. En principe, Bâle II constitue un progrès par rapport à l'accord précédent (Bâle I de 1988) qui ne retenait que les risques de crédit. Mais comme la structure des bilans bancaires a très fortement évolué entre 1988 et 2004 (voir plus bas
l'exemple de la Société Générale),
5 % pour les risques de marché est un taux tout à fait insuffisant. La crise actuelle montre que le vrai danger n'émane pas tant des crédits qu'une banque consent directement à ses clients, mais plutôt des créances plus ou moins douteuses qu'elle acquiert sur le marché. Si les risques résultant de ces "placements avantageux" étaient évalués correctement, la contrepartie en fonds propres serait telle que le marché se tarirait très rapidement. En 2008, beaucoup de banques se vantent de respecter un ratio de capital supérieur aux 8 % exigés. Dans la plupart des cas, cela ne veut strictement rien dire. Ce n'est pas de 9 % que la banque Lehman aurait eu besoin pour éviter la faillite, mais de 50 ou plus.
En septembre 2010, on présente l'accord Bâle III qui renforce la capitalisation des banques... mais sans mettre fin à la possibilité légale d'exclure certains risques du bilan. Avec cette réformette, le taux de 8 % reste inchangé. Ce qui varie, c'est la composition des 8 %. Bâle II prévoyait au niveau 1 (Tier 1) au moins 4 % de fonds propres permanents, dont 2 % de fonds propres "durs" (Core Tier 1), le reste pouvant être composé de fonds propres temporaires (réserves, provisions) au niveau 2 (Tier 2). Bâle III fait passer le Tier 1 à 6 %, dont 4,5 % pour le Core Tier 1, progressivement jusqu'en 2015. A cela viendra s'ajouter, d'ici 2019, un "matelas de protection" de 2,5 %, c'est-à-dire qu'on aura alors un minimum de 7 % de Core Tier 1... plus le reste. C'est de la poudre aux yeux, car toutes les banques devenues insolvables ces dernières années avaient déjà des ratios de "solvabilité" supérieurs à ce qui sera exigé dans neuf ans. Quant aux modalités de détail, elles sont au moins aussi tordues que celles de 2004 et permettront sans aucun doute toutes les tricheries. Rien de nouveau, donc, de ce côté-là - ce sont bien entendu des banquiers qui ont concocté la "réforme".
Dans le cadre de Bâle III, un ratio de levier (destiné à contrôler
l'effet de levier
des opérations spéculatives) est prévu... pour 2015 ; un ratio de liquidité à long terme sera appliqué... à partir de 2018. Comme on peut le lire dans cet article :
La réforme bancaire de Bâle 3 pour les nuls,
"le calendrier a été tellement assoupli pour tous les ratios, que cela laisse aux banques le temps de voir... une autre crise".
En laissant de côté le facteur temps, on peut dire que le ratio de solvabilité de Bâle est, comme tout ratio, le rapport de deux grandeurs (ici : fonds propres / risques). Comme il faut augmenter la valeur apparente de ce ratio (ce qui est positif au niveau de la communication), on s'efforce de gonfler un peu l'expression comptable du premier terme (les fonds propres) et de minimiser beaucoup celle du second (les risques), indépendamment bien sûr de la valeur réelle de l'un et de l'autre. Le but recherché n'est pas la sécurité mais l'impression de sécurité. Pas étonnant que certains commentateurs parlent, à propos du nouvel accord de Bâle, de "réforme à deux balles", voire même de "trou de Bâle".
BILAN SOMMAIRE DE LA BANQUE X :
| ACTIF | PASSIF |
| A1 - Actifs financiers
("produits" émis par d'autres banques et acquis par la Banque X à titre d'investissement) |
P1 - Passif financier
("produits" émis par la Banque X et vendus à sa clientèle ou à d'autres banques) |
|
|
P2 - Dépôts
(de la clientèle auprès de la Banque X) |
| A2 - Crédits
(consentis par la Banque X à sa clientèle) |
|
| A3 - Valeurs immobilisées
(par ex. biens immobiliers de la Banque X) |
P3 - Fonds propres
(capital, réserves, etc. de la Banque X) |
A1 + A2 + A3 = P1 + P2 + P3.
La part relative de A3 est en général très limitée (souvent moins de 5 % du total). En cas de liquidation, le patrimoine immobilier de la banque en faillite peut néanmoins constituer un des éléments les plus intéressants pour le repreneur (voir Bear Stearns, Lehman Brothers).
La part relative de A1 par rapport à A2 n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années, au fur et à mesure que les "investissements" purement financiers supplantaient les crédits à l'économie réelle. Il n'est pas rare, en 2008, de voir des banques dites "commerciales" détenir 70 ou 80 % d'actifs financiers.
A2 et surtout A1 ont tendance à se déprécier très vite. Aux Etats-Unis, les risques de crédit contenus dans A2 sont plus élevés que dans n'importe quel autre pays, étant donné que les crédits directs accordés par les banques US l'ont été de manière inflationnaire, sans contrôle réel et sans aucun respect des règles prudentielles. Mais bien souvent, ces crédits n'apparaissent pas du tout au bilan (externalisation).
Les risques financiers contenus dans A1 ont le plus souvent leur origine aux Etats-Unis et se retrouvent - titrisation aidant - dans tous les bilans de banque de la planète. Ils en constituent le poste le plus toxique, le plus explosif. A la base, il s'agit soit de crédits douteux accordés par quelques grandes banques, soit de dérivés ou autres "produits innovatifs" concoctés par elles.
La part relative de P1 par rapport à P2 a également tendance à augmenter, surtout lorsque la banque réussit à faire accepter ses "produits" sur le marché et que cette activité devient plus lucrative que le simple fait de recueillir les dépôts de la clientèle. P1 et P2 sont (en principe) incompressibles ; dès que la banque n'est plus en mesure de rembourser à 100 % ses clients et ses souscripteurs, elle doit déposer son bilan.
P3 constitue en quelque sorte le "coussin de sécurité" qui protège de la dépréciation des actifs. Lorsque la valeur réelle de A1 et A2 se contracte, c'est au détriment de P3, qu'il convient alors de regonfler (à moins que les règles en vigueur n'autorisent la banque à fermer les yeux sur les dépréciations - voir plus bas). Le moins qu'on puisse dire est que le mode de calcul du ratio de solvabilité Fonds propres/Risques de l'actif (Bâle II) est très arbitraire et très insuffisant.
(En règle générale, les banques disposent de beaucoup moins de fonds propres que les entreprises industrielles. A titre d'exemple, le 31 décembre 2007, BNP Paribas avait 59,4 milliards d'euros de capitaux propres pour un total de bilan de 1.694 milliards, soit seulement 3,5 %, tandis que L'Oréal affichait 13,6 milliards de capitaux propres pour un total de 23,2 milliards, soit 58 %. Un taux de 40 % est courant dans l'industrie, alors qu'on dépasse rarement les 5 ou 6 % dans la finance.)Dans un monde financier sain d'où la spéculation forcenée serait bannie, A1 et P1 seraient réduits à leur plus simple expression. Le gros du bilan serait alors constitué par A2 (crédits) et P2 (dépôts). C'était le cas avant 1970.
L'effet de levier - moteur de la spéculation
Imaginons le cas d'un spéculateur qui dispose d'un capital de 100.000 €. S'il investit la totalité en bourse (achat d'actions au comptant), il recevra immédiatement ses titres et sera aussitôt débité de leur contre-valeur. S'il les revend trois mois plus tard pour 110.000 €, il aura gagné 10 %.
Supposons à présent qu'il achète ces mêmes actions à terme, avec paiement et livraison dans trois mois. Pour cela, il n'est même pas nécessaire qu'il dispose dès le départ de la totalité de la somme. Pour la banque - ou le courtier - seul importe le risque potentiel inhérent à cette opération, par exemple le risque de voir le cours de l'action chuter de 20 % au cours des trois prochains mois. Dans ce cas, la banque exigera de son client qu'il fournisse une couverture de 20.000 €. En supposant que là aussi le cours ait grimpé de 10 % au bout de trois mois, le spéculateur aura gagné 10.000 €, soit 50 % de sa mise (au lieu de 10 % dans le premier cas). Grâce à l'effet de levier ou leverage (ici de facteur 5), il est possible d'acheter pour 500.000 € d'actions et de les revendre trois mois plus tard au comptant pour 550.000 €, alors qu'on ne disposait à l'origine que de 100.000 €. Bien entendu, le cours peut baisser. Mais tant que la baisse n'excède pas les 20 % prévus, la banque n'a aucune raison de s'inquiéter. Au-delà, elle demandera au client de compléter la couverture (appel de marge) ; s'il n'est pas en mesure de le faire, la banque débouclera la position. Elle vendra les titres, et le spéculateur malchanceux n'aura perdu "que" 20 % au maximum. (En fait, il aura perdu la totalité de son capital disponible - 5 fois 20 %. L'effet de levier joue dans les deux sens.)
La spéculation est également possible à la vente. Le boursicoteur vendra à terme des actions qu'il ne possède pas. Si le jour de l'échéance, le cours a baissé de 10 %, il les achètera au comptant et empochera son bénéfice. Comme la banque estime que le risque d'une telle transaction n'excède pas, par exemple, 20 % (risque de hausse), c'est ce taux de couverture qu'elle imposera à son client. Avec une mise de 100.000 €, il pourra là aussi, s'il a de la chance, empocher une plus-value de 50.000 €. Dans le cas de figure le plus défavorable, il perdra la totalité de ses 100.000 €.
Bien entendu, les opérations de ce genre - qui peuvent aussi porter sur des devises, de l'or, du pétrole, des céréales, etc. - ne sont pas permises au premier venu. Comme l'opérateur est une "personne digne de confiance", la banque n'est pas trop regardante pour ce qui est de la couverture. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'elle agisse en réalité pour son propre compte - ou du moins pour le compte d'un homme de paille. Il est donc évident que l'effet de levier peut atteindre un niveau beaucoup plus élevé que le quintuple mentionné dans notre exemple ; quant à la mise, elle est souvent bien supérieure à 100.000 €. Ce n'est pas tout à fait "le capitalisme sans capital", comme l'a dit quelqu'un, mais on n'en est pas très loin. Pour certains types de
dérivés,
le taux multiplicateur est incontrôlable.
En 2008, l'effet de levier de la spéculation professionnelle a largement stimulé les mouvements erratiques constatés sur les marchés financiers - dans un sens comme dans l'autre. L'interdiction passagère des ventes à découvert n'a rien arrangé. Elle n'a fait qu'amplifier la folie des marchés en la retardant légèrement.
Dans un sens plus large, le leverage joue chaque fois qu'un spéculateur engage des sommes qu'il ne possède pas. Même sans spéculation, le recours au crédit permet aux entreprises et aux particuliers d'anticiper l'avenir et de développer des activités qui seraient impossibles autrement - à condition bien sûr qu'on se trouve en période ascendante. Si c'est le cas, une certaine forme de spéculation inconsciente s'instaure presque automatiquement, qui incite les gens à profiter des conditions du marché (exemple : l'immobilier). Le passage à la spéculation pure n'est alors qu'une affaire de temps.
Pour un établissement financier,
il est plus rentable d'utiliser des fonds empruntés (dépôts et autres) que des fonds propres. Compte tenu de l'interaction crédits-dépôts (voir
plus haut),
l'effet multiplicateur est en principe illimité. En pratique, cependant, les banques sont tenues - grosso modo - d'avoir un capital et des réserves totalisant au moins 8 % de leurs engagements de crédit. C'est le seul frein apporté à l'effet de levier, qu'il limite - en principe - à 12 fois 1/2. En réalité, le mode de calcul très judicieux de ce ratio permet aux banques de déclarer 8 % tout en ayant beaucoup moins de fonds propres (environ 3,2 %, soit un levier de 31*, dans le cas de la Citibank en novembre 2008). Il est vrai, toutefois, que depuis quelque temps déjà, le crédit aux entreprises et aux particuliers a atteint sa limite de saturation. Nous sommes maintenant en pleine phase descendante : l'effet de levier joue en sens inverse, c'est le deleveraging.
Autre chose : si un prêt d'un million de dollars nécessite - en principe - 80.000 $ de fonds propres, le même crédit une fois externalisé, titrisé et transformé en actif financier, n'immobilise plus qu'une petite fraction de cette somme, voire rien du tout. Qui plus est, il rapporte autant sinon plus que le crédit direct. Le taux de rendement pour chaque dollar investi s'en trouve donc multiplié - à condition, bien sûr, que la crise financière ne vienne pas abattre ce beau château de cartes.
* La banque Bear Stearns, au moment de sa quasi-faillite, le 17 mars 2008, avait un leverage de 35,5 (11,1 milliards de fonds propres pour 395 milliards d'engagements comptabilisés). Mais son véritable handicap, invisible au bilan, était constitué par 13,4 billions de dollars (13.400.000.000.000) de dérivés financiers. Ce qui signifie en clair que pour chaque dollar de fonds propres, Bear Stearns avait misé 1.207 fois plus au "méga-casino" de Wall Street.
C'est un peu comme si le spéculateur mentionné au début ne disposait que de 83 euros pour "garantir" sa transaction de 100.000 euros. Ou, en supposant qu'il ait les 100.000 euros, c'est comme si sa banque lui permettait de s'engager à hauteur de 120 millions. Aucun véritable casino ne se permettrait jamais une telle folie...
Mais il y a pire encore : comme le signale Frédéric Lordon dans cet article paru sur un blog du Monde Diplomatique
Quatre principes et neuf propositions pour en finir avec les crises financières, l'effet de levier résultant de l'utilisation de fonds empruntés peut se superposer à l'effet de levier créé par un dépôt de marge réduit. Avec 100 dollars en poche, le spéculateur peut ainsi prendre une position de 375.000 dollars (3.750 fois plus).
Bien sûr, un encours de 13,4 billions de dérivés n'entraîne pas automatiquement 13,4 billions de pertes effectives. Mais si l'on s'en tient au taux de 10 % constaté dans le cas de la Société Générale (affaire Kerviel - janvier 2008), cela fait 1.340 milliards de dollars détruits (120 fois les capitaux propres). A titre de comparaison, le PIB américain se monte à environ 15 billions de dollars.
Quoi qu'il en soit, il serait naïf de penser que les banques encore actives et apparemment saines (Citigroup et consorts) sont moins exposées que ne l'était Bear Stearns avant de sauter.
Glissade vers l'anarchie financière
Dans les années 1960, les risques bancaires sont encore clairs et faciles à maîtriser. Une banque, en particulier une banque commerciale, ne court guère le danger de faire faillite. D'une part, parce que le mode d'évaluation des critères de liquidité et de solvabilité est encore assez simple et transparent, d'autre part parce que la palette des transactions possibles est très restreinte.
Sur le marché des valeurs mobilières, on opère le plus souvent au comptant (débouclement immédiat titres contre argent) ou à la rigueur à terme (en général débouclement fin de mois). Les opérations plus "osées" (options) sont plus rares. Les fonds de placement (SICAV) sont encore très rudimentaires.
Même chose, en gros, sur le marché des changes, où les instances de contrôle veillent à ce qu'il y ait du concret derrière chaque transaction (commerce extérieur, investissements autorisés, paiements légaux). La spéculation pure et simple est difficile, sinon impossible ; les marchés ne s'y prêtent pas, ou assez peu.
Mais avec la libéralisation progressive du secteur bancaire, n'importe qui se met à faire n'importe quoi. Les distinctions entre les divers types d'établissements de crédit commencent à tomber. On s'aventure de plus en plus fréquemment en terrain inconnu.
On quitte aussi peu à peu le domaine du réel où l'acheteur opérant sur les marchés financiers acquiert des valeurs existantes : parts de capital dans une société (actions), créances sur l'Etat, un organisme public ou une entreprise privée (obligations), avoirs en monnaie étrangère (devises), etc... Avec les dérivés, on s'enfonce dans le monde de la spéculation pour la spéculation. On parie sur la valeur future d'une action, d'une obligation, d'une monnaie, sans qu'il soit nécessaire de posséder ces valeurs. On parie sur le niveau d'un indice boursier (la valeur moyenne d'un groupe d'actions), sur des écarts de cours, sur des variations de taux d'intérêts, sur l'évolution de critères souvent incompréhensibles et parfois fictifs. La finance se dématérialise toujours plus, mais les gains et les pertes qu'elle génère sont tangibles et peuvent atteindre des sommets inégalés. Quelqu'un a dit que les dérivés sont à la bourse classique ce que le PMU est à l'élevage des chevaux : la réalité est bien pire...
Finalement, à partir des années 1980, trois facteurs vont contribuer à la fragilisation des marchés financiers :
la création incessante de nouveaux instruments spéculatifs* et la croissance inflationnaire de ces dérivés : contrats à terme (forwards, futures, swaps) portant sur des valeurs mobilières, des devises, des taux d'intérêts, des indices boursiers ou des marchandises (produits agricoles, matières premières, métaux) ; contrats optionnels** à fort effet de levier permettant de gagner un multiple de sa mise (ou de tout perdre) ; dérivés de crédit (credit default swaps ou CDS)...
* A l'origine, certains de ces instruments ont été créés dans le but de protéger leur acquéreur contre des risques normaux découlant d'opérations concrètes non-spéculatives (par exemple, dans un contexte de baisse de la monnaie américaine, un exportateur vend à terme dès aujourd'hui des dollars qu'il ne recevra que dans trois mois ; ou encore, un prêteur fait assurer une créance sur l'étranger qu'il estime assortie d'un certain risque). C'est un domaine où la banque côtoie l'assurance.
Le CDS n'a pratiquement plus rien à voir avoir ces préoccupations légitimes. C'est un contrat financier dans lequel est impliqué un "vendeur de protection" étranger au secteur réglementé des assurances. Généralement dépourvu de capitaux, ce vendeur n'a qu'un souci : toucher sa prime. On imagine la catastrophe lorsque les défaillances soi-disant couvertes par ces credit swaps, commencent à s'accumuler. En juin 2008, F. William Engdahl (Global Research) estime que sur un volume total de CDS de 62.000 milliards de dollars, 1.200 milliards sont susceptibles de sauter : Credit Default Swaps - Next Phase of an Unravelling Crisis. Engdahl rappelle que c'est Alan Greenspan, chef de la Fed de 1987 à 2005, qui a permis la prolifération incontrôlée des CDS.
** Les options et le 11 septembre : Délits d'initiés.
Dans le domaine spéculatif, on peut aussi combiner les indices et jouer sur les différences de cours, ou mélanger les genres en se lançant par exemple dans les options sur swaps (les swaptions). On peut même jongler avec les droits d'émission créés dans la foulée de l'hystérie climatique. Sans oublier les opérations de grande envergure (emprunts obligataires, émissions, fusions, acquisitions, capital-risque, private equity, hedge funds...) ; les innombrables fonds de placement ; les produits concoctés par les compagnies d'assurances (toujours plus difficiles à distinguer des banques) ; les titres adossés à des actifs (ABS - asset backed securities) ; les obligations* titrisées comme les CDO (collateralized debt obligations) ou leur équivalent hypothécaire CMO (collateralized mortgage obligations) ; les véhicules d'investissement structurés (SIV) et autres véhicules ad hoc (SPV - special purpose vehicles), dont la raison d'être est d'acheter à tour de bras des créances douteuses dont personne ne voudra plus quelque temps plus tard (par exemple, les subprimes hypothécaires américains) pour les remodeler sous une forme présentable et les revendre avec profit à des banques qui ignorent tout du contenu. Cette redistribution du risque de crédit, cette transformation de risques connus, mesurables, contrôlables, en titres financiers abstraits et dématérialisés, échappant à toute évaluation comptable sérieuse, rend possible - et probable - une catastrophe financière généralisée.
* Souvent, les emprunts obligataires contenus dans les CDO sont assurés par des "bond insurers", ce qui accroît la confiance en ces instruments (meilleure notation) et facilite leur écoulement sur le marché. Lorsque les défaillances se multiplient, il est évident que les assureurs (AMBAC, MBIA...) sont eux-mêmes en difficulté et que les autres titres dont ces compagnies "garantissent" le remboursement plongent à leur tour : c'est ce qui se passe aux Etats-Unis, début 2008.
On estime que la part des transactions purement spéculatives, sans aucune nécessité économique et motivées uniquement par l'appât du gain, atteint déjà plus de 90 % de l'ensemble des flux monétaires. Et encore, toutes les opérations ne donnent pas lieu à un mouvement de fonds équivalent, loin de là... Selon le milliardaire américain Warren Buffett, qui sait de quoi il parle, la bulle des dérivés représentait, à elle seule, plus de 500 billions de dollars (500.000 milliards) à l'échelle mondiale, en 2007*. Que va-t-il arriver lorsque cette bulle éclatera et qu'il sera nécessaire d'éponger les pertes ? A quel pourcentage du total se monteront ces pertes : 2 %, 5 %, 10 % ?... (A titre de comparaison, le PIB américain est d'environ 15 billions de dollars.) En principe, les spéculateurs doivent fournir une couverture, en monnaie ou en titres, correspondant au risque probable. Lorsque le risque croît ou que la valeur des titres baisse, on leur demande un versement supplémentaire (appel de marge). Si la "rallonge" n'est pas versée, la position est débouclée et la perte potentielle devient une perte réelle. Que les liquidités commencent à faire défaut ici et là, et c'est l'avalanche qui menace...
* Soit 500 fois plus qu'en 2001. Dans son rapport de décembre 2007, la Banque des Règlements Internationaux (BRI), Bâle, donne un chiffre total de 516 billions de dollars et évalue le risque potentiel à 11 billions. On peut toutefois se demander pourquoi ce risque resterait limité à 2 %... En décembre 2009, selon la BRI, le total des dérivés en circulation est de 605 billions : on voit que les financiers de Wall Street continuent d'alimenter la crise. Fin juin 2011, le total est de 708 billions.
William H. Gross, financier et milliardaire américain lui aussi, estime que la méga-bulle des dérivés constitue une sorte de système bancaire parallèle, incontrôlé et incontrôlable : "C'est le plus gigantesque marché noir du monde et, potentiellement, une arme financière de destruction massive..."
Pour les banques anciennement commerciales et aujourd'hui "universelles", les risques découlant des instruments spéculatifs ne cessent de gagner en importance par rapport aux risques de crédit proprement dits. Alors qu'autrefois la demande de crédit bancaire dépassait de beaucoup l'offre, les banques ont de la peine, quelques décennies plus tard, à trouver des emplois pour leurs ressources disponibles. Elles tendent à accumuler dans leurs actifs des "produits" toujours plus sophistiqués... et toujours plus dangereux.
Dans les années 1990, les banques (en particulier les banques américaines) se sont mises à externaliser une bonne partie de leurs risques de crédit. Au lieu de consentir des prêts directs à leur clientèle modeste, elles ont laissé des intermédiaires ou courtiers (brokers) le faire à leur place, ces derniers se refinançant auprès d'investisseurs spécialisés dits indépendants (New Century Financial, par exemple).* Conséquences pour les banques : bilan "ravalé", risque amoindri, commission assurée. Conséquences pour les investisseurs (souvent liés aux grandes banques) : titrisation des créances, c'est-à-dire transformation des prêts en instruments financiers que l'on placera avec profit sur le marché après notation positive par les rating agencies (également liées aux grandes banques). Comme les banques en question, en quête d'emplois supposés rentables, sont les premières à acheter les nouveaux titres financiers ainsi créés, nous avons affaire à un véritable retour de boomerang. Les risques de crédit "externalisés" reviennent ainsi à l'expéditeur, mais ne sont plus cette fois comptabilisés comme tels. Bien entendu, les banques qui sont à l'origine de cette procédure ne sont pas les seules - loin de là - à acquérir ces titres. Des milliers d'autres établissements, aussi avides que naïfs, se lancent également dans la course et tombent dans le panneau - globalisation obige.
* Les entreprises externes ne sont pas soumises aux mêmes règles prudentielles que les banques et ne s'embarrassent donc pas de constituer des dossiers très étoffés - au diable la "bureaucratie"... Bien souvent, les acheteurs de créances hypothécaires qui font vendre les biens immobiliers de leurs débiteurs insolvables, ne possèdent même pas de titre et se contentent de déclarer "sur l'honneur" qu'ils ont "égaré" le document en question. La plupart du temps, les tribunaux ferment les yeux.
En quelques années, la part relative des actifs financiers dans les bilans de banques autrefois commerciales a grimpé en flèche, celle des crédits à la clientèle a baissé. Un coup d'œil sur les comptes de la Société Générale donne l'image suivante :
(en milliards d'euros) 2002 2006 2010 Total du bilan : 501 956 1132 Crédits : 202 289 401 Actifs financiers : 172 538 571
Au cours des quatre années précédant la crise (2002 à 2006), le total du bilan a presque doublé (+ 90 %). Mais si les crédits n'ont augmenté "que" de 43 % (ce qui est déjà beaucoup), les actifs financiers, eux, ont plus que triplé (+ 212 %). Leur part est passée de 34 % à 56 % du total ; celle des crédits a baissé de 40 % à 30 % (bien que le volume des crédits ait augmenté en valeur absolue). Si l'on remonte encore plus loin dans le passé, on constate qu'en 1998 les actifs financiers ne représentaient que 22 % du total : 83 milliards sur 384. (Et à tout cela il faudrait ajouter les risques financiers ne figurant pas au bilan.)
Une telle explosion de l'activité purement spéculative a quelque chose de malsain. Elle prouve que la Société Générale, comme d'ailleurs toutes les autres banques "grand public", n'a plus pour fonction de financer l'économie réelle et de répondre aux besoins de ses clients ; elle joue tout simplement avec l'argent qui lui a été confié.
Autre aspect inquiétant : l'accumulation d'actifs financiers nécessite, en contrepartie, moins de fonds propres que s'il s'agissait de crédits. La solvabilité réelle de la banque s'en trouve affectée, même si les ratios officiels sont respectés.
(Entre 2006 et 2010, la tendance s'est un peu "calmée", mais sans revenir à la "normale" de 2002. En 2010, les crédits représentent 35 % du bilan, les actifs financiers 50 %. On ne peut pas dire que la Société Générale ait tiré les leçons de la crise.)le retard et l'inefficacité des procédures de contrôle face à l'explosion des marchés : les autorités chargées de la surveillance des marchés et des établissements financiers sont complètement dépassées par les événements. Elles se contentent d'appliquer la loi ou le règlement, mais la loi est toujours à la traîne. Le fameux "législateur" veille d'ailleurs à laisser les coudées franches aux spéculateurs, au nom du "libéralisme" et de la globalisation. (Il ne légifère pas vraiment, se contentant d'approuver - sans les comprendre - des décisions prises ailleurs sans débat démocratique.)
Quant au contrôle interne des banques, on a vu en janvier 2008 ce qu'il valait : Société Générale : de qui se moque-t-on ? Quand un employé relativement modeste (salaire brut annuel : 100.000 euros - une broutille à côté de ce que gagnent les vrais "golden boys") parvient à accumuler (seul ?) des positions spéculatives de 50 milliards débouchant sur des pertes de 5 milliards*, les banques ont un sérieux problème - et leurs clients aussi.
* Pour un total de bilan de 956 milliards d'euros et un résultat net de 5,8 milliards avant le scandale. (Des plaisantins ont créé une nouvelle unité de mesure dans le domaine bancaire : le kerviel, représentant l'équivalent de 5 milliards d'euros de perte. A partir de combien de kerviels peut-on parler de cataclysme financier ? A partir de 1.000 kerviels, soit 1 kilokerviel ou 1 kk - c'est le cas de le dire...)
Jérôme Kerviel, bouc émissaire du capitalisme financier par Paul-Eric Blanrue.
[Kerviel sera condamné en octobre 2010 - voir plus bas.]l'opacité des marchés, c'est-à-dire l'impossibilité, même pour les spécialistes et les initiés, d'avoir une vue exacte de la situation à un moment donné : comment le pourraient-ils puisque les banques qui rachètent des titres basés sur des créances douteuses (ou participent à leur émission) ne prennent pas toujours la peine de les comptabiliser. On a beau savoir lire un bilan, on ne pourra jamais y trouver ce qui n'y est pas.* Aujourd'hui, n'importe quel banquier achète n'importe quoi sans laisser de traces. On a vu des caisses d'épargne de Rhénanie se lancer dans l'immobilier en Arizona (où elles n'y connaissent strictement rien) et annoncer, toutes penaudes, qu'elles avaient perdu tant et tant de milliards en voulant jouer les "global players". En 2008, il est devenu impossible d'évaluer la solidité d'une banque, car personne ne sait exactement quelles "bombes à retardement" elle a éventuellement "oublié" de faire figurer dans ses livres. Les rating agencies chargées de la noter (comme par exemple Fitch Ratings, Moody's ou Standard & Poor's) ne sont absolument plus fiables.** Conséquence : plus personne ne veut plus prêter d'argent à personne. Ce qui ressemble à une crise passagère de liquidité, surmontable avec l'aide de l'Etat et des banques centrales, pourrait bel et bien se transformer en effondrement complet.
* Certains risques qui ne figurent pas au bilan sont néanmoins repris "hors-bilan", c'est-à-dire en quelque sorte "en marge" de celui-ci. C'est le cas, entre autre, des engagements par signature (cautions ou garanties fournies par la banque). D'autres éléments, "externalisés" dans le but d'alléger les comptes, ne figurent ni dans le bilan ni hors-bilan. Ce qui ne signifie pas, malheureusement, qu'ils aient complètement disparu. Avec la crise financière actuelle, on découvre au contraire presque quotidiennement des exemples de risques transmis (légalement ou pas) à des sociétés externes qui ne le sont pas vraiment, ou vis-à-vis desquelles la banque "cédante" a pris un engagement bien réel, quoique réputé inexistant et pour lequel elle n'a pas prévu de fonds propres en contrepartie.
** Ironie du sort, avant de fournir une évaluation erronée sur la solvabilité de la banque en question, les agences de notation l'ont elle-même induite en erreur en lui recommandant l'acquisition de produits financiers foireux.
Lorsque Citigroup, le numéro un mondial de la finance, annonce au printemps 2008 des pertes de 18 milliards de dollars au cours d'un seul et même trimestre, on peut se consoler en se disant que cette somme est ridicule face à un total de bilan de 2.200 milliards. Le problème, c'est que personne ne connaît l'ampleur des pertes réelles : et si elles étaient dix fois, vingt fois ou cent fois plus élevées ?... La garantie des dépôts ne servira pas à grand-chose le jour ou le géant se sera écroulé, entraînant tout le monde dans sa chute. Les profiteurs, pour ne pas dire les organisateurs de la débâcle, sauront pour leur part tirer leur épingle du jeu.
Plan organisé ?
On entend souvent l'expression "capitalisme de casino" quand il est question de la situation financière actuelle. En fait, la réalité est bien pire, car aucun casino de Las Vegas n'a jamais offert autant de possibilités que les marchés financiers. Aux yeux d'un banquier de Wall Street ou de la City, la roulette et les machines à sous, c'est bon pour les débutants.
En cas de défaillance, on ne sanctionne que les lampistes et les boucs émissaires. Et comme la responsabilité personnelle des dirigeants n'est jamais engagée, ces messieurs n'ont aucune raison de faire preuve de modération.
Sur le plan criminel, le braquage d'une banque est tout à fait insignifiant en comparaison de la fondation d'une banque, disait en substance Bertolt Brecht, dans les années 1920-1930. Que dirait-il aujourd'hui ?...
"Aucune autre activité n'a un talent comparable pour privatiser les gains et socialiser les pertes", rappelle Martin Wolf (Financial Times) à propos de la mafia de l'argent.
En l'espace de cinquante ans, on est tombé de Keynes à Milton Friedman, du dirigisme au laissez-faire, de l'Etat modérateur à l'Etat complice, de la défense du service public au pillage organisé.
Ce qui se passe sur les marchés financiers s'intègre bien entendu dans le plan d'ensemble baptisé mondialisation. C'est par là que viendra la catastrophe qui permettra une répartition radicale des richesses du bas vers le haut.
Que faire ?
Début 2008, avec le scandale de la Société Générale et la crise financière mondiale qui commence, on entend souvent dire qu'il faut réglementer les banques. Oui, bien sûr... Le problème, malheureusement, résulte moins de l'absence de réglementation que d'un excès de règles favorables à la spéculation.
Le secteur bancaire et financier est un de ceux où les compétences nationales ne sont plus du tout demandées. La France a perdu toute souveraineté dans ce domaine depuis qu'elle a abandonné sa monnaie et qu'elle s'en remet à des autorités extérieures aussi peu élues que contrôlables : Commission européenne, Banque centrale européenne (BCE), Comité de Bâle de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), etc.
Une décision ayant trait, par exemple, au mode d'évaluation de la solvabilité des banques françaises (et des banques étrangères en France) ne peut pas se prendre à Paris, ni même à Francfort ou à Bruxelles, mais seulement à Bâle. La BRI étant l'émanation des treize plus grandes banques centrales du monde, dont celle des Etats-Unis (la Fed), on imagine ce qui se passerait si la France proclamait son intention de faire cavalier seul. Comment réagirait le fameux Board of Governors de Washington ? (voir
plus haut)
Un retour à la situation des années 1970, où les grandes banques françaises étaient encore une sorte de service public à l'abri des appétits carnassiers de la finance internationale, est parfaitement utopique sans modification radicale de l'ensemble des conditions économiques et politiques. Evidemment, tout se tient ; une mutation dans un secteur donné n'est pas pensable sans mutations dans tous les autres.
A moins qu'une révolution aussi radicale que celle de 1789-1793 ne vienne rétablir la souveraineté nationale en y ajoutant une très forte composante sociale, tout est programmé pour continuer dans le sens de la globalisation ultra-capitaliste. Une solution réelle exigerait que la France résilie unilatéralement tous les traités supranationaux qui vont à l'encontre de ses intérêts, à commencer par le traité européen : difficile à imaginer...
Un pays souverain (ou un groupe de pays souverains), sans même abandonner le cadre du système actuel, prendrait quelques mesures de bon sens : stopper le laissez-faire sur les marchés financiers et contrôler strictement l'activité bancaire, geler les dérivés existants et empêcher qu'il s'en crée de nouveaux chaque jour, garantir effectivement les dépôts des particuliers et des PME. Ce ne serait pas du "socialisme", mais tout juste du "dirigisme" comparable à ce que faisaient Roosevelt en 1935 ou de Gaulle en 1945. Et pourtant, rien de tel ne sera fait en 2008-2011.
(Une transformation socialiste irait bien sûr infiniment plus loin : nationalisation de l'ensemble du système bancaire ; gestion démocratique excluant un recyclage des parasites de la finance privée ; restructuration en fonction de l'intérêt national ; prise en compte des besoins de l'économie réelle et du secteur public restauré et étendu ; plus de course au profit au détriment des utilisateurs et du personnel ; fermeture pure et simple de la bourse...)
Voir également
plus bas
la solution proposée par Webster Tarpley en octobre 2011.
Quatre principes et neuf propositions pour en finir avec les crises financières - par Frédéric Lordon (économiste, directeur de recherche au CNRS).
D'autres économistes, comme Maurice Allais (en France) ou Joseph Huber (en Allemagne) voient la cause de la crise dans le fait que l'Etat a perdu depuis bien longtemps son privilège de "battre monnaie". Ils proposent donc une réforme du système financier qui restituerait aux pouvoirs publics ce monopole disparu. Sans entrer dans les détails - ce qui mènerait beaucoup trop loin - disons que l'un et l'autre veulent retirer aux banques toute possibilité de création monétaire. Allais reste assez vague sur les conséquences pratiques de sa théorie ; Huber veut instaurer un "pouvoir monétatif" à l'instar des pouvoirs déjà existants (législatif, exécutif, judiciaire).
Le problème, dans les deux cas, c'est que pour aboutir, il faut remettre entre les mains d'une instance étatique toutes les decisions concernant les actes créateurs de monnaie, à commencer par le crédit bancaire sous toutes ses formes. Mais parallèlement, on ne touche pas à l'initiative privée en matière économique ou financière. C'est un peu la quadrature du cercle. Dans un passé pas très lointain, il a existé des pays où la totalité de la masse monétaire était générée par l'Etat ou ses institutions, mais ces pays n'étaient pas capitalistes et l'initiative individuelle y était presque totalement inconnue.
Comme ni Allais ni Huber n'ont l'intention de recréer une sorte de RDA dans leurs pays respectifs (pas même une RDA "améliorée"), et comme ils ne réclament ni pour la France ni pour l'Allemagne le droit à l'initiative individuelle des Etats, droit que la mondialisation a aboli, leurs projets ne peuvent pas vraiment être pris au sérieux, même s'ils contiennent un certain nombre d'éléments positifs.
Le mythe bancaire : un article intéressant, mais n'allez surtout pas croire que le problème sera résolu grâce à des élections.
S'il n'y a probablement pas de solution générale et collective dans le cadre du système existant, peut-on au moins envisager la possibilité d'une solution individuelle ?... Magot enterré dans le jardin ?... Liasses de billets cousues dans un matelas ?... Si tout le monde opte pour le papier-monnaie, il y a fort à parier que l'hyperinflation ne se fera pas attendre... L'or serait-il un remède efficace ?...
Quoi qu'il en soit, attention si votre banque vous recommande un placement imbattable ou vous conseille d'investir dans la pierre. Le gars qui vous propose ça pense avant tout à son bonus, et il n'y voit sans doute pas plus clair que vous et moi...
LA CRISE FINANCIÈRE DE 2007-2013
"Il est temps de réformer les retraites"
Les banques et autres organismes financiers comparables ne sont pas les seuls intervenants sur les marchés. Les investisseurs institutionnels ou "zinzins" (fonds de pension, caisses de retraite) jouent un rôle considérable, surtout aux Etats-Unis, où l'assurance vieillesse, comme l'assurance maladie, est une affaire privée. Aux USA, tout ce que les travailleurs économisent en prévision de leurs vieux jours, passe automatiquement par le marché financier et reste à la merci d'un effondrement boursier. Et lorsque l'entreprise qui gère les fonds fait faillite, ou que ses dirigeants disparaissent avec l'argent, l'épargnant-retraité n'a plus qu'à se tirer une balle dans la tête (voir le scandale Enron, en 2001).
C'est ce système "moderne et idéal" que les "réformateurs" européens prévoient d'instaurer pour leurs salariés.
La déroute annoncée du système de retraites par capitalisation
Endettement
Début 2008, la dette publique des Etats-Unis se monte à environ 9,5 billions de dollars (+ 600 milliards chaque année ou 1,7 milliard chaque jour*), ce qui représente environ 65 % du PIB annuel, soit proportionnellement moins que la France (dette publique française : 1,4 billion d'euros ou 2,2 billions de dollars). La dette publique US s'élève à 32.000 dollars par habitant, la dette publique française à 35.000 dollars. De ce côté-là, la France a donc déjà dépassé le niveau américain (même chose pour l'Allemagne). On notera que le volume "astronomique" de la dette publique est tout relatif quand on le compare aux 500 billions de dollars de la bulle des dérivés (voir plus haut).
* C'est un peu moins que les dépenses militaires (700 milliards de dollars par an ou 2 milliards par jour). Toutefois, avec l'adoption début octobre 2008 du plan de sauvetage de 850 milliards, la dette publique américaine grimpera à 11 billions en 2009, soit plus de 70 % du PIB. Le 12 octobre 2008, on en est déjà à
10.276.307.126.813 dollars et 97 cents
- voir
U.S. National Debt Clock.
De septembre 2007 à septembre 2008, on a enregistré une augmentation de 1.200 milliards, soit 3,3 milliards de plus chaque jour (le double de l'accroissement des années précédentes). Chacun Américain "doit" à présent 33.700 dollars. Les USA sont sur le point de rattraper la France (à moins que ce ne soit déjà fait - tout dépend du taux de conversion euro/dollar).
Début juillet 2009, le compteur indique 11,5 billions de dollars. En novembre, il dépasse les 12 billions, ce qui correspond à une augmentation de 1,8 billion en un an (5 milliards de dollars par jour). Un an plus tard, fin 2010, on en est à 13,9 billions (+35% en deux ans). Début août 2011, l'endettement public atteint le maximum "autorisé" de 14,3 billions, de sorte qu'il est nécessaire de porter ce plafond à 16,4 billions (en attendant le prochain relèvement qui ne saurait tarder).
Pour ce qui est de la dette extérieure (publique + privée), la situation est tout à fait différente (déficit accumulé de 13 billions de dollars, soit environ 85 % du PIB annuel, aux Etats-Unis ; léger excédent en France). Dans des conditions normales, lorsqu'un pays accumule les déficits extérieurs, sa monnaie ne tarde pas à en pâtir. Dans le cas des USA, il a fallu attendre assez longtemps avant que ce principe ne se vérifie. En effet, le dollar étant une monnaie de réserve, et pour beaucoup une monnaie refuge, le monde entier, en effectuant des placements ou des investissements aux USA, contribue à rétablir l'équilibre et à cacher le déficit extérieur permanent. La Chine, à elle seule, y contribue pour 10 % (excédent de 1.300 milliards de dollars) mais la part des détenteurs de pétrodollars est bien plus élevée. La crise financière touche ces créanciers dans la mesure où leur argent était placé dans des établissements en faillite ou en difficulté. Le bruit court, en octobre 2008, que la Chine a perdu des sommes considérables en l'espace de quelques semaines, et elle n'est certainement pas un cas unique. A lui seul, le trou laissé par Lehman Brothers à l'étranger représenterait plusieurs centaines de milliards de dollars. Pour les Etats-Unis, la crise est une manière "élégante" d'effacer une partie de la dette extérieure.
L'endettement des ménages aux USA totalise 14 billions de dollars, soit 47.000 dollars par habitant (trois fois plus qu'en France). On encourage systématiquement les Américains à s'endetter, surtout dans l'immobilier bien sûr, mais aussi dans le domaine du crédit à la consommation, quitte à les saigner à blanc lorsqu'ils ne sont plus assez solvables (par exemple parce que les taux relativement avantageux au départ, augmentent très rapidement). La crise des "subprimes" vient de là. Le mot "subprimes" est d'ailleurs un euphémisme qui désigne les débiteurs dont le standing n'est pas de premier ordre (prime debtors) mais moindre (sub). En matière de crédit à la consommation, le mode d'endettement le plus courant aux Etats-Unis est le découvert lié à l'utilisation d'une carte de crédit (c'est aussi le plus cher). 50 millions de détenteurs de cartes de crédit doivent un total de 600 milliards de dollars* (12.000 dollars chacun, en moyenne). Et il existe encore d'autres formes de crédit personnel, souvent inconnues ailleurs, par exemple le crédit étudiant qui permet de payer ses frais d'études (en moyenne, plus de 40.000 dollars par emprunteur). Toutes ces bulles de crédit ne demandent qu'à éclater...
* Selon des données de juillet 2008, ce chiffre serait entre-temps passé à un billion de dollars (1.000 milliards).
triplé depuis 1995, quadruplé depuis 1991 :

Attention : un milliard se dit en anglais "billion", un billion (mille milliards) se dit "trillion".
Le point que nous utilisons pour séparer les milliers est une virgule dans les pays anglo-saxons,
et leur point correspond à la virgule que nous plaçons devant les décimales.
A part ça, tout est pareil...
L'augmentation vertigineuse de la dette des ménages a injecté dans l'économie américaine une masse de liquidités qui a permis de maintenir artificiellement la croissance à un niveau élevé. Les particuliers croyaient s'enrichir grâce à l'immobilier ; en réalité, ils s'appauvrissaient.
Par exemple, une famille empruntait 400.000 dollars afin de s'acheter une maison en valant 500.000. Trois ou quatre ans plus tard, la valeur du bien étant passé à 750.000 dollars, le banquier encourageait ses clients à emprunter 200.000 dollars de plus pour s'offrir, disons, une grosse voiture, des biens de consommation, un voyage autour du monde ou les frais d'études des enfants. Avec une hypothèque supplémentaire, aucun problème... Et puis, quelque temps plus tard, l'immobilier plonge, le banquier demande à son client de rembourser plus vite ou de fournir de nouvelles sûretés, il augmente ses taux - normal puisque l'emprunteur est moins solvable. C'est le début de la catastrophe, surtout si le client vient à perdre son emploi. Finalement, la famille se retrouve à la rue, les mains vides... Le banquier, le promoteur immobilier, le marchand de 4x4 et tous les autres gonfleurs de PIB, eux, ont fait des affaires en or. Malgré la mauvaise conjoncture, ils ont le temps de voir venir en attendant la prochaine bulle.
La dette des entreprises américaines, qui provient principalement de crédits bancaires ou d'emprunts obligataires des grandes compagnies sur le marché financier, s'élève à environ 12 billions de dollars.
En additionnant dette publique, dette des ménages et dette des entreprises, on arrive à un total de 36 billions de dollars environ (dont 13 billions vis-à-vis de l'étranger). Il s'agit là de la dette concrète et palpable, résultant d'opérations réelles. Si l'on voulait y ajouter l'endettement net provenant de transactions purement financières et spéculatives, impossibles à chiffrer de manière réaliste, nul ne sait à quel total on arriverait.
On cite souvent le chiffre de 50 billions lorsqu'il est question de l'endettement global des USA, la dette du secteur financier y figurant pour 14 billions. Mais comme ce dernier chiffre est un minimum absolument arbitraire, le total général pourrait aussi bien être 2, 3 ou 10 fois plus élevé (à comparer au PIB annuel d'environ 15 billions de dollars). 50 billions de dollars répartis sur 300 millions d'habitants, cela donne 167.000 dollars par tête. Le fardeau effectif est peut-être de 300.000 ou 500.000 ou 1.000.000 de dollars par habitant - qui sait ?...
Lorsque la crise éclatera pour de bon et que le niveau réel d'endettement sera révélé, il y aura nécessairement une coupe brutale (et pas seulement aux Etats-Unis). L'annulation d'une grande partie de la dette financière ruinera de très larges couches de la population (les fameuses "classes moyennes"), les faillites se multiplieront, l'Etat et les collectivités locales deviendront à leur tour insolvables, entraînant sans doute l'effacement ou le gel de leur dette. Une chose est certaine : on ne fera pas de cadeaux aux "ménages", leur dette ne sera certainement pas annulée, ils seront les seuls à faire les frais de la crise - du moins 90 % ou 95 % d'entre eux. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Argentine en 2001-2002 et d'élever le tout à la puissance 10.* Les vraies "réformes libérales" n'ont pas encore eu lieu.
* Il est facile d'imaginer les conséquences sociales et politiques d'un tel bouleversement : incroyable recrudescence de la criminalité, insécurité totale, dictature militaire, disparition des dernières "libertés démocratiques", intensification du terrorisme d'Etat et de la guerre permanente pour détourner l'attention des vrais responsables, effondrement général permettant enfin la construction accélérée du nouvel ordre mondial tant attendu par l'oligarchie et ses pilotes néo-cons.
La dette publique, source d'enrichissement des banques privées
De nos jours, l'Etat, qui détient en théorie le monopole "régalien" de création de monnaie, n'a en réalité qu'une influence marginale sur ce processus. La banque d'emission (qu'elle soit un organisme étatique ou, comme la Fed, une institution privée agissant pour le compte de l'Etat) génère tout juste 7 % de la masse monétaire -
voir plus haut.
Le pouvoir de la Banque Centrale sur l'émission monétaire par Jean Bayard.
La
masse monétaire
(article de Wikipédia) représente en quelque sorte la part des richesses qui existe sous forme liquide (ou quasi liquide) et permet de faire tourner l'économie (et accessoirement la spéculation).
Dans une économie socialiste (ou capitaliste mais fortement étatisée, comme la France d'avant les privatisations), l'Etat finance lui-même ses investissements et ses dépenses courantes (ou s'efforce de le faire), utilisant prioritairement les fonds drainés par les établissements financiers du secteur public et les organismes spécialisés (en France : Caisse des Dépôts, Crédit National, etc.). En cas de besoin (ce qui arrive assez souvent en France), il emprunte aussi directement sur les marchés financiers privés (émission d'emprunts obligataires).
Les partisans de la privatisation ont toujours prétendu que le recours de l'Etat aux fonds publics équivalait à activer la "planche à billets" et à attiser l'inflation. Pour résoudre ce "problème", il fallait obliger l'Etat à emprunter sur le marché "libre" (et par la même occasion "libérer" au profit du secteur privé les sources publiques de financement).
Cet argument fallacieux ne tient pas compte du fait que les crédits consentis par des banques privées représentent une création de monnaie, donc une cause potentielle d'inflation. Depuis que la privatisation et la "libéralisation" ultracapitaliste se sont imposées partout, on voit que la dette publique a crû de façon anarchique pour le plus grand profit du secteur privé. L'endettement à outrance (qui conduit assez souvent à la ruine) est une source inépuisable de profits pour les banques privées, non seulement quand les pigeons sont des particuliers, mais aussi et surtout quand c'est l'Etat qui emprunte. Alors qu'il serait plus rationnel et moins onéreux d'exclure le secteur privé du financement des dépenses publiques, on assiste de manière toujours plus dramatique au pillage des ressources communes par les prédateurs du privé.
Sans même parler de l'aspect social et humain de la question, il est évident que la privatisation coûte plus cher à la société que la gestion publique (une véritable gestion publique, et non une gestion confiée aux représentants du secteur privé, comme ce fut le cas en France, en Italie et ailleurs).
On entend souvent dire qu'il convient de se serrer la ceinture pour ne pas léguer un monceau de dettes aux générations futures. Bien entendu, ce slogan absurde occulte totalement la manière dont la dette publique est générée. Il passe d'ailleurs également sous silence le fait que les actifs qui seront eux aussi légués aux générations futures dépassent de beaucoup le passif. En réalité, ce n'est pas la société de demain qui devra payer pour la nôtre, mais la masse de notre société qui doit payer aujourd'hui pour enrichir davantage quelques milliers de parasites. Et à moins d'un sursaut général, la société future subira un sort similaire - sinon pire.
Sur la création de monnaie, le racket financier, l'endettement selon Ségolène Royal et François Rabelais, lire ici plusieurs articles de
Jacques Cheminade (sur le site de Solidarité et Progrès, proche de Lyndon LaRouche).
Voir aussi :
Endettement public et idées préconçues.
Le grand secret : l'endettement des Etats-Unis comparé à l'endettement français par François Asselineau.
"Le discours lancinant des européistes sur 'le niveau de dette publique insupportable que l'on va laisser à nos enfants' est une formule à l'emporte-pièce complètement irréfléchie, une propagande scandaleusement réductrice et biaisée...
La donnée essentielle pour juger de la santé financière d'une nation, c'est le niveau d'endettement total de tous ses agents économiques : l'Etat et les collectivités publiques, mais aussi les ménages et les entreprises...
La France doit reconquérir sa souveraineté économique et financière pour décider librement du niveau d'intervention étatique dont notre pays a besoin."
(Les chiffres cités par l'auteur diffèrent parfois légèrement des nôtres - c'est une question de source ou de taux de conversion dollar/euro. Aucune divergence quant au fond.)
La cause de l'endettement de la France, c'est la loi Rothschild.
Cette loi de 1973 interdisant à la Banque de France de financer le Trésor public, a été renforcée en 1992 par une clause du traité de Maastricht qui empêche les membres de l'UE d'emprunter auprès de leurs banques centrales. Conséquence : une explosion de la dette, surmultipliée par les intérêts que les Etats doivent verser aux usuriers du privé.
Indépendamment des cadeaux purs et simples dont bénéficie la haute finance, on peut mesurer, en 2009, à quel point les prêts de l'Etat enrichissent les banques privées. Wall Street se voit inonder d'argent public pratiquement gratuit (coût entre 0 et 0,25 %), alors que l'Etat lui-même, pour financer ses besoins, doit emprunter à ces mêmes banques (ou par leur intermédiaire) à des taux jamais inférieurs à 3,5 ou 4 %. Théoriquement, l'écart s'explique par les différences d'échéances : court terme pour les prêts consentis aux banques privées, plus long terme pour les sommes empruntées par le secteur public. Mais en pratique, le court terme ne mérite pas ce nom, car les avances sont renouvelables - et renouvelées indéfiniment. (En Europe, la situation n'est guère différente, si ce n'est que le taux de la banque centrale est légèrement plus élevé : 1 %.)
Cours du dollar
La dépréciation du billet vert a été constante ces dernières années, mais n'a encore rien de très dramatique en mars 2008 (1,58 dollar pour un euro). Certes, si on compare ce cours à celui de 2002 (0,80 dollar pour un euro), la baisse est impressionante, mais il ne faut pas oublier qu'au moment de l'introduction de l'euro, en 1999, le cours était de 1,18. Et si l'on remonte plus loin encore, on constate qu'en 1996, un dollar valait 1,45 DM ou 4,80 F*, ce qui correspond à 1,35 dollar pour un euro. Donc, malgré un petit détour, l'euro est passé de 1,35 à 1,58** dollar en douze ans. Pas de quoi s'affoler - on en reparlera quand le cours sera à 2 dollars pour 1 euro, ce qui correspondrait à 1 mark ou 3,30 francs pour un dollar.***
* Jusqu'à l'introduction de l'euro, on exprimait le cours d'une monnaie étrangère dans sa propre monnaie (1 dollar = 4,80 francs). Cette méthode était courante dans le monde entier, sauf à Londres. Curieusement, en 1999, la zone euro s'est alignée sur l'Angleterre, bien que ce pays n'ait pas adopté la monnaie unique. Désormais la valeur de l'euro est exprimée en monnaie étrangère (1 euro = 1,58 dollars). C'est comme si, au lieu de dire que le litre d'essence vaut 1,30 euro ou le kilo de pommes 2 euros, on disait que l'euro vaut 0,77 l d'essence ou 0,5 kg de pommes - une façon de voir les choses absolument contre nature. Les gens qui ont pris une décision aussi stupide devaient être soûls ou drogués.
** En avril et en juillet 2008, le cours franchit pendant quelques minutes la barre de 1,60 mais redescend aussitôt. La spéculation en sens contraire le fait retomber à moins de 1,40 en septembre et à moins de 1,25 en octobre.
*** Pour la petite histoire : en 1984, le dollar cotait l'équivalent de 0,57 dollar pour un euro ; en 1978, l'équivalent de 1,10 ; dans les années 1960, l'équivalent de 0,48.

Dollar américain - Montagnes russes
(graphique simplifié ne tenant compte que des extrêmes)
Entre parenthèses :
Comment les Russes voient les rapports entre le dollar et l'euro
Une pub de Finance, le magazine moscovite qui vous explique comment faire de l'argent
(gif - 160 ko)

Mauvais pour les exportations européennes, cette baisse du dollar, entend-on dire partout. En principe, oui. Mais ce que les Européens exportent vers les USA, ce ne sont pas des produits de première nécessité. Que le prix en dollars de la nouvelle BMW augmente de 10 ou 20 % ne gêne pas trop les acheteurs. Et puis les marges sont tellement lucratives, qu'il est toujours possible de faire une fleur à ses clients. D'un autre côté, l'appréciation de l'euro (ou du yen ou du franc suisse) devrait faire baisser les prix des marchandises achetées en dollars. Si les prix ne baissent pas, c'est que quelqu'un se remplit les poches à nos dépens. (Vous avez déjà vu les prix baisser ?...)
Curieusement, en septembre-octobre 2008, lorsque le dollar remonte ("bon pour nos exportations"), les exportateurs continuent de pleurnicher. Malgré la baisse des prix exprimés en dollars, les Américains n'achètent plus, paraît-il. C'est à cause de la crise, disent les exportateurs. (Ils n'en auraient pas profité pour augmenter leurs prix ?...)
[En mai 2010, le problème n'est plus le dollar mais l'euro. Le cours de la monnaie européenne a toutes les peines du monde à se maintenir au-dessus de 1,20 $.]
Le système monétaire international est-il en crise ?
On peut lire çà et là que le système monétaire international est lui aussi en crise et qu'il conviendrait de le réformer d'urgence. Le démocrate américain dissident Lyndon LaRouche, par exemple, est de cet avis, mais il est loin d'être le seul.
En fait, un tel système monétaire international impliquant, comme le dit Wikipédia, "une collaboration des principales économies mondiales afin de réguler les mouvements des taux de change entre les plus importantes devises", n'existe plus depuis des décennies.
Petit retour en arrière
Au 19ème siècle et à la "belle époque", chaque monnaie nationale est convertible en or et garantie par un stock de métal précieux détenu par la banque émettrice. C'est le régime de l'étalon-or. Les mouvements monétaires transfrontaliers, parfaitement libres partout, sont encore relativement limités en volume. Le gros des paiements résulte du commerce international, même si les transferts de capitaux purement financiers (investissements à l'étranger) sont également courants. Ce qui n'existe pas encore, c'est la frénésie spéculative sans rapport aucun avec l'économie réelle.
La guerre de 1914 met fin à cette situation idyllique (idyllique pour les privilégiés en mesure d'en profiter). Après un conflit coûteux et dévastateur, la plupart des pays se voient dans l'impossibilité de revenir au système de l'étalon-or, les quantités de métal précieux disponible ne suffisant plus pour couvrir les dépenses de reconstruction. Les frontières restent fermées ; les monnaies perdent leur fonction internationale ; les Etats doivent réglementer le flux des paiements avec l'étranger. Bien entendu, tout le monde n'est pas touché de la même façon. Au contraire, les USA, véritables vainqueurs de la guerre, profitent largement de la situation. Mais face à des partenaires commerciaux insolvables, il leur est impossible d'en tirer tout le parti voulu. La crise aidant, rien ne change jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
En 1944-45, on retrouve en gros la même configuration qu'en 1918, mais fortement amplifiée : Etats-Unis vainqueurs, Allemagne effondrée, Europe occidentale très affaiblie, sans oublier le Japon détruit et l'Europe de l'Est exsangue. Les USA à eux seuls disposent d'un PIB égal à celui du reste du monde*. Il est donc évident qu'ils vont dicter leurs règles à la fois aux pays vaincus et à leurs propres alliés. Mais comme Franklin Roosevelt est encore à la Maison Blanche (jusqu'à sa mort, en avril 1945), c'est un capitalisme soft et social qui va s'imposer, d'autant plus que le camp communiste, en Europe (et pas seulement en Europe de l'Est), pèse de tout son poids dans la balance.
* Aujourd'hui, la part des USA est retombée à environ 27 % du PIB mondial (15 billions de dollars sur 54).
Les accords de Bretton Woods
En juillet 1944, les Etats-Unis organisent à Bretton Woods (dans le New Hampshire), une conférence internationale qui va régler les rapports monétaires de l'après-guerre. C'est l'économiste britannique Keynes, très influent auprès de l'administration Roosevelt, qui en a lancé l'idée. Au lieu d'abandonner à eux-mêmes les pays appauvris par la guerre, comme on l'avait fait en 1918, on va leur prêter l'argent qui leur permettra d'acheter en Amérique tout ce dont ils ont besoin pour redémarrer - ce qui stimulera d'autant l'économie des USA. C'est le crédit utile, et non cette forme de prêt qui tue, que l'on verra plus tard et dont aucun pays pauvre ne se remettra jamais.
La conférence de Bretton Woods s'inscrit dans le cadre de l'ONU nouvellement créée. Au centre du processus mis en place pour faciliter la reconstruction, on trouve la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, deux organismes qui ont entre-temps tout perdu de leur fonction initiale. En 2008, ils ne sont plus que des instruments de soumission, d'exploitation et de destruction au service de Wall Street. En 1945, leur rôle est encore d'aider le monde à se relever sans imposer outre mesure les vues américaines (du moins jusqu'à la guerre froide).
Dans le système de Bretton Woods, le dollar est la seule monnaie basée sur l'or. Une once de ce métal (31 grammes) vaut 35 dollars. Les banques centrales étrangères peuvent à tout moment convertir en or les avoirs qu'elles détiennent auprès de la Fed. En pratique, personne ne le fait, sauf la France de de Gaulle, en 1965, sur les conseils de l'économiste Jacques Rueff, qui rêve d'un retour à l'étalon-or d'avant 1914 (l'étalon est son dada).
Fort de cet avantage, le dollar devient en 1945 la seule monnaie utilisée dans les paiements internationaux. Les Etats-Unis, qui contrôlent 80 % des réserves d'or, sont aussi les banquiers de la planète, ce qui leur permet de renforcer leur hégémonie économique. La seule résistance qui leur sera opposée vient du bloc socialiste, qui refuse dès 1947 de se plier au diktat de Washington, puis à partir de 1958, de l'Europe occidentale en voie d'émancipation.
Avec le système de Bretton Woods des premières années, les USA fournissent les liquidités dont le commerce international a besoin. Ils le font soit directement, soit par le biais du FMI. Au fur et à mesure que les Etats d'Europe occidentale et le Japon se relèvent, les Américains leur délèguent une partie de cette tâche. Le système fonctionne sans problèmes et peut être qualifié de réussite.
L'après-Bretton Woods
A la fin de années 1960, le système a atteint ses limites. Les échanges internationaux (et le financement de la très coûteuse guerre du Viêt-Nam) nécessitent toujours plus de liquidités (dollars). Le stock d'or n'étant pas extensible, la devise américaine devrait, en bonne logique, être dévaluée. Mais le gouvernement américain s'y refuse. Sur les marchés, l'or se négocie déjà à plus de 35 dollars l'once : 40, 45, 50... Les experts les plus audacieux prédisent 70 dollars, le double du prix officiel (à comparer avec les 1.000 dollars de 2008).
Les détenteurs de dollars perdent confiance. Des monnaies comme le mark et le yen commencent à faire concurrence au billet vert, mais leur valeur, comme celle de toutes les autres monnaies, se définit encore par rapport à lui.
En août 1971, les USA (Nixon est président) abandonnent la convertibilité. Bretton Woods est mort. A partir de là, les cours des devises vont se mettre à "flotter", parfois à l'intérieur d'une fourchette ou "serpent". Mais comme chaque fois que des pressions sont exercées sur une monnaie, le pays visé redéfinit la parité (au moyen d'une dévaluation ou d'une réévaluation), on a pratiquement affaire à un marché libre. Souvent, cependant, les gouvernements et les banques centrales ("indépendantes") soutiennent les cours en intervenant directement sur le marché des changes. C'est une question de choix politique, qui se pose avec ou sans parité rigide.
Durant les années 1970 et 80, beaucoup de pays industrialisés connaissent encore une certaine règlementation des changes. L'Etat contrôle plus ou moins les paiements avec l'étranger, par nécessité ou par principe. Puis, à partir de 1990, l'économie se mondialise, les barrières tombent. N'importe qui peut faire n'importe quoi (à condition d'en avoir les moyens). En 2008, seuls les Etats du tiers-monde imposent encore des restrictions à leurs citoyens (mais pas à leurs "élites" corrompues, ni aux "investisseurs" étrangers).
Pour un nouveau Bretton Woods ?
Comme la cause des problèmes financiers que nous vivons actuellement n'est pas de nature monétaire, on peut se demander en quoi une réorganisation serait utile. Si le dollar domine encore largement les marchés, ce n'est pas parce que les Etats-Unis l'exigent. Chacun est libre de ne pas investir aux USA, de ne pas acheter leurs bons du Trésor, de ne pas confier son argent aux banques de Wall Street, de facturer ses exportations en euros ou dans une autre devise. Une réforme du système monétaire n'apporterait rien de nouveau à cet égard.
Au contraire, on a l'impression que certains démagogues qui réclament aujourd'hui une nouvelle conférence monétaire internationale, veulent en réalité consolider la position du dollar, assez malmenée ces derniers temps, et fournir par la même occasion un ballon d'oxygène au système financier - pas au système monétaire, qui n'en a nul besoin. Dans un cas comme dans l'autre, le but de la manœuvre est de sauvegarder l'hégémonie économique américaine.
Ce qui, bien sûr, n'est pas l'objectif des réformateurs honnêtes, comme LaRouche - bien qu'un retour à l'ère de Bretton Woods implique aussi de replacer le dollar américain sur son ancien piédestal.
Une conférence purement monétaire ne servirait donc à rien. Une conférence financière sans chamboulement profond
(voir plus haut),
non plus.
"Nouveau Bretton Woods" : méfiez-vous des produits frelatés -
pour LaRouche et ses partisans, le vrai Bretton Woods n'était pas tant financier et monétaire, qu'économique et politique.
Fin 2008, ce thème du nouveau Bretton Woods est tellement frelaté que même François Hollande et Michel Rocard, deux "socialistes" qui espèrent bien se retrouver en 2012 dans une "administration Strauss-Kahn", réclament "la remise à plat de tout le système financier et monétaire mondial, comme on le fit à Bretton Woods après la seconde guerre mondiale. Cela nous permettra de créer les outils d'une régulation mondiale que la globalisation et la mondialisation des échanges rendent indispensables". Indépendamment du fait que le système financier mondial n'a pas été réformé en 1945, on voit parfaitement où ces gens veulent en venir. Comme dans le cas de la taxe financière (taxe Tobin voulue par Attac), on constate que les idées "innovatrices" lancées par des milieux progressistes ou supposés tels, sont volontiers reprises en haut lieu. "La finance folle ne doit plus nous gouverner" ajoutent nos "réformateurs" - alors qu'ils savent pertinemment que la politique de leur idole DSK (patron du FMI) et la remise à plat qu'ils préconisent eux-mêmes ne font que renforcer l'emprise de la "finance folle" sur le monde.
Faut-il une monnaie unique à l'échelle mondiale ?
Depuis quelque temps, il en est de plus en plus souvent question. Mais c'est avant tout un argument utilisé par ceux qui estiment que la mondialisation peut très bien se passer des Etats-Unis et qu'elle s'en passera un jour. Beaucoup de partisans de l'idée de "gouvernement mondial", bien entendu totalement contrôlé par la mafia sioniste, vont dans ce sens (George Soros et Jacques Attali, pour ne citer qu'eux).
Curieusement, les dirigeants chinois soutiennent ce projet* qui ne peut que nuire à leur pays. Abandonner un dollar-monnaie d'échange sur lequel ils pourraient exercer une certaine influence s'ils le voulaient (ils sont un des principaux créanciers des USA) et adopter à la place un "globalo" qui les enchaînera à jamais aux maîtres du monde qui veulent leur perte, cela n'est pas seulement illogique, c'est totalement stupide et presque criminel.
Pour un pays post-souverain comme la France, ce genre de question ne se pose plus. Quel que soit le nom de la monnaie unique imposée par les fanatiques à la solde de l'étranger, le résultat sera le même.
* La Chine pourrait bien entendu utiliser sa propre monnaie dans les échanges internationaux. Mais cela en ferait automatiquement une monnaie de réserve. Les excédents commerciaux feraient grimper le cours du yuan, ce qui aurait pour effet de renchérir les produits exportés et de gripper le moteur de l'économie chinoise : c'est d'ailleurs ce que les Etats-Unis réclament depuis longtemps (ils parlent de "retour à l'équilibre"). De plus, une internationalisation du yuan exposerait la Chine aux excès de la spéculation monétaire, ce que les dirigeants veulent éviter à tout prix.
Mai 2011 - FMI, Strauss-Kahn, "réforme" du système monétaire international, droits de tirage spéciaux et bancor, ou les retombées inattendues d'une affaire criminelle :
Les mésaventures du sioniste DSK et ce qu'en dit Thierry Meyssan.
Nostalgie
Un retour à l'étalon-or d'il y a un siècle est-il matériellement possible ?
Les réserves d'or mondiales des Etats représentent aujourd'hui quelque 50.000 tonnes, soit environ 1,6 milliard d'onces (les particuliers détiennent deux fois plus). Face à ces 50.000 tonnes, nous avons une masse monétaire mondiale estimée à 60 billions de dollars en 2008. Si chaque dollar (ou autre devise) en circulation devait être garanti par l'or, il faudrait fixer le prix de l'once à plus de 37.000 dollars. Un lingot d'un kilo vaudrait 1,2 million de dollars. De quoi foudroyer sur place de Gaulle et Jacques Rueff, s'ils étaient encore en vie... En ne prenant en compte que la monnaie fiduciaire (billets), soit environ 7 % de la masse monétaire totale en 2008, on aboutit à un prix théorique de 2.600 dollars l'once* pour un taux de couverture-or de 100 %. Mais un tel taux "idéal" n'existait déjà plus à la fin de l'ère de l'étalon-or.**
Quoi qu'il en soit, ces chiffres traduisent bien la forte dépréciation de la valeur intrinsèque du dollar (et des autres monnaies) par rapport à ce qu'elle était en 1945, dépréciation générée en grande partie par la libéralisation des marchés. Pour rétablir de façon viable un système basé sur l'or et revenir à un cours de l'once "acceptable", il serait nécessaire de suivre une politique brutalement déflationniste, qui non seulement éliminerait le secteur financier purement spéculatif, mais rétrécirait aussi l'économie réelle bien au-delà du supportable.
* Ce chiffre représente une estimation de 2008. Sachant que la masse monétaire croît beaucoup plus vite que la quantité d'or disponible, il augmente d'année en année. En 2011, il se situe probablement aux alentours de 3.400 dollars (le double du prix du marché).
** En 1913, selon l'économiste belgo-américain Robert Triffin, alors que la monnaie fiduciaire représentait 25 % de la masse monétaire totale, l'or (et accessoirement l'argent-métal) détenu par les banques centrales du monde entier couvrait à 68 % les billets de banque en circulation et à 17 % l'ensemble de la masse monétaire. Trente ans plus tôt, le taux de couverture était de 140 % et 62 % respectivement ; les billets de banque constituaient alors 44 % de la masse monétaire. Le bimétallisme (étalon-or et étalon-argent) était encore très répandu à cette époque. (Source : The Evolution of the International Monetary System - 1964.) Si l'on devait appliquer de nos jours un taux de couverture-or sembable à celui de 1913 pour la masse monétaire dans son ensemble, l'once d'or devrait valoir 6.300 dollars (base 2008) et probablement plus de 8.000 dollars en 2011.
Etalon-or ou pas, des mesures purement monétaires n'ont aucun sens sans modification radicale de tout le contexte. En 2008, le monétaire n'est que le reflet du financier, le banal symptôme d'un dérangement profond. Traiter les symptômes ne mène pas loin... A moins de redonner aux banques la fonction qu'elles avaient autrefois, de les encadrer très sévèrement, de sanctionner pénalement toute tentative d'abus et de supprimer tous les "produits" parasitaires, on ne pourra jamais mettre fin à la folie actuelle.
Taux d'intérêts
Depuis le début de la crise (été 2007), la Fed a fait passer son taux directeur (Federal Funds Rate) de 5,25 % à 2 % (30 avril 2008) puis à 1,5 (8 octobre 2008), à 1 % (29 octobre 2008) et enfin dans une fourchette de 0 à 0,25 % (16 décembre 2008). La BCE et la Bank of England, dont les taux étaient inférieurs au taux américain en 2007, ont d'abord refusé de suivre la Fed*, rendant les placements en euros et en livres plus rémunérateurs. La baisse systématique des taux américains a contribué à la chute du dollar jusqu'en septembre 2008. Par la suite, l'alignement des pays européens sur Washington (toujours avec un certain délai) a fait remonter la monnaie américaine.
* En juillet 2008, la BCE décide au contraire de relever son taux directeur de 4 à 4,25 %. Elle finit par le ramener à 3,75 en octobre (la BoE baisse alors le sien à 4,5). Début novembre, nouvelle baisse à 3,25 pour la BCE et à 3 pour la BoE. Début décembre, baisse à 2,5 % (BCE) et à 2 % (BoE). En janvier 2009, nouvelle baisse du taux BoE à 1,5 (taux le plus bas depuis 1694) et du taux BCE à 2 %. En mars : baisse à 0,5 et 1,5 % respectivement. Début avril 2009, baisse du taux BCE à 1,25 ; début mai à 1 %. Deux ans plus tard, en avril 2011, le taux de la BCE remonte à 1,25 %, et en juillet à 1,5 %. Mais il redescend bien vite à 1,25 en novembre, puis à 1 % en décembre de la même année, à 0,75 en juillet 2012, à 0,5 en mai 2013, à 0,25 % en novembre 2013, à 0,15 % en juin 2014 et à 0,05 % en septembre 2014.
En temps normal, une baisse du taux directeur (le taux auquel la banque centrale approvisionne les banques) entraîne une baisse des autres taux et facilite l'octroi de crédits aux entreprises et aux particuliers, contribuant ainsi à relancer une économie défaillante. A partir de 2007, le problème résulte moins d'une véritable absence de liquidités que d'un manque général de confiance.
En pratique, il existe deux catégories, fondamentalement différentes, de taux d'intérêts pour les crédits : ceux - en baisse - que la banque centrale offre généreusement aux banques plus ou moins en difficulté, et ceux - constants ou en hausse - que ces mêmes banques appliquent à leurs clients emprunteurs. Ces deux catégories de taux n'évoluent pas en parallèle, la baisse décidée par la banque centrale n'est pas répercutée comme il se doit. On ne vient pas en aide aux débiteurs, mais aux banques.
Une baisse de taux est aussi, en principe, une excellente façon de doper la bourse, car il devient plus lucratif de détenir des actions que d'investir son argent dans des titres à revenu fixe ou de le placer en compte. Mais là aussi, la confiance fait défaut, et l'effet escompté n'est que de courte durée.
Fin 2008, le taux zéro devient une réalité aux Etats-Unis (pour les bons du Trésor à 3 mois).
Voir également
plus bas (15 janvier 2009).
Interventions de la Fed
Lorsque la confiance mutuelle que se portent les banques a disparu, et qu'aucune d'entre elles ne veut plus prêter d'argent à aucune autre (en supposant que des liquidités soient encore disponibles), le marché monétaire se trouve paralysé. Si la banque centrale n'intervient pas, le système bancaire s'effondre. Mais il risque aussi de s'effondrer en dépit des interventions, si la crise est plus profonde qu'il n'y paraît. Des centaines de milliards de dollars sont alors sacrifiés à perte. Quand la crise éclate, personne n'est en mesure de dire si le "sauvetage" va réussir. Après coup, tout le monde peut prétendre qu'il "savait".
On peut d'ailleurs se demander si le citoyen ordinaire et les patrons de la Fed entendent la même chose par "sauvetage". Sauver les débiteurs hypothécaires aux abois, les épargnants modestes et les petits actionnaires ne fait certainement pas partie du programme de Bernanke et de ses acolytes. Sauver les banques, peut-être, du moins certaines d'entre elles, celles où ces messieurs ont investi, et qui sortiront grandies et enrichies de l'épreuve. Depuis que le capitalisme existe, les crises ont toujours permis aux gros d'avaler les petits. Le mécanisme de concentration se trouve considérablement accéléré en temps de crise.
Mais pour en revenir à 2008, il est possible, dans un premier temps, que les centaines de milliards de dollars de la Fed ne servent qu'à accentuer la débâcle au lieu de la stopper, qu'ils soient en quelque sorte de l'huile jetée sur le feu. Bien entendu, ces concours sont remboursables à (très) court terme, mais comme le marché monétaire interbanques ne fonctionne plus, tout le monde se tourne vers la banque centrale. L'argent emprunté est remboursé à l'aide de nouveaux emprunts, qui sont ensuite renouvelés (et augmentés) d'échéance en échéance*. Le "court terme" devient du permanent en croissance continuelle. La Fed se trouve ainsi engagée dans un processus qui sort totalement du cadre habituel de ses opérations - même si son rôle est aussi de "prêter en dernier ressort".
* Fin septembre 2008, les banques américaines ont emprunté en moyenne, chaque jour, 368 milliards de dollars à la Fed.
Les aides au marché doivent bien sûr être comptabilisées et gonflent démesurément le bilan de la banque centrale américaine (1.770 milliards le 15 octobre 2008* contre 870 milliards un an plus tôt) avec - du moins en partie - des titres sans valeur et des crédits qui ne seront jamais remboursés. A moins que la situation ne se normalise, il faudra bien un jour ou l'autre remettre de l'ordre dans ce bilan, et soit tenir compte des dépréciations survenues, soit externaliser tous ces actifs "toxiques". Des sommes considérables resteront à la charge du contribuable - pour ce genre de choses, il y a toujours suffisamment d'argent. Et puis, comme dans le cas des dépenses militaires, l'argent n'est pas perdu pour tout le monde.
* 2.214 milliards de dollars le 13 novembre 2008 ; 2.385 milliards le 8 décembre 2010 ; 3.097 milliards le 20 février 2013 ; 3.479 milliards le 26 juin 2013 ; 3.907 milliards le 14 novembre 2013 (multiplié par 4,5 en 6 ans). Voir également la page suivante
15 novembre 2013.
Depuis décembre 2008, le taux directeur de la Fed est quasiment nul (voir un peu plus haut :
Taux d'intérêts). L'effet - théorique - attendu d'une nouvelle baisse de taux (redonner du tonus à une économie stagnante) ne peut plus être réalisé de cette manière. La banque centrale recourt donc à des méthodes non conventionnelles pour créer des liquidités. La spécialité de Bernanke ("Helicopter Ben" - voir plus bas :
21.12.2009)
est d'inonder le marché en prêtant directement aux banques en échange de titres à la valeur douteuse. C'est ce qu'il appelle par euphémisme "quantitative easing" ("QE" - allègement quantitatif), alors qu'il s'agit au contraire d'un alourdissement, tant du bilan de la Fed que de la masse monétaire et de la dette.
Depuis fin 2010, et surtout depuis fin 2012, le "QE" a pris des dimensions astronomiques. Les banques reçoivent entre 40 et 85 milliards de dollars supplémentaires chaque mois, à des taux proches de zéro (0,07 % en juin 2013). Cet argent n'est pas insufflé dans l'économie réelle (ou très peu). Il va alimenter de nouvelles bulles spéculatives. En 2013, il y a même trop de liquidités pour alimenter toutes les bulles, de sorte qu'une bonne partie des fonds empruntés restent placés auprès de la Fed (à des taux souvent supérieurs au 0,07 % mentionné plus haut). Inutile de dire que les banksters y trouvent leur compte. La question est de savoir comment tout cela va se terminer...
Inflation
On considère genéralement qu'une baisse des taux attise l'inflation*, car l'argent devient "moins cher", ce qui a tendance à accroître la masse monétaire. Il n'est pas certain cependant que l'inflation que l'on observe en 2007-2009 vienne de là. Les causes résident plutôt dans la spéculation qui fait grimper en flèche le prix du pétrole et des denrées alimentaires.
* Inversement, une hausse des taux, instrument classique utilisé pour "combattre l'inflation" et "calmer une économie qui s'emballe", produit souvent l'effet contraire en renchérissant la production et, partant, le coût de la vie. Les automatismes enseignés par les "experts" fonctionnent rarement dans le monde réel.
Inflation ou pas ?... En fait, il existe depuis quelque temps deux tendances parfaitement contradictoires en la matière. D'un côté, les "élites" économiques et financières s'efforcent d'instaurer une ambiance déflationnaire, semblable à celle des années 1930, où les taux d'intérêts versés aux épargnants, l'indice officiel des prix, les salaires et le pouvoir d'achat de la masse des citoyens sont en baisse. De l'autre, elles pratiquent - sans le crier sur les toits - une politique d'inflation effective qui se solde par des taux élevés pour les emprunteurs et une flambée des prix pour les consommateurs (énergie, alimentation, soins de santé). On arrive ainsi à faire coexister un taux directeur tendant vers 0 % et un taux d'inflation réelle (non-avoué) de 10 %.* Dans un monde où beaucoup d'indicateurs économiques sont systématiquement manipulés, cette contradiction passe presque inaperçue.
C'est un moyen efficace pour faire baisser les salaires, accroître la pression sur le "marché du travail" et imposer des contre-réformes antisociales.
* En juin 2008, le taux officiel dans l'ensemble de la zone euro est de 4 % sur un an - ridicule... En mai 2009, encore mieux, on nous annonce un taux de 0,0 %, et en juillet 2009... -0,6 % !!!... En novembre 2009, alors que chacun peut constater de visu que les prix augmentent (produits alimentaires, énergie, etc.), Eurostat fait état d'une "baisse" de 0,1 %.
L'hédonisme a bon dos
Depuis quelques années, l'indice des prix est calculé selon la méthode américaine dite "hédoniste", qui part du principe que le consommateur est toujours à la recherche de ce qu'il y a de mieux sur le marché. Si la qualité d'un produit s'améliore d'une année sur l'autre mais que son prix reste constant ou augmente légèrement, les statisticiens considèrent que le prix a en fait baissé "à qualité constante". Cet hédonisme-là est bien sûr une absurdité, car il faut payer le prix demandé, que l'on veuille l'amélioration ou pas - on n'a pas le choix. Mais la méthode permet de maintenir le taux d'inflation officiel à un niveau nettement inférieur à l'augmentation réelle des prix.
Comment les statistiques sur l'inflation sont manipulées.
Croissance ou récession ?
Le taux de croissance, ou variation du PIB d'une année (ou d'un trimestre) sur l'autre, est considéré comme l'un des principaux indicateurs économiques d'un pays. Le PIB, ou produit intérieur brut, représente la somme des biens et services produits à l'intérieur du pays au cours de la période donnée. A l'instar de toutes les données statistiques (inflation, endettement, chômage, etc.), la valeur du PIB est en soi assez peu fiable. Elle l'est peut-être même encore moins que toutes les autres, car elle ne tient pas compte de nombreux facteurs (économie non-marchande, travail bénévole ou non-rémunéré, activités illicites ou clandestines) qui gagnent en importance d'année en année, au fur et à mesure que la situation économique réelle se dégrade et que la précarité s'étend.
Mais puisque les économistes partent du principe que la part occulte du PIB reste constante d'une année sur l'autre, le taux de croissance est considéré, lui, comme étant fiable. Ce qui reste à prouver... Si, pour prendre l'exemple français de 2006, le taux de croissance du PIB en valeur dite réelle (PIB brut corrigé de l'inflation) est de 2,2 % et que le taux d'inflation (officiel) s'élève à 1,5 %, tout est en ordre. Mais si l'inflation réelle a été, en fait, de 3 %, la croissance réelle n'est que de 0,7 %. Et si l'inflation réelle a atteint 4 ou 5 ou 10 %, alors la croissance réelle est négative. ("Croissance négative" est d'ailleurs une expression tout à fait sublime - un peu comme lorsqu'on dit "avoir négatif" en parlant du découvert sur son compte en banque.) Trafiquer le taux officiel d'inflation, c'est aussi trafiquer le taux de croissance - qu'on ne vienne pas nous raconter que la chose ne se produit pas (voir un peu plus haut).
A cela vient s'ajouter le fait que les services fantaisistes ou parasitaires enregistrés dans le PIB augmentent sensiblement depuis quelques années. Dans son Rapport pour la libération de la croissance (sic), présenté en février 2008, le sioniste sarkozyen "de gauche" Jacques Attali signale que "l'industrie financière [re-sic] croît depuis 2001 en Europe trois fois plus vite que le PIB". Pour ce qui est de l'hystérie climato-carbonique, elle doit contribuer, elle aussi, au gonflement artificiel de ce même PIB, mais là les chiffres ne sont pas connus.
L'utilisation systématique de termes comme "industrie" ou "produits" en relation avec la finance, a pour but de faire naître le sentiment qu'il s'agit d'une activité productive au même titre que, par exemple, l'industrie automobile ou la production alimentaire, alors que l'utilité du système financier pour l'économie réelle (rôle de "lubrifiant") est depuis longtemps écrasée par ses aspects nocifs et destructeurs.
Il existe en fait un véritable culte fétichiste de la croissance. Une économie doit absolument croître - peu importe de quelle façon, peu importe qu'il y ait des nuisances. Une armée de statisticiens fournit en permanence les indicateurs qu'on lui demande de produire afin d'alimenter ce culte, ce qui fait également grimper le PIB.
Dans son rapport, Attali écrit qu'"un point de croissance de plus signifie 500 euros de plus par ménage, par an, et 150.000 emplois supplémentaires". Poudre aux yeux, bien entendu. Comme s'il existait une répartition équitable des richesses produites, comme si la croissance ne profitait pas aux plus riches, comme si l'augmentation de la productivité n'était pas plus rapide que la croissance économique, comme si les emplois créés - quand ils le sont vraiment - n'étaient pas des emplois précaires. La majorité des nouveaux contrats de travail sont à durée déterminée. Les employeurs - y compris les plus "prestigieux", comme La Poste - n'hésitent pas à renouveler les CDD des dizaines, voire des centaines de fois, pour empêcher les salariés de participer à la croissance.
Le rapport Attali est une déclaration de guerre aux salariés, une exhortation à réaliser, plus vite, encore plus de contre-réformes (baptisées "réformes") et à démanteler toujours plus rapidement le secteur public au profit de la caste des prédateurs.
Alors, croissance (officielle) ou récession (officielle), le résultat est finalement le même pour la masse des citoyens. Les pays néo-capitalistes à fort taux de croissance, comme la Chine, sont les plus grands producteurs de misère et de pauvreté.
(En 2009, tous les pays occidentaux sont officiellement en récession. Les "experts" révisent leurs "prévisions" pratiquement chaque jour, en fonction des besoins de leurs employeurs ou commanditaires.)
La bourse
En mars 2008, malgré un net recul, la bourse ne s'est pas encore effondrée dans son ensemble. Lors du crash de 1929, le Dow-Jones perdit 40 % de sa valeur en une seule journée et continua de dégringoler pendant trois ans, passant de 300 points (maximum de 1929) à 41 points
(minimum de 1932). Pour obtenir un effet équivalent, il faudrait une baisse subite de 5.000 points (de 12.000 à 7.000) en une journée, suivie d'une glissade ininterrompue jusqu'au niveau de 2.000 points en 2011. On n'en est pas encore là.
Soit dit en passant, au cours des dernières décennies, c'est surtout l'ascension de l'indice boursier américain qui a été spectaculaire : 1.000 points en 1972, 2.000 en 1987, 3.000 en 1991, 5.000 en 1995, 8.000 en 1997, 10.000 en 1999, 14.000 en juillet 2007. La plus forte chute enregistrée en une seule séance pendant cette période a été de 22 % (en 1987). Le record de la Grande Dépression attend d'être battu.
Au cours de l'année 2009, les centaines de milliards de dollars de fonds publics injectés dans les circuits financiers pour "sauver les banques" alimentent en fait une nouvelle vague de spéculation boursière. La politique des taux d'intérêts proches de zéro accentue ce mouvement. Le Dow-Jones remonte, faisant oublier la crise. En mai 2013, il est à 15.000.
Février 2010 :
Et si on fermait la Bourse pour relancer l'économie par Frédéric Lordon.
"La Bourse finance les entreprises ? Au point où on en est, ce sont plutôt les entreprises qui financent la Bourse... Les capitaux levés par les entreprises sont devenus inférieurs aux volumes de cash pompés par les actionnaires, et la contribution nette des marchés d'actions au financement de l'économie est devenue négative (quasi nulle en France, mais colossalement négative aux Etats-Unis, notre modèle à tous)."
L'or et ses équivalents modernes
En mars 2008, l'once d'or (31 grammes) dépasse les 1.000 dollars* (en 1971, lorsque le dollar était encore indexé sur l'or, une once valait 35 dollars). Mais si la hausse des métaux précieux n'affecte pas trop la vie quotidienne, il en va autrement du pétrole et des céréales (voir un peu plus bas).
* En septembre 2008, le cours retombe à 750 dollars. En novembre 2009, il est proche de 1.200 dollars. Un an plus tard, il dépasse les 1.400 dollars. La barre des 1.500 dollars est franchie en avril 2011. En août de la même année, on frôle les 1.900 dollars.
Les réserves d'or des Etats
Fin 2007, les banques centrales détenaient un tiers de l'or de la planète, soit environ 50.000 tonnes. Les Etats-Unis en avaient 8.200 tonnes, le FMI 3.200, l'Allemagne 3.400, la France 2.700, l'Italie 2.500, la Suisse 1.200, etc...
Grâce au général de Gaulle (voir
plus haut),
l'or français est stocké dans les chambres fortes de la Banque de France, à 28 mètres de profondeur.

2.700 tonnes d'or (ou 218.000 lingots de 12,4 kg ou 400 onces)
représentent un volume de 140 m3, soit un cube d'un peu plus de 5 mètres de côté.
Valeur de ces 87 millions d'onces en août 2011 :
environ 165 milliards de dollars ou 120 milliards d'euros,
soit moins de 8 % de la dette publique française.
L'Allemagne, elle, a "confié" ses réserves d'or à la Fed des Etats-Unis. Elles sont, paraît-il, conservées à Fort Knox, un camp militaire situé dans le Kentucky, mais en fait personne ne les a jamais vues, et personne ne peut prouver qu'elles existent encore physiquement. Cela vaut d'ailleurs également pour les réserves américaines. Le bruit court que Fort Knox est vide ; le gouvernement américain n'a jamais apporté de démenti convaincant.
Il ne faut pas être devin pour comprendre que, dans ces conditions, toutes les arnaques sont possibles. La Fed, dépositaire officielle de l'or, peut très bien vendre le métal précieux à l'insu du déposant, puisqu'elle sait qu'il n'en réclamera pratiquement jamais la restitution. La chose fonctionne à merveille aussi longtemps que la banque centrale allemande (ou une autre) se contente d'un morceau de papier ou d'une confirmation électronique attestant qu'elle "possède" l'or. C'est le principe de base de la "philosophie" bancaire. L'or, qui à l'origine était censé matérialiser et garantir la valeur de la monnaie virtuelle, devient lui-même virtuel.
Si la Fed ne se l'approprie pas effectivement, elle peut l'utiliser, sans que l'Etat étranger n'en sache rien, pour "garantir", également de façon virtuelle, ses propres opérations ou celles de tiers. L'or, qu'il soit physiquement présent ou pas, peut aussi "servir" plusieurs fois simultanément pour "rassurer" des créanciers de la Fed (ou de n'importe quelle banque) qui ne savent rien l'un de l'autre et qui, surtout, n'ont aucun rapport avec le propriétaire légal des lingots. Les "certificats 100 % or" qui circulent de par le monde représentent un volume bien supérieur à tout l'or physique qui les "garantit" (soi-disant). Tout cela ne fonctionne que dans la mesure où les titulaires de ces certificats ne réclament pas leur or tous en même temps. S'ils le faisaient, ils s'apercevraient bien vite que la fameuse "garantie" est sans valeur.
Pour l'or des banques centrales entreposé auprès de la Fed ou des banques de la City, la chose n'est pas très différente en principe. Lorsque le Venezuela a exigé la restitution de son or en août 2011
(voir plus bas),
les dépositaires ont poussé des cris, proféré des menaces et pris des mesures de rétorsion. Où allons-nous si tout le monde se met à imiter de Gaulle et Chávez ?... (Le cas de la Libye, propriétaire de 140 tonnes d'or déposé à Londres, a été réglé en deux coups de cuillère à pot en mai 2011. Tout a été "confisqué", ce qui évite de rendre des comptes - pratique...)
Malgré tout cela, et même si un seul lingot de 12,4 kg vaut autant qu'une maison individuelle, les apparences sont trompeuses. Tout l'or des banques centrales, qu'il soit réel ou virtuel, "ne pèse pas lourd" en comparaison des sommes astronomiques manipulées et détournées par la finance internationale.
Le pétrole, les céréales et le reste
En janvier 2008, le cours du baril de pétrole (159 litres) atteint la barre des 100 dollars. En avril il est à 120 dollars, en mai à 135 (30 dollars cinq ans plus tôt). Le prix de l'essence atteint de nouveaux sommets. Les céréales connaissent une évolution tout aussi dramatique : en trois ans, le prix du blé et de l'orge augmente de 175 %, celui du maïs de près de 100 %.
La flambée des cours est purement spéculative en ce qui concerne le pétrole. Pour les céréales, elle est attisée en grande partie par
l'hystérie climatique.
Sous prétexte d'enrayer le réchauffement (une idée aberrante), une part toujours plus grande des céréales produites est utilisée pour fabriquer du carburant. Si les conséquences sont déjà graves dans les pays développés, elles sont catastrophiques pour le tiers-monde.
The Reason For Soaring
Oil Prices par F. William Engdahl - Pourquoi les cours du pétrole s'envolent.
Lorsque le baril était à 128 dollars, on pouvait déjà dire que 60 % de ce prix étaient imputables à la spéculation des hedge funds, banques et groupes financiers opérant sur les marchés à terme de Londres et de New York, ou négociant de gré à gré pour ne pas attirer l'attention. (Et il ne s'agit là que du prix du brut, pas du prix du litre d'essence avec toutes ses taxes. Suivant le pays, la charge fiscale et la prime à la spéculation peuvent représenter ensemble jusqu'à 80 % du prix à la pompe.)
Selon les régles américaines, pour acheter du pétrole à terme, il suffit de disposer de 6 % de la valeur du contrat. L'effet de levier permet ainsi de se porter acquéreur de seize fois plus de pétrole qu'on ne le ferait en achetant au comptant. Comme tous les spéculateurs le font, il est évident que les cours montent, et montent, et montent... Cette évolution n'a rien à voir avec la demande de pétrole réel, puisque celle-ci est stagnante, voire en recul. Si les marchés étaient transparents et fonctionnaient véritablement selon la loi de l'offre et de la demande, les cours baisseraient dans la situation actuelle.
Dans un rapport commandé par le Sénat français en novembre 2005 et cité par Bruno Adrie sur le site de
Michel Collon,
il est dit que
"depuis quelques années la part respective des différents marchés a considérablement évolué. Aujourd'hui, les transactions sur le marché physique représentent 165 millions de barils par jour ; celles sur le marché des futures, 500 millions de barils par jour et celles sur le marché des OTC (de gré à gré), 1 milliard de barils par jour. Les volumes d'échanges sur le marché papier sont désormais neuf fois plus importants que ceux sur le marché physique."
Les médias mettent l'explosion des marchés sur le compte du
"pic pétrolier" (une supercherie au même titre que le "réchauffement" climatique) ou incriminent l'OPEP, les Arabes et les Chinois. Les véritables responsables ne sont jamais nommés.
Les géants de la finance manipulent les marchés et fixent les cours entre eux, à huis clos.
Comme dans bien d'autres domaines, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank ou UBS sont étroitement mêlés à la spéculation. La bourse londonienne ICE Futures Exchange, numéro un mondial pour le pétrole, appartient à l'International Commodities Exchange d'Atlanta (Géorgie), une bourse fondée par Goldman Sachs. Et comme par hasard, Goldman Sachs gère le GSCI, l'indice le plus couramment utilisé pour les matières premières, dans lequel le pétrole est prédominant. Quand Goldman Sachs dit que le baril sera bientôt à 200 dollars, il faut comprendre : "Nous allons le faire grimper à 200 dollars."
Comment GS contrôle et manipule les instances gouvernementales américaines :
Goldman Sachs - La grande machine à bulles - voir "Bulle n° 4 ---
4 $ le gallon".
Ne demandez surtout pas si Goldman Sachs est un groupe financier juif : 1) ce serait "antisémite" ; 2) il pourrait aussi bien s'agir de Lapons ou de Papous et 3) ce n'est tout de même pas leur faute s'ils comptent parmi les fondateurs de la Fed.
Comme disait Jacques Attali (sioniste "de gauche") en 2002, dans son livre Les Juifs, le monde et l'argent : "Les Juifs ont inventé le capitalisme... Ils ont toutes les raisons d'être fiers de cette partie de leur histoire."
L'objectif du Groupe de Bilderberg : le baril à 200$
par Paul Joseph Watson : "En promouvant les théories du pic pétrolier et en les combinant avec l'arnaque du réchauffement climatique causé par l'homme, Bilderberg cherche à augmenter les prix du pétrole jusqu'à ce que les standards de vie des classes moyennes ne puissent plus se maintenir, plongeant alors l'Occident dans le Quart-monde, pendant que les élites en récolteront les bénéfices financiers et politiques." (Bilderberg est un club oligarchique très fermé et très influent.)
Fin mai 2008, avec le baril à 135 dollars*, la démagogie bat son plein. Des députés démocrates américains proposent d'imposer aux spéculateurs l'obligation de prendre matériellement livraison du pétrole qu'ils achètent : la hausse serait stoppée instantanément. Or, le propre des marchés à terme, c'est justement qu'ils permettent d'acheter et de vendre des contrats sans se préoccuper des biens physiques qu'ils représentent. On achète des matières premières et on les revend avec profit sans jamais les avoir vues. Comme les démagogues du Congrès n'ont nullement l'intention de fermer les marchés à terme (ce serait du communisme, de l'antiaméricanisme et de l'antisémitisme), leur revendication est tout simplement de la poudre aux yeux.
* En juillet 2008, on frôle les 150 dollars. En septembre, on retombe à 100 ; en octobre, on repasse en dessous de 70 ; en novembre, en dessous de 50. Un an plus tard, en novembre 2009, le cours remonte à 80 dollars. En avril 2011, on est à plus de 110 dollars.
George Soros, multimilliardaire sioniste "de gauche" (lui aussi), enrichi grâce à la spéculation, découvre subitement qu'il existe une "bulle du pétrole". Quelle clairvoyance !... Encore un petit effort, et il nous expliquera que cette bulle est alimentée par les sommes astronomiques que la Fed a pompées dans les circuits financiers.
En Allemagne, des sociaux-démocrates en perte de vitesse essaient de récupérer quelques voix en demandant l'interdiction des transactions à terme sur le pétrole. Comme les bourses incriminées se trouvent toutes en dehors de leur pays, ils ne risquent pas grand-chose. Horst Köhler, le président de la République, déplore pour sa part que le capitalisme moderne soit devenu "monstrueux". C'est assez drôle d'entendre une chose pareille de la part d'un ancien patron du FMI - qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour se faire réélire l'année prochaine.
Et même Sarkozy, qui n'a probablement jamais fait lui-même le plein d'essence au cours des vingt dernières années, promet d'aider les Français les plus touchés par la crise du pétrole. Il va certainement faire de nouveaux cadeaux aux grosses entreprises de transport.
Début juin 2008, plusieurs ministres des finances de l'UE ont une idée géniale : "taxer davantage les bénéfices des groupes pétroliers" - pour que la nouvelle taxe soit aussitôt répercutée sur les prix.
(La hausse brutale des prix du pétrole a toujours été la conséquence de la spéculation et non d'une baisse de l'offre, même lors des deux "chocs" de 1973 et 1979. La guerre du Kippour et les mesures relativement modestes de l'OPEP, dans le premier cas, et la révolution iranienne, dans le second, n'ont été que les prétextes permettant aux géants de l'or noir et de la finance de s'enrichir démesurément.)
Les hedge funds
"Les hedge funds sont le trou noir de la finance mondiale." (Le Monde - 22.9.08)
Ce sont, à l'origine, des fonds d'investissement découplés des marchés boursiers, dans le but d'éviter les risques qui en découlent et de maximiser les taux de rendement (en anglais, hedge est une haie, qui est censée ici protéger le fonds de tous les remous extérieurs).
En réalité, ou entre-temps, ces fonds sont au cœur des marchés et incarnent la spéculation. S'ils sont eux-mêmes protégés, rien ni personne ne protège le monde environnant de ces requins de la finance : aucune loi, aucune réglementation, aucun contrôle - c'est le laissez-faire total, la jungle.
Les hedge funds interviennent sur de nombreux marchés : actions, obligations, dérivés, devises, matières premières, immobilier et même œuvres d'art. Les acquisitions, fusions et destructions d'entreprises sont devenues une des activités essentielles des hedge funds dans les années 1990, de même que la reprise de biens publics privatisés. Mais c'est la spéculation massive contre une monnaie ou un pays donné qui a surtout fait parler d'eux.
En 1992, George Soros*, avec un de ses hedge funds, a gagné un milliard de dollars en misant sur la baisse de la livre sterling. La Banque d'Angleterre, incapable de faire face, a dû alors quitter le Système monétaire européen. En 1997, pendant la crise asiatique, Soros a spéculé de manière analogue contre le ringgit, la monnaie malaisienne. D'autres hedge funds ont été mêlés aux effondrements économiques survenus à cette époque au Mexique, au Brésil, en Russie et dans divers pays d'Asie, ainsi qu'aux rachats de dettes qui ont suivi.
* Cet
article
contient quelques détails intéressants sur l'empire financier de Soros et sur ses multiples connexions et relais : Richard Katz (groupe Rothschild), Nils Taube, George Karlweiss, Laurent Murawiec, Marc Rich, Lewis Libby, Shaul Eisenberg, Rafi Eytan. Parmi les noms cités, on trouve pêle-mêle des banquiers, des escrocs, des politiciens véreux et même des terroristes. Et par le plus grand des hasards, il se trouve que tous ces gens sont juifs et sionistes.
John Paulson, le numéro un des patrons de hedge funds, a tiré de ses activités un profit personnel de 3,7 milliards de dollars en 2007* (milliards, pas millions). Cela correspond à un salaire mensuel de 308 millions ou à un salaire horaire de 1.900.000 dollars (1.200.000 euros). Le PDG de la Deutsche Bank, un des mieux payés de toutes les grandes entreprises européennes, avec 14 millions d'euros annuels, gagne 165 fois moins que Paulson. 3,7 milliards de dollars par an (2,3 milliards d'euros), c'est 150.000 fois le SMIC ou la masse salariale d'une grande entreprise. C'est aussi le PIB de pays comme la Moldavie, le Laos ou le Niger, qui comptent respectivement 4 millions, 6 millions et 15 millions d'habitants !
* Trois ans plus tôt, le patron de hedge funds le mieux rétribué du monde gagnait un milliard de dollars - ce qui donne une augmentation régulière de 56 % chaque année.
Le numéro 2 de 2007 (George Soros) s'est fait 2,9 milliards de dollars, le numéro 3 (James Simons) 2,8 milliards. Les 50 premiers ont gagné, ensemble, 29 milliards.
D'où proviennent ces sommes astronomiques ? Selon le New York Times, Paulson, comme d'autres patrons de hedge funds, a misé sur la baisse des titres hypothécaires adossés à la bulle immobilière... et il a gagné. Ce faisant, il a naturellement contribué à l'éclatement de cette bulle, même s'il n'en porte pas l'entière responsabilité. Un des fonds de Paulson a réalisé 590 % de profit en 2007.
Les hedge funds représentaient une valeur totale de 1.800 milliards d'euros en 2007 (+ 700 % en dix ans). Ils ont en général très peu de capitaux propres et travaillent avec l'argent que leur confient quelques "investisseurs" fortunés triés sur le volet. Ils emploient très peu de personnel. Quoi qu'il arrive, ils sont assurés de toucher une commission de gestion d'au moins 2 % des sommes engagées. Pour un milliard, cela fait 20 millions, qui reviennent presque entièrement au boss. Et quand ils ont la main heureuse - ce qui est très fréquent - les patrons de hedge funds reçoivent en outre 20 % de tous les gains. Mais ce n'est pas tout : en 2007, le Congrès (à majorité démocrate) a voté une loi exonérant ces milliardaires de l'impôt sur le revenu. A la place, ils sont assujettis à la taxe sur les gains de capital, qui est de seulement 15 %. Autrement dit, ils paient proportionnellement moins d'impôts que leur femme de ménage.
Inutile d'ajouter que les hedge funds spéculent également - mais dans l'autre sens - sur tous les marchés lucratifs en ces temps de crise économique et financière (pétrole, métaux, céréales, etc...) et qu'ils sont en grande partie responsables des hausses continuelles enregistrées dans ce secteur.
Comme il se doit, les trois premiers patrons de hedge funds (Paulson, Soros et Simons) sont juifs et sionistes - et "philanthropes" (ils consacrent 1 % de leurs revenus au financement des "bonnes œuvres" de leur Etat voyou préféré). Trois sur trois, c'est un bon ratio, aussi bon que celui de la Fed (cinq sur cinq).
Novembre 2010 :
L'UE et les hedge funds -
"La nouvelle directive est une passoire qui aura un effet inverse à celui qui est annoncé. Son objectif réel est de contrôler sommairement les fonds européens, tout en ouvrant la porte aux fonds états-uniens qui, eux, pourront spéculer sans limite au détriment des Européens."
Les private equity funds
Ces fonds de capitaux privés se distinguent à peine des hedge funds, si ce n'est qu'ils ont la réputation de se comporter de manière un plus un peu plus "civilisée" (et d'être un peu moins rentables). Mais beaucoup de hedge funds sont la propriété de groupes financiers de type private equity - parfois en partie, parfois en totalité.
Le Carlyle Group est considéré comme le n° 1 des private equity funds. KKR (le n° 2) et Blackstone (le n° 4) sont également assez connus, mais quand on entend parler d'eux, c'est rarement en bien. D'autres fonds similaires sont (ou étaient) liés à des groupes bancaires comme ABN-Amro, Goldman Sachs ou Lehman Brothers.
David Rubenstein, un des fondateurs de Carlyle, estime que les fonds de capitaux privés vont, à l'avenir, se "démocratiser" en se transformant en sociétés cotées en bourse. Blackstone l'a déjà fait, Carlyle attend la fin de la crise pour le faire. Si c'était le cas, la distinction entre private equity et hedge deviendrait claire.
En attendant, on a déjà vu des fonds (de l'une ou de l'autre catégorie) s'emparer d'une entreprise par le biais d'une minorité de contrôle acquise avec de l'argent emprunté, contraindre la direction à verser un dividende exceptionnellement élevé, puis obliger les dirigeants à endosser les dettes contractées pour l'acquisition. Ce qui, bien entendu, ne peut que conduire l'entreprise à la ruine, et son personnel à la rue. Et il n'est pas rare que de tels abus soient accompagnés de dégrèvements fiscaux et de subventions publiques - pour "stimuler l'investissement" et "sauver l'emploi".*
* A propos de ce genre d'opération, on utilise parfois le terme LBO (ou leveraged buy-out) que Wikipédia définit ainsi : "Financement d'acquisition par emprunt, consistant à racheter une entreprise en ayant recours à l'endettement bancaire en engendrant un effet de levier facilitant l'acquisition et la défiscalisation du projet."
Ces agissements mafieux rappellent un peu les activités de Bernard Tapie ("Tapie violent") lorsqu'il "redressait" des entreprises moribondes avant de les enterrer et d'empocher l'héritage. Tapie se disait "de gauche", comme George Soros.* Mais en comparaison du pillard américano-israélo-hongrois, il opérait à un niveau relativement modeste. Et comme il ne bénéficiait pas du bouclier sioniste, on n'a pas eu de scrupules à le condamner en 1996. Soros et ses semblables, eux, ne risquent rien et peuvent continuer en toute impunité. Vous ne voudriez tout de même pas que la justice soit antisémite...
* Entre-temps, Tapie soutient Sarkozy. Soros, lui, n'a jamais soutenu ouvertement Bush (mais n'a rien fait non plus pour le combattre). Pour récompenser Tapie, Sarkozy a fait intervenir, en 2008, sa ministre de l'Economie Christine Lagarde (plus tard directrice générale du FMI) afin que son nouveau protégé obtienne le versement de 285 millions d'euros de fonds publics dans une affaire l'opposant à l'ancien Crédit Lyonnais.
Liste des principaux Private Equity Funds
Liste des plus grandes banques
Liste des plus grandes entreprises
"Un paradoxe à l'ère des privatisations : les fonds d'investissement détenus par des Etats et des banques centrales - joliment appelés « fonds souverains » - ont opéré leur entrée en force dans le capital des multinationales, notamment financières." :
Les fonds souverains - prédateurs, sauveurs ou dupes ?
Le cross-border leasing
A la fin des années 1990 et au début des années 2000, il existait une autre forme d'arnaque très lucrative pour les fonds vautours : le cross-border leasing (CBL) ou crédit-bail transfrontalier. La chose consistait pour un fonds américain (ou une de ses filiales) à acheter à crédit à une commune (ou entreprise publique) étrangère des biens lui appartenant (réseau de transports, d'électricité, d'approvisionnement en eau, station d'épuration, centre de congrès ou autre édifice public, logements sociaux) et à redonner immédiatement ces mêmes biens en location au vendeur. Le fonds bénéficiait alors, selon la loi américaine, d'un avantage fiscal en tant qu'investisseur à l'étranger, et faisait croire au vendeur qu'il allait lui rétrocéder une partie de cet avantage.
Les vendeurs-locataires municipaux, alléchés par un acompte substantiel, supérieur au premier loyer à verser, acceptaient de signer tout ce qu'on leur demandait, sans rien comprendre au contenu du contrat. Ce contrat, mis au point par des juristes new-yorkais, était si volumineux et si complexe, qu'aucun maire, conseiller municipal ou avocat mandaté par eux n'était en mesure d'en évaluer les conséquences. D'ailleurs, dans la plupart des cas, aucun responsable local n'avait eu le contrat sous les yeux - contrat bien entendu rédigé en anglais et soumis à la loi américaine, avec pour tribunal compétent un tribunal des Etats-Unis (ou d'un paradis fiscal des Caraïbes). Pour le cas où quelqu'un aurait été trop curieux, le contrat comportait une clause de confidentialité interdisant au vendeur d'en dévoiler les détails. Parfois même le nom de l'"investisseur" devait être tenu secret, de même que le nom des banques et compagnies d'assurances (souvent américaines) liées à l'opération*.
Des centaines de villes et entreprises publiques européennes (de préférence dans les anciens pays de l'Est, mais aussi en Allemagne, en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas et en France**) ont signé de tels contrats.
* Inutile de préciser que certaines de ces banques et compagnies d'assurances (par exemple AIG) ont été "touchées" par la crise financière (qu'elles ont elles-mêmes provoquée) et que ce sont les vendeurs européens qui en font les frais.
** En France : SNCF et RATP.
En 2004, comme il fallait s'y attendre, les autorités américaines déclarèrent qu'un montage de type CBL n'avait rien d'un investissement à l'étranger et qu'il ne pouvait donc pas bénéficier de l'exonération fiscale. Les fonds vautours, qui avaient prévu la chose, invoquèrent une clause que personne n'avait lue et répercutèrent le nouvel impôt aux communes étrangères. Du coup, l'opération perdait tout son intérêt pour celles-ci.
Résultat : ou bien les villes flouées allaient se lancer dans de longs procès extrêmement coûteux et sans issue (à New York, la plupart des avocats et beaucoup de juges sont juifs, comme les patrons de fonds - quelle coïncidence), ou bien elles acceptaient leur sort et continuaient, pendant 20, 30 ou 99 ans, à payer le prix fort pour un bien qui ne leur appartenait plus, tout en percevant* de trimestre en trimestre des sommes bien inférieures au prix de la location. Pour parfaire le tout, il va de soi que les frais d'entretien et de réparation du bien cédé restent à la charge des communes. Et à l'issue du contrat, il n'est pas exclu qu'un nouveau propriétaire (ou un nouveau locataire) vienne demander des comptes aux vaches à lait communales.
* A condition que la banque ou société fiduciaire (trustee) chargée par l'"investisseur" d'effectuer les paiements au vendeur, ne soit pas elle-même tombée en faillite - c'est arrivé en 2008. La faillite du trustee ne dispense par le locataire de payer son loyer, puisqu'il s'agit de deux opérations et de deux sociétés juridiquement distinctes.
Les emprunts structurés
Moins sophistiqués que le cross-border leasing mais pratiquement aussi dangereux pour les collectivités locales, les emprunts structurés (ou emprunts toxiques) sont une spécialité de la banque franco-belge Dexia, un établissement issu de la privatisation (dans les années 1990) du Crédit Communal de Belgique et du Crédit Local de France.
Avec sa réputation plus que centenaire d'établissement sérieux ayant pour vocation de satisfaire les besoins financiers des communes dans le respect de l'intérêt général, Dexia a su endormir la confiance de ses clients en leur proposant, au lieu de prêts classiques et éprouvés, des "produits financiers innovants" concoctés par elle. A première vue, ces prêts d'un nouveau genre étaient moins chers pour les communes : "C'est l'avantage de la privatisation, Monsieur le Bourgmestre... Signez ici, s'il vous plaît..." Et on signait les yeux fermés un contrat contenant une clause incompréhensible qui stipulait que le "taux fixe" serait majoré en fonction du niveau futur de tel ou tel indice boursier n'ayant rien à voir avec le crédit. Les banquiers parlaient de "Step-in Step-out Collar", de "Triple Floor Fixed Rate", de "CMS Spread" ou encore de "taux lié, en-dessous de la barrière, à la pente de la courbe des taux", sans être capables d'expliquer clairement de quoi il s'agissait - si l'emprunteur avait compris, il n'aurait pas signé.
Résultat : ce n'est plus 4 % que les villes doivent payer, mais 6, 12 ou 24 %. Et comme Dexia a entre-temps titrisé beaucoup de ses crédits toxiques, la facture ne sera pas nécessairement présentée par cette banque, mais par n'importe quel créancier ou "investisseur" étranger.
Bien sûr, Dexia n'est pas un cas unique ; d'autres banksters l'ont imitée, à commencer par la Deutsche Bank (en France : la Société Générale, le Crédit Agricole et les Banques Populaires).
Plusieurs municipalités françaises victimes de cette nouvelle forme d'escroquerie (Saint-Etienne*, Rouen, Laval, Brest, Lille et des communes de Seine-Saint-Denis) ont annoncé leur intention de poursuivre en justice les banques qui leur ont octroyé ces prêts sans les informer des risques. Les chances de voir les tribunaux condamner les arnaqueurs sont bien minces.
* Pour la ville de Saint-Etienne, dont l'emprunt contracté auprès de la Deutsche Bank était assorti d'une indexation sur la parité livre sterling-franc suisse, la baisse de la monnaie britannique a fait grimper le taux de 4,3 % à 24 %.
(Dexia a bénéficié en septembre-octobre 2008 de plus de 6 milliards d'euros d'aide publique. Quelques semaines plus tard, on apprenait que la banque franco-belge finançait les colonies juives de Palestine - à des taux fixes préférentiels, bien entendu, faut quand même pas être antisémite...)
Stupid German money
Dans les années 1990 et jusqu'en 2006, un régime fiscal très spécial permettait aux investisseurs allemands de faire valoir auprès de leur administration une perte fictive de 100 % (et parfois même davantage) pour toute acquisition de parts dans un fonds destiné à financer une production cinématographique aux Etats-Unis. Autrement dit, des nantis imposables en Allemagne (mais pas nécessairement imposés) fournissaient à Hollywood de l'argent provenant en grande partie du fisc. Grâce à cette aide aussi généreuse qu'involontaire du contribuable allemand, les producteurs pouvaient se permettre de ne pas rémunérer les capitaux reçus, voire même de ne les rembourser que partiellement. Les pourvoyeurs de "stupid German money", comme on disait alors à Hollywood, étaient néanmoins assurés de retrouver leur mise augmentée d'un honnête profit.
Rien que de 2000 à 2005, on a collecté de la sorte douze milliards de dollars, dont une bonne partie en tant que cadeau fiscal. En 2003, plus de 20 % des capitaux investis à Hollywood provenait d'Allemagne. 46 productions sur 157 nominées pour un Oscar ont vu le jour grâce à de l'argent allemand prêté au taux de 0 %.
On imagine les milliardaires et multimillionnaires juifs d'Hollywood pliés en deux à la pensée de faire financer par ces pauvres cons d'Allemands la production de tous ces navets, y compris et surtout ceux dédiés au culte de l'Holocauste®. On voit que l'industrie du même nom ne consiste pas seulement à verser de l'argent à Israël - loin de là.
Et pendant ce temps, le cinéma allemand, à l'exception de quelques réussites comme Cours, Lola, cours ou Good-bye Lénine, était en crise quasi-permanente et presque toujours en manque de fonds.
Oubliez tous les critères
Il n'y a pas si longtemps, l'Europe - qu'il s'agisse de l'UE ou de la zone euro - se présentait comme un modèle de gestion avisée et ne manquait jamais de faire la leçon aux candidats à l'admission.
Combien de fois n'a-t-on pas entendu invoquer les critères de Maastricht (taux d'inflation ne devant pas dépasser de plus de 1,5 point celui des trois meilleurs pays, dette publique totale obligatoirement inférieure à 60 % du PIB, déficit budgétaire annuel inférieur à 3 %*) ?
Combien de fois les technocrates de Bruxelles n'ont-ils pas reproché à tel ou tel Etat membre de subventionner ses entreprises ou de tarder à privatiser son secteur public ?
Depuis le début de la crise, tous ces critères sont oubliés. On recapitalise les banques, on les nationalise partiellement, on les inonde de centaines et de centaines de milliards. On reproche même à la Banque centrale européenne de trop vouloir combattre l'inflation au détriment de la croissance. L'indépendance de la BCE est un autre de ces principes jetés par-dessus bord.
* Pour 2010 on signale, en France, un déficit budgétaire de 8,5 % du PIB. Pour ce qui est de l'endettement public total, il est question de 82 % du PIB. Les autres pays européens affichent des taux comparables ou supérieurs : Allemagne 79 %, Belgique 100 %, Italie 116 %, Grèce 125 % (les USA annoncent 90 %, le Japon 200 %). Mais la fiabilité de ces chiffres est plus que douteuse. Pratiquement du jour au lendemain, on "découvre" ainsi que l'endettement de la Grèce est de 160 % et peut-être même de 200 %. Selon les besoins du moment, les spéculateurs et leurs complices des milieux politico-médiatiques peuvent épingler n'importe quel pays (par exemple l'Italie, fin 2011) et prétendre que sa dette s'est subitement accrue de façon astronomique - ce qui nécessite bien sûr des coupes drastiques dans les budgets sociaux. La comptabilité nationale s'apparente de plus en plus à des comptes d'apothicaire. Le taux d'endettement (réel ou imaginaire) est devenu une arme financière de destruction massive utilisée contre les Etats et la masse des citoyens.
Crise passagère ou systémique ?
Le monde de la finance, de la politique et des médias a beau nous suggérer, au printemps 2008, que les banques sont tout simplement confrontées à des problèmes de liquidité qui ne tarderont pas à se résoudre dès que la confiance sera rétablie, les mauvaises surprises quotidiennes donnent à penser qu'il s'agit en fait d'une crise beaucoup plus profonde, affectant la solvabilité de tout le système. Si l'abcès n'éclate pas maintenant, cela risque de se produire plus tard - dans trois mois ou dans deux ans.
Il n'y a aucune raison, a priori, pour que les autorités entreprennent quoi que ce soit pour assainir les marchés, puisqu'elles constituent elles-mêmes une partie du problème. Etant au service de l'oligarchie financière, elles se sont appliquées à satisfaire les exigences de celle-ci au cours des années écoulées. Aujourd'hui, par banques centrales interposées, elles déversent de l'argent frais par centaines de milliards sur les marchés - notre argent, cela va de soi.
Il est évident que cette crise, qui n'a rien d'une catastrophe naturelle mais tout d'un coup monté, va être l'occasion d'effectuer de nouvelles coupes et de nouvelles "réformes" antisociales. Comme l'a bien montré Naomi Klein dans son livre The Shock Doctrine - The Rise of Disaster Capitalism (2007), il faut que la société soit affaiblie et démoralisée pour mieux faire passer le traitement de choc (à la fois économique et politique) que le capitalisme de catastrophe nous réserve, conformément à la doctrine formulée par l'économiste américain Milton Friedman (juif sioniste lui aussi - pure coïncidence).
La question qui se pose, en 2008, est de savoir si la nouvelle secousse financière est un simple avatar des crises des décennies précédentes (la dernière en date étant celle du Nouveau marché, en 2000) ou si, au contraire, nous assistons à la naissance du cataclysme ultime, le vrai de vrai qui balaiera tout sur son passage...
En marge de la crise : l'affaire Eliot "Ness" Spitzer
Le 12 mars 2008, Eliot Spitzer, gouverneur de New York et ancien ministre de la Justice de cet état, est contraint à la démission suite à une affaire de mœurs tout à fait ridicule (il fréquentait des prostituées). Les médias en font des gorges chaudes, insistant sur le fait que le Client # 9 de ces dames ne manquait pas, entre deux escapades, de jouer à l'irréprochable Mister Clean.
En fait, si Spitzer, comme tout homme politique qui "se respecte", faisait le contraire de ce qu'il prêchait, ce n'est pas pour cette raison qu'il est tombé victime de la chasse à courre. En bonne logique, il aurait même dû bénéficier de l'indulgence de la presse : en sa "qualité" de Juif sioniste, il était à l'abri de toute attaque personnelle (nécessairement "antisémite").
Comme le rappelle le Réseau Voltaire, Eliot Spitzer était même "l'espoir de la communauté juive US, qui l'imaginait un jour en président des Etats-Unis. Brillant juriste, il avait été l'assistant à Harvard d'Alan Dershowitz, le conseiller juridique de l'Etat d'Israël." (Dershowitz est une ordure judéo-fasciste de premier ordre, partisan et justificateur de la torture, raciste et islamophobe, défenseur n° 1 de toutes les guerres sionistes passées, présentes et futures : Afghanistan, Irak, Palestine, Liban, Syrie, Iran, Darfour, etc...)
Le problème, c'est que même un Juif sioniste "espoir de la communauté" ne peut pas tout se permettre aux Etats-Unis. En particulier, il n'a pas le droit de mettre en cause les intérêts de l'oligarchie financière qui, comme chacun sait, est pour moitié juive. Or, Eliot Spitzer se prenait un peu trop pour le successeur d'Eliot Ness, ce flic incorruptible qui pourchassait les trafiquants d'alcool à l'époque de la Prohibition, lorsque le mafieux juif Sam Bronfman amassait les millions et bâtissait l'empire Seagram grâce à son whisky frelaté.
Oui, Spitzer s'était permis de mener une enquête sur le sort du fonds de pension de la ville de New York, géré par l'Israélo-Américain Alan Hevesi. Ce fonds de plus de 10 milliards de dollars avait investi dans le Carlyle Group des Bush-Ben Laden (en difficulté depuis le
14 mars 2008).
Hevesi aurait utilisé le fonds de pension pour s'enrichir, lui et ses amis (chose encore plus banale, dans ces milieux, que de faire appel à des call-girls). Finalement, Hevesi a plaidé coupable et s'en est tiré avec une amende de 5.000 dollars - avec des avocats et des juges "de la communauté", pas de problème.
Qui plus est, en 2005-2007, Eliot Spitzer a dirigé une enquête portant sur les comptes secrets du Congrès juif mondial (dont le multimilliardaire Edgar Bronfman, fils de Sam Bronfman, est le patron). Le CJM est de toutes les arnaques, et pas seulement dans le cadre de l'Industrie de l'Holocauste. Bien entendu, ce n'est pas cet aspect particulièrement nauséabond des activités du Congrès juif, que Spitzer a voulu dévoiler. Plus modestement, il s'est contenté d'éclairer une affaire de détournement de fonds de 5 millions de dollars par l'ancien secrétaire général Israël Singer (une broutille - le chantage à l'Holocauste rapporte au bas mot des dizaines de milliards).
Autre chose : le 14 février 2008, moins d'un mois avant sa démission forcée, le gouverneur Spitzer avait écrit un article dans le Washington Post, mettant en cause les méthodes de prédateur employées par les prêteurs hypothécaires ("predatory lending practices by mortgage lenders"). Parmi ces méthodes : dissimulation des conditions réelles du crédit, prêts consentis sans se préoccuper de l'aptitude des emprunteurs à rembourser, taux "avantageux" destinés à attirer la clientèle mais augmentés de façon astronomique quelque temps plus tard, "forfaits" contenant des "services" douteux dont le prix n'est pas révélé à la signature, ristournes illégales, etc.
Comme il n'existait pas de législation fédérale interdisant ces pratiques, écrit Spitzer, l'état de New York et plusieurs autres états ont édicté une réglementation en ce sens. Qu'a fait alors l'administration Bush ? Elle a pris des mesures pour interdire aux législateurs locaux de protéger leurs citoyens contre la menace des prédateurs immobiliers. Bush est là pour protéger les banques, pas les emprunteurs... On imagine que de nombreux banquiers "de la communauté" ont dû voir rouge en lisant l'article du gouverneur (la Maison Blanche, évidemment, ne fait rien sans les consulter).
Durant sa carrière, Eliot Spitzer n'a pas cessé de cibler les géants de Wall Street et a gagné de nombreux procès contre Bear Stearns, Goldman Sachs, JPMorgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, le Crédit Suisse, l'UBS et la Deutsche Bank. Il n'a pas hésité à attaquer les pollueurs de la grande industrie et les exploiteurs des grandes chaînes de distribution Alors, cette "histoire de cul" pour le faire tomber, c'est assez drôle...
Le journaliste investigateur américain Wayne Madsen signale que le fameux "Emperor's VIP Club", qui a coûté son poste à Spitzer, est étroitement surveillé par les services américains de renseignement et qu'il sert de couverture au Mossad (le gouverneur aurait pu s'en douter). Un autre journaliste americain, Greg Palast, rappelle que les médias alignés ont davantage parlé des 4.300 dollars versés par Spitzer pour ses visites au "club", que des 200.000.000.000 de dollars gracieusement offerts par Bernanke aux spéculateurs. Spitzer a tout payé de sa poche, tandis que les largesses de Ben Shalom à ses amis vont longtemps peser sur les contribuables américains et - mondialisation aidant - sur beaucoup d'autres habitants de la planète, y compris ceux qui n'ont jamais entendu parler de subprime ou de Fed.
Chronologie de la crise
15 mars 2007 : Faillite de New Century Financial, une société spécialisée dans le crédit hypothécaire "subprime". Ce n'est pas la première faillite de ce genre, mais la plus importante. Auparavant, il y a déjà eu ResMae, Fremont General et une trentaine d'autres cas. Les subprimes sont des crédits qui n'auraient jamais dû être accordés, car les débiteurs, souvent très modestes, n'ont pas la "surface" financière voulue.* Un remboursement normal n'est possible que si les revenus de l'acheteur ne chutent pas pour cause de perte d'emploi, et si le taux d'intérêt relativement avantageux garanti au départ pour deux ans, n'augmente pas sensiblement dès que cette période est écoulée. Deux conditions difficiles, sinon impossibles à réaliser. En cas de liquidation forcée au moment où la bulle de l'immobilier se dégonfle, le bien hypothéqué se déprécie fortement et une vente ne rapporte plus assez pour compenser les dettes. Des millions d'Américains sont tombés dans ce piège.
* Avant de précipiter ses clients dans la misère, le marchand d'hypothèques n'a pas manqué de jouer le philanthrope qui permet à des Américains pauvres de se hisser au-dessus de leur condition en accédant à la propriété (argument standard de ces bonimenteurs).13 juin 2007 : Dans le Washington Post, Steven Pearlstein et Robert Samuelson (journalistes proches des milieux de la haute finance) écrivent que "le crash de l'économie américaine a commencé" et annoncent "la fin du crédit bon marché". (Pour l'Américain moyen, le crédit n'a jamais été "bon marché". La menace de Pearlstein-Samuelson rappelle un peu l'avertissement lancé aux automobilistes, comme quoi le prix de l'essence ne restera pas longtemps au niveau "ridiculement bas" auquel il se trouve aujourd'hui. Gageons que les deux journalistes n'ont pas de problèmes de crédit lorsqu'ils veulent s'acheter une villa dans les Hamptons.)
25 juin 2007 : La Banque des Règlements Internationaux, banque des banques centrales, met en garde contre les dangers d'une nouvelle Grande Dépression comparable à celle des années 1930.
Début août 2007 : La banque WestLB de Düsseldorf annonce 2 milliards d'euros de pertes en rapport avec les subprimes américains. D'autres banques allemandes (SachsenLB, IKB) sont également touchées. Aux Etats-Unis, American Home Mortgage Investment, organisme de refinancement des prêts hypothécaires, fait faillite. Countrywide Financial est en difficulté.
10 août 2007 : Intervention des banques centrales pour contrer le manque de liquidités dû à la crise de l'immobilier américain. La BCE injecte 156 milliards d'euros en deux jours, la Fed 38 milliards de dollars. La banque centrale japonaise intervient également.
14 septembre 2007 : La banque anglaise Northern Rock, victime de la crise hypothécaire, est sauvée de justesse par la Banque d'Angleterre. Elle sera nationalisée quelque temps plus tard (on nationalise les pertes, on privatise les gains). Le sauvetage coûtera 26 milliards de livres au contribuable britannique (33 milliards d'euros).
19 novembre 2007 : Citigroup annonce, pour le 4ème trimestre 2007, des pertes de 18 milliards de dollars, résultant de crédits hypothécaires défaillants. Au 3ème trimestre, la banque avait déjà enregistré des pertes de 6,5 milliards.
10 décembre 2007 : La banque suisse UBS annonce 10 milliards de francs suisses de pertes, qui font suite à 4,2 milliards. On parle même d'un total de 60 milliards. Ces pertes proviennent de l'immobilier et des dérivés. (1 franc suisse = 1 dollar = 0,65 euro.)
12 décembre 2007 : La Fed et d'autres banques centrales mettent 65 milliards de dollars à la disposition du marché pour pallier au manque de liquidités consécutif à la crise des crédits hypothécaires.
25 janvier 2008 : La Société Générale annonce une perte de 5 milliards d'euros à la suite de spéculations illégales d'un de ses employés (voir plus haut).
11 mars 2008 : La Fed (seule) met 200 milliards de dollars de liquidités dans le circuit et accepte "en couverture" des titres à risque dont personne ne veut.
14 mars 2008 : Un fonds de placement contrôlé par le Carlyle Group (la banque d'affaires des familles Bush et Ben Laden) doit cesser ses activités après que le milliardaire juif sioniste Larry Silverstein (profiteur du 11 septembre et complice de la destruction du World Trade Center) ait retiré sa mise (14 milliards de dollars).
17 mars 2008 : La banque d'affaires Bear Stearns, en état de cessation de paiements, est reprise par JPMorgan Chase pour une bouchée de pain (1,5 % de la valeur boursière un an plus tôt), avec de l'argent prêté par la Fed. Trois jours auparavant, le banquier Alan Schwartz, PDG de Bear Stearns, disait qu'il n'y avait rien à craindre. Pour faciliter la reprise, la Fed garantit les subprimes et autres créances douteuses de la banque à hauteur de 30 milliards. Excellente affaire pour les principaux protagonistes de ce drame (y compris pour le PDG de la banque coulée). Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des emprunteurs qui ont perdu leur maison, ni des milliers de salariés à présent sans emploi. Déjà, en juin 2007, deux hedge funds gérés par Bear Stearns s'étaient effondrés - sans aucune conséquence négative pour les responsables.
Commentaire amusé du milliardaire américain Jim Rogers, cité par le Financial Times Deutschland : "C'est la Fed qui finance les Maserati des banquiers de Wall Street."18 mars 2008 : Josef Ackermann, PDG de la Deutsche Bank, déclare que les banques ne pourront pas s'en tirer seules, et réclame l'intervention du gouvernement. Comme lui, beaucoup de partisans du "néolibéralisme", du "laissez-faire" et du "marché libre" exigent maintenant l'aide active de l'Etat pour réparer les dégâts qu'ils ont causés. (En 2007, Ackermann a gagné 14 millions d'euros - et ce, dans un pays où le SMIC n'existe pas et où des salaires horaires de 4 ou 5 euros sont tout à fait courants. 14 millions annuels correspondent à 7.300 euros de l'heure. Mais ce salaire, sans doute légèrement supérieur au vôtre, n'est encore rien en comparaison de celui des patrons de hedge funds).
Capitalisme à doctrine variable - L'Etat au service des banques ou de l'intérêt général ?
par Damien Millet et Eric Toussaint (sur le site du Réseau Voltaire).20 mars 2008 : Aux USA et en Grande-Bretagne, il est question de mettre en place un plan de sauvetage qui consisterait à racheter aux banques leurs créances dépréciées - à la valeur nominale, cela va de soi. Avec cet apport de fonds publics (environ 3.000 milliards de dollars si l'on en croit Paul Krugman, économiste écrivant pour le New York Times), les miraculés de la haute finance pourraient se lancer dans une nouvelle bulle spéculative. En fait, ils le font déjà, comme on peut le constater avec la hausse des cours du pétrole, des céréales, de l'or, de l'euro et de quelques autres monnaies.
2 avril 2008 : 12 milliards de francs suisses de pertes supplémentaires pour l'UBS (pour le premier trimestre 2008).
3 avril 2008 : La WestLB allemande (banque des caisses d'épargne publiques de l'ouest du pays) se voit octroyer par l'Etat un "parapluie risques" de 23 milliards d'euros afin d'effacer ses créances douteuses (huit mois plus tôt, on en était encore à 2 milliards). Le nouveau PDG, après avoir avoir annoncé des licenciements, déclare que la banque est à la recherche de nouvelles opportunités financières - les prochaines pertes sont pour ainsi dire déjà programmées. De son côté, la BayernLB (pendant bavarois de la WestLB) signale des dépréciations de plus de 4 milliards d'euros dans ses actifs. Bien que faisant encore partie du secteur public, ces banques se comportent de manière aussi irresponsable que les établissements privés.
Tout cela n'empêche pas les apprentis-sorciers de la finance de prêcher la modération et la retenue. Quelques jours plus tôt, l'association patronale des banques avait vivement critiqué l'intention du gouvernement allemand d'augmenter les retraites de 1,1 % le 1er juillet prochain.9 avril 2008 : Selon le Canard enchaîné, le Fonds de Réserve des Retraites géré par la Caisse des Dépôts et Consignations, vient de perdre 3,1 milliards d'euros suite à un placement boursier malheureux.
15 avril 2008 : Encore 10 milliards de dollars de pertes pour Citigroup et 5 milliards pour Merrill Lynch. Citigroup a besoin d'argent frais et cherche un repreneur pour son réseau bancaire allemand, de même que pour sa filiale Diners Club (cartes de crédit). La Deutsche Bank, de son côté, s'efforce de faire disparaître de son bilan pour 35 milliards d'euros de créances douteuses.
18 avril 2008 : Avec l'aide du Trésor (c'est-à-dire du contribuable), la Banque d'Angleterre se prépare à insuffler 50 milliards de livres (63 milliards d'euros) aux banques en difficulté (Royal Bank of Scotland, Barclays et quelques autres). L'aide prendra la forme d'un échange de créances douteuses contre des obligations garanties par l'Etat.
21 avril 2008 : La Bank of America annonce 6 milliards de dollars de pertes dans le domaine du crédit à la consommation (automobiles, cartes de crédit). C'est le deuxième point faible des banques américaines après le subprime hypothécaire. Pratiquement tous les établissements bancaires doivent trouver d'urgence des capitaux afin de ramener à un niveau acceptable leur ratio de solvabilité mis à mal par la découverte quasi-quotidienne de nouveaux risques de crédit.
24 avril 2008 : Dépréciations d'actifs de 5,2 milliards de dollars pour le Crédit Suisse, qui viennent s'ajouter aux 3 milliards de 2007.
25 avril 2008 : Le bruit court que Fannie Mae et Freddie Mac, les deux principales sociétés américaines de crédit immobilier, sont menacées d'insolvabilité. Le gouvernement serait prêt à intervenir, ce qui pourrait coûter au contribuable entre 420 et 1.100 milliards de dollars.
2 mai 2008 : La Fed, la Banque centrale européenne et la Banque nationale suisse annoncent leur intention de mettre 82 milliards de dollars supplémentaires (55 milliards d'euros) à la disposition du système bancaire.
5 mai 2008 : Le pyromane Ben Shalom Bernanke crie au feu. A son avis, la crise immobilière américaine risque de déboucher sur une crise économique. Quelle perspicacité !... Le chef de la Fed vient de s'apercevoir que dans le pays le plus riche du monde, des millions d'expulsions sont en cours. 18 millions de maisons individuelles sont vides et invendables, donnant à des quartiers entiers des allures de villes fantômes.
21 mai 2008 : L'Institute of International Finance, un organisme présidé par Josef Ackermann (Deutsche Bank) et rassemblant plus de 300 établissements bancaires et financiers, vient de demander l'assouplissement des règles en vigueur, afin de permettre aux banques de comptabiliser leurs actifs dépréciés à la valeur qu'ils avaient avant la crise. De cette manière, la course à l'argent frais s'en trouverait freinée (et l'effondrement final retardé). C'est le contraire de la "surveillance accrue" que réclament certains politiciens (qui savent pertinemment qu'elle n'est pas possible sans changement radical de système). Avec la méthode Ackermann, pour combattre la canicule, il suffit de modifier les thermomètres et tous les problèmes disparaissent.
22 mai 2008 : La presse financière américaine (notamment Bloomberg) signale un nouvel aspect de la crise, tout à fait catastrophique pour les épargnants. Il s'agit de l'effondrement des auction-rate bonds, des titres obligataires dont le taux d'intérêt, au lieu d'être fixé à l'avance, est déterminé aux enchères (c'est l'acheteur qui accepte le taux le plus bas qui l'emporte). Le client à qui un banquier ou courtier peu scrupuleux a refilé ces obligations, ignore généralement ce qu'il y a derrière et qui sont les débiteurs (par exemple : des communes qui peuvent devenir insolvables à tout moment si la crise s'étend, ou des étudiants dans l'incapacité de rembourser leurs crédits, ou n'importe quels autres emprunteurs en difficulté). Le marché des auction-rate bonds existe depuis un quinzaine d'années ; en 2004, il représentait un volume de 200 milliards de dollars (aujourd'hui probablement davantage).
Le propre de ces auction-rate bonds, c'est qu'ils ne se négocient pas en bourse. Et depuis peu, rien ne va plus ; les titres sont devenus invendables. Bloomberg cite le cas d'une dame qui s'est vu conseiller, en janvier 2008, l'achat de 275.000 dollars de ces bonds. Son argent, qu'elle venait d'hériter, est à présent bloqué indéfiniment. Il n'a pas disparu mais c'est tout comme ; en tout cas, elle ne peut plus payer les études de ses enfants.
Une autre cliente a perdu 200.000 dollars. Agée de 72 ans, elle les avait placés en prévision de sa retraite, qu'elle comptait prendre prochainement ! On voit que le système Sarkozy fonctionne déjà aux USA : travailler plus longtemps pour se faire voler plus... Vive la retraite à 90 ans pour tout le monde (sauf les politiciens et les hommes d'affaires).23 mai 2008 : La crise financière ne touche pas seulement les USA et l'Union européenne. L'Islande, petit pays de 300.000 habitants, est frappée de plein fouet. Depuis quelques années, ses banques spéculent autant que les grands de Wall Street ou de la City. La Landsbanki Islands et la Kaupthing Bank, "conseillées" par des hedge funds, ont emprunté à tour de bras et se sont mises à financer des acquisitions d'entreprises à travers toute l'Europe, brassant ainsi un volume représentant neuf fois le PIB du pays* (lequel est d'environ 13 milliards de dollars). Entre-temps, les deux banques sont au bord de la faillite, mais la banque centrale est bien trop faible pour les aider. La couronne islandaise a perdu un quart de sa valeur depuis janvier ; l'inflation officielle est de l'ordre de 12 %. Il a donc fallu que les banques centrales scandinaves se cotisent pour faire parvenir aux Islandais 2,4 milliards de dollars. (A l'échelle de la France, cela correspond à 500 milliards ; à l'échelle des USA, à 2.400 milliards !) L'aide apportée sera peut-être suffisante dans un premier temps pour calmer l'appétit des fonds vautours, mais on ne serait pas étonné d'apprendre que les besoins réels représentent un multiple de cette somme. (Voir également : 29.09.08, 6.10.08, 15.10.08, 28.10.08, 6.3.10 et 9.4.11.)
* La banque Kaupthing, à elle seule, avait un total de bilan de plus de 58 milliards d'euros fin 2007 (= environ 80 milliards de dollars), soit six fois le PIB de l'Islande. C'est proportionnellement 40 fois plus que Citigroup (qui a un bilan de 2,2 billions de $ face à un PIB américain de 15 billions). Heureusement que les Islandais croient aux elfes et aux fées - ils en ont bien besoin par les temps qui courent.4 juin 2008 : D'après le Financial Times, un changement des règles comptables serait en préparation aux USA, qui obligerait les banques à faire figurer dans leurs bilans pour 5.000 milliards de dollars de "véhicules financiers" actuellement externalisés. Cette mesure, qui entraînerait pour la plupart des établissements de crédit une nouvelle dégradation de leur ratio de solvabilité, va à l'encontre de la "méthode Ackermann". Et elle ne touche de toute façon qu'une infime partie des risques potentiels générés par la bulle des dérivés, qui est 100 fois plus importante - voir plus haut.
Quoi que fassent les autorités - qu'elles s'enfouissent la tête dans le sable ou qu'elles jouent très timidement la carte de la transparence -, une solution n'est pas en vue. Pour préserver le système bancaire du désastre, il faudrait stopper immédiatement toute forme de spéculation, geler tous les dérivés et autres instruments financiers, garantir les dépôts de la clientèle privée et commerciale, et repartir à zéro. Autant dire, nationaliser la finance et exproprier l'oligarchie. L'oligarchie, elle, a d'autres plans : exproprier le reste du monde et s'emparer de tout ce qui ne lui appartient pas encore.14 juin 2008 : Lehman Brothers annonce 3 milliards de dollars de pertes pour le trimestre écoulé. Si l'on en croit certaines rumeurs, la banque serait sérieusement menacée. D'un autre côté, il est probable qu'elle ne subira pas le sort de Bear Stearns, car son PDG, Richard Fuld, est membre du conseil d'administration de la filiale new-yorkaise de la Réserve Fédérale. Fuld est un milliardaire juif* qui a su profiter (en toute impunité) de ses connaissances d'initié. En 2006-2007, il a vendu pour 320 millions de dollars d'actions Lehman, alors que le cours était à son maximum. Sa position à la tête de la banque lui permettait bien entendu de savoir ce qui se préparait. Et comme Fuld a dû conserver un petit reliquat de titres d'une valeur de 100 millions, son autre job (à la Fed) va s'avérer très utile pour limiter d'éventuels dégâts.
* Pas de sa faute, il aurait pu être mongol ou guatémaltèque (mais il ne serait pas devenu milliardaire).1er juillet 2008 : Nouvelle pertes pour l'UBS, la banque européenne la plus touchée. En un an, elle a dû faire face à 40 milliards de francs suisses de dépréciations (25 milliards d'euros).
11 juillet 2008 : Faillite de la banque hypothécaire californienne Indymac (32 milliards de dollars d'actifs dévalorisés). Les dépôts de la clientèle devraient être pris en charge par le fonds de garantie bancaire FDIC, ce qui coûterait à cet organisme la modique somme de 8 milliards. En tout, le FDIC dispose de 53 milliards - c'est peu pour garantir 4.000 milliards de dépôts.
Quasi-faillite également de Fannie Mae et Freddie Mac. Ces deux établissements privés qui refinancent près de la moitié des prêts immobiliers aux Etats-Unis, soit 5.300 milliards de dollars, vont faire l'objet d'un plan de sauvetage à l'aide de fonds publics. Comme toujours, l'Etat providence vole au secours du grand capital. A l'origine, Fannie Mae était un établissement financier public (Government sponsored enterprise). Fondé en 1938 dans le cadre du New Deal du président Roosevelt, afin de permettre aux familles modestes d'acquérir leur maison, il fut privatisé en 1968 et perdit son caractère social. En revanche, ses privilèges fiscaux et comptables furent maintenus, de même que la possibilité de se procurer des liquidités à bon compte auprès de la Fed - le tout, bien entendu, pour le seul profit des actionnaires privés. En 1970, pour "animer le marché", on créa un clone de Fannie Mae : Freddie Mac.17 juillet 2008 : La banque américaine Merrill Lynch annonce pour 5 milliards de dollars de pertes supplémentaires. Citigroup, de son côté, affiche un nouveau trou de 7 milliards, soit plus de 40 milliards en tout en un an. Le numéro un de la finance mondiale aurait réussi entre-temps à se procurer suffisamment de capitaux frais, notamment grâce à la vente de son réseau allemand au Crédit Mutuel* français. Prochaine "surprise" au plus tard dans trois mois.
* C'est Lehman Brothers - en faillite deux mois plus tard - qui a "conseillé" le Crédit Mutuel dans cette affaire. La Citibank, de son côté, a "conseillé" ses clients en leur fourguant systématiquement des certificats Lehman dont elle savait pertinemment qu'ils ne valaient pas un clou.25 juillet 2008 : Deux nouvelles faillites bancaires (First Heritage Bank et First National Bank of Nevada). Comme il s'agit de petits établissements régionaux, la bourse ne s'affole pas. D'ailleurs, le FDIC attend toujours le vendredi soir pour annoncer ce genre de nouvelles.
8 septembre 2008 : Nationalisation de Fannie Mae et Freddie Mac. Le Trésor américain s'engage à recapitaliser les deux établissements à hauteur de 200 milliards de dollars. Cette somme sera-t-elle suffisante ?...
12 septembre 2008 : Sur le marché des changes, le dollar a repris du poil de la bête. Un euro ne coûte plus que 1,40 $ contre près de 1,60 en juillet. Entre-temps, l'once d'or est à 750 dollars (1.000 dollars en mars) et le baril de pétrole à 100 dollars (près de 150 en juillet). On voit que la spéculation est possible dans les deux sens.
15 septembre 2008 : Merrill Lynch échappe de justesse à la faillite, grâce à une reprise de dernière minute par la Bank of America. Lehman Brothers a moins de chance et doit déposer son bilan ; le milliardaire Richard Fuld va-t-il être obligé de s'inscrire au chômage ?... En l'espace de six mois, trois des principales banques d'investissement des USA ont disparu (Bear Stearns, Merrill Lynch, Lehman). Qui sera la prochaine ?...
De son côté, l'assureur AIG - American International Group (numéro un mondial) doit faire face à de sérieuses difficultés ; il lui manque la bagatelle de 75 milliards de dollars pour faire face à ses obligations immédiates. Pour parfaire le tableau, la Washington Mutual (WaMu) de Seattle, la plus grande caisse d'épargne des Etats-Unis, annonce une perte de 3 milliards pour le trimestre, plus 16 milliards probables prochainement sur un total de créances hypothécaires douteuses dans ses livres de plus de 180 milliards. Et il semblerait que WaMu soit bientôt suivie par Wachovia de Charlotte (Caroline du Nord), la quatrième banque américaine. (Indépendamment de ses problèmes financiers actuels, Wachovia a la réputation d'être une banque qui aime arnaquer les épargants : en 2007, elle a encaissé pour 150 millions de dollars de chèques non signés, soi-disant émis par sa clientèle ; elle a mis en circulation de la fausse monnaie ; elle a harcelé téléphoniquement ses clients âgés pour leur fourguer des titres sans valeur. Wachovia a également été mêlée à des histoires de blanchiment de narcodollars.)
En Europe, la situation n'est guère plus brillante. La BCE et la Banque d'Angleterre injectent 37 milliards d'euros de plus dans les circuits financiers. Les titres bancaires chutent. L'action HBOS - Halifax Bank of Scotland perd près de 30 % en quelques heures.
A part ça, tout va très bien...16 septembre 2008 : Sauvetage d'AIG grâce à 85 milliards de dollars de fonds publics (les 75 demandés + un petit pourboire) en échange d'une participation de l'Etat (nationalisation partielle). Oncle Sam en profite pour donner 50 milliards de plus aux autres responsables de la crise financière. L'Europe lui emboîte le pas et distribue de son côté le double de ce qu'elle avait distribué la veille.
17 septembre 2008 : HBOS, au bord de la faillite, est racheté par son concurrent Lloyds TSB. Les banques centrales continuent de déverser des dizaines et des dizaines de milliards sur les marchés financiers - plus personne ne compte. La banque allemande KfW (établissement public) effectue "par erreur" (et à fonds perdus) un virement de 300 millions de dollars en faveur de Lehman Brothers, en liquidation depuis deux jours (certaines sources parlent même de 530 millions).
18 septembre 2008 : La banque britannique Barclays rachète une partie des dépouilles de Lehman. Nul ne sait au juste ce qui a été manigancé dans la coulisse (c'est le cas de le dire), mais il y a fort à parier que cette faillite arrangée ne sera pas une tragédie pour tout le monde. Dans cet article célébrant la banque juive* aux multiples vies, les "Patrons juifs de France" jubilent. Lehman est mort, vive Lehman ! Et merde pour ces cons d'épargnants qui avaient cru que leur argent était en sécurité.
* La banque juive ? C'est pas une expression antisémite, ça... ?
Un certain Olivier Pastré, professeur d'économie et banquier*, rassure ici ceux d'entre eux (les cons d'épargnants) qui n'ont pas encore subi le sort des clients de Lehman. Ils ne risquent rien, dit-il, "car les banques de détail ne vont pas faire faillite". Qu'est-ce qu'il en sait ?... Pastré prétend que, contrairement à ce que disent "les dépressifs", "la crise actuelle n'a rien à voir avec 1929" et que "les bêtises faites alors par les banques centrales ne sont plus faites aujourd'hui". En 1929, on était dès le départ résolument déflationniste, alors qu'en 2008, on inonde les marchés de centaines de milliards de liquidités. Et alors ?...
C'est un peu comme si un "expert" avait dit en 1939 : "La situation actuelle n'est pas du tout comparable à celle de 1914 ; personne ne commettra plus la bêtise de se lancer dans une guerre de tranchées. En 14, les fantassins devaient se déplacer à pied ; un quart de siècle plus tard, on est mobile et motorisé..." (Argument imparable qui aurait certainement rassuré les futurs 60 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale.)
Le problème, bien sûr, ce n'est pas que telle ou telle "bêtise" soit reproduite à l'identique, mais que l'on retrouve, dans le monde actuel de la finance, le même état d'esprit qu'en 1929 - en bien pire encore. Une bulle est une bulle, et au-delà d'une certaine taille, rien ne peut l'empêcher d'éclater. En démantelant tous les garde-fous mis en place sous Roosevelt, on a rendu possible - et probable - un nouveau 1929. Après la grande catastrophe, tous les Pastré du monde viendront nous raconter qu'on ne pouvait pas prévoir. (Les plus gonflés d'entre eux prétendront qu'ils nous avaient prévenus.)
* Olivier Pastré est président de l'IM Bank de Tunis, après avoir été administrateur de diverses banques et fonds d'investissement du Maghreb.
Aux Etats-Unis, la banque d'investissement Morgan Stanley, assez durement frappée par la crise, négocie paraît-il avec Wachovia en vue d'une éventuelle fusion : avec deux jambes de bois, on court plus vite.19 septembre 2008 : Les autorités américaines annoncent la création d'un fonds spécial chargé de délester les banques de leurs créances les plus dépréciées*. L'opération coûtera plusieurs centaines de milliards de dollars qui, espère-t-on, seront remboursés un jour. Avec mille fois plus de dérivés en circulation (500.000 milliards de dollars en 2007 et sans doute 700.000 aujourd'hui), on peut légitimement douter qu'un tel fonds soit suffisant et que les banques soient en mesure de rembourser un jour.
Les innombrables milliards déjà jetés dans le gouffre de la finance depuis un an sont également remboursables - mais pas nécessairement remboursés. En fin de compte, c'est le contribuable qui paie. Et chaque dollar public versé pour "aider les banques" alimente directement ou indirectement la spéculation.
Spéculation que personne ne songe à supprimer - on ne va quand même pas imposer le communisme à Wall Street... Bien sûr, il y aura peut-être un ou deux embellissements superficiels. A New York et à Londres, on parle de suspendre pour trois mois les ventes de titres à découvert. Mais qui empêchera les spéculateurs de passer par une autre place ?... Il est clair que cette mesure a principalement pour but d'éviter un effondrement boursier des valeurs bancaires, déjà bien secouées au cours des quatre derniers jours ; elle ne résout en rien le véritable problème.
* On avait procédé de même dans les années 1980 pour endiguer la crise des caisses d'épargne (savings and loan crisis). Mais la comparaison s'arrête là, car le sauvetage n'avait coûté alors que 125 milliards de dollars au total.
Un conseil (gratuit) à l'intention du Trésor américain : en contrepartie de ses actifs, le fonds spécial 2008 devrait émettre des certificats que l'on placerait auprès du grand public - par l'intermédiaire des banques, évidemment, et après avoir obtenu des rating agencies la note AAA (l'équivalent de 20 sur 20). Sûr que ça se vendrait bien. Plus on recycle et plus ça rapporte...22 septembre 2008 : Le fonds de sauvetage du gouvernement américain sera doté de 700 milliards de dollars (l'équivalent des dépenses militaires ou du déficit budgétaire d'une année normale). Avant d'actionner la "planche à billets", Washington demande à ses fidèles alliés de l'aider un peu à rassembler cette somme. Les Européens, pourtant habitués à payer les pots cassés des Américains, refusent poliment.
Les banques centrales, en Europe, au Japon, aux USA, continuent d'injecter de l'argent frais par tranches de 50 ou 100 milliards, sur des marchés "en manque de liquidités". C'est un véritable coup de fouet pour la spéculation : les cours de l'or et du pétrole se remettent à grimper (jusqu'à 900 et 130 $ respectivement). Bien entendu, le problème actuel ne résulte pas d'un manque de liquidités mais d'un manque général de confiance entre banques.
Nouvelle mesure purement cosmétique aux Etats-Unis : on supprime le statut particulier des banques d'investissement, qui n'existait plus que sur le papier. En principe, toutes les banques seront désormais soumises aux mêmes contrôles - ce qui ne change pas grand-chose, puisque les contrôles sont purement virtuels dès qu'il y va de l'essentiel.
A New York, juste après avoir rencontré le sioniste Tim Geithner*, patron de la branche locale de la Federal Reserve Bank, le sioniste Nicolas Sarkozy demande "que les responsables du désastre soient sanctionnés". Chiche ! Au lieu de faire la guerre en Afghanistan, qu'il donne l'ordre de bombarder Wall Street et la Fed...
* En novembre 2008, après la victoire électorale d'Obama, Geithner sera choisi comme futur ministre des Finances.25 septembre 2008 : Après que de nombreux clients aient vidé leurs comptes, la Washington Mutual est en état de cessation de paiements : c'est la plus grande faillite d'une banque de dépôts dans l'histoire des Etats-Unis. Les autorités placent la WaMu sous séquestre et revendent une partie de ses activités à JPMorgan Chase pour 1,9 milliards de dollars, sans qu'il en coûte un cent au FDIC. Le reste restera probablement à la charge du contribuable.
La mise en place du fonds de sauvetage est accompagnée de vives discussions. Certains députés, pour ne pas compromettre leur réélection en novembre (malgré la généralisation de la fraude électronique), proposent que le Trésor public n'agisse pas sans contrepartie. En échange de la reprise des créances douteuses, l'Etat deviendrait actionnaire des banques "sauvées". Le versement d'indemnités de départ astronomiques (parachutes dorés) aux banquiers banqueroutiers serait exclu. Et surtout, il y aurait des dispositions financières et administratives en faveur des Américains modestes directement menacés par la crise hypothécaire et la perte de leur maison.
Bien entendu, Ben Bernanke (chef de la Fed) et son compère Henry Paulson (ministre des Finances, chef du Trésor, ancien PDG de Goldman Sachs) s'opposent formellement à ces mesures abominablement "socialistes". Ce qu'ils veulent, c'est un chèque en blanc pour les "responsables" et l'assurance que tout pourra continuer comme avant.29 septembre 2008 : La crise financière frappe l'Europe. La banque Fortis du Benelux est sauvée de la faillite grâce à une prise de participation des trois gouvernements de 11 milliards d'euros. Bradford & Bingley, banque hypothécaire britannique en difficulté (50 milliards d'euros de créances à risques), est elle aussi partiellement nationalisée. La banque allemande Hypo Real Estate, menacée de liquidation, obtient in extremis une aide de 35 milliards d'euros, dont 27 accordés par l'Etat et 8 par un consortium de banques privées. En Islande, l'Etat doit reprendre 75 % du capital de la banque Glitnir pour lui éviter l'effondrement... Prochains candidats au plongeon : la banque franco-belge Dexia et la Roskilde Bank du Danemark.
Aux Etats-Unis, Wachovia a trouvé un "sauveteur" (plus solide, paraît-il, que Morgan Stanley) : il s'agit de Citigroup*. Le plus curieux est que le groupe en question était à la recherche de liquidités il y a à peine six mois, et que pour s'en procurer, il a dû se séparer de plusieurs de ses filiales. Et voilà qu'il a de l'argent plein les poches et peut se permettre de racheter ses concurrents... Il y a certainement une large part d'intox dans toutes ces "informations" financières. Bien malin qui pourrait dire ce qui nous attend demain.
* Finalement, c'est Wells Fargo - le troisième larron - qui reprendra Wachovia.
D'après le Financial Times Deutschland, le volume total des dérivés de crédit CDS (voir plus haut) diminue depuis quelque temps. On en serait maintenant à 55 billions* de dollars, une somme encore supérieure au PIB mondial (54 billions). Au passage, on apprend que la banque Lehman Brothers, en liquidation depuis le 15 septembre, était elle aussi "vendeuse de protection" CDS. Sa disparition a fait automatiquement baisser l'encours global. (D'un autre côté, de nombreux emprunts de la banque en faillite étaient "garantis" par des CDS - 365 milliards si l'on en croit un recensement effectué deux semaines plus tard. On ignore au juste qui sont les "assureurs", mais il est probable que si on leur demande de rembourser les pertes, il y aura de nouvelles défaillances. C'est un des aspects de "l'effet domino" dont tout le monde parle depuis quelques semaines.)
* Début novembre 2008, le total serait tombé à 33 billions.
Selon l'agence Bloomberg, le syndic de faillite de Lehman vient de constater la perte mystérieuse de 400 milliards de dollars durant les mois précédant le dépôt de bilan - perte due, paraît-il, aux fluctuations du marché. On ne serait pas étonné d'apprendre que cette somme n'est pas perdue pour tout le monde*, même s'il est peu probable qu'on connaisse jamais les dessous de l'affaire. En tout cas, on commence à comprendre pourquoi Lehman n'a pas été "sauvé" comme les autres.
Là aussi, on voit ce que valent les annonces officielles : le 14 juin 2008, quand Lehman faisait état de 3 milliards de perte, la réalité était déjà cent fois pire. On se demande combien d'autres mensonges vont éclater au grand jour dans les semaines et les mois à venir.
 * Malgré la faillite (ou plutôt grâce à elle), Richard Fuld, le PDG milliardaire de Lehman, a touché 450 millions de dollars supplémentaires à titre d'indemnité. Revers de la médaille : un épargnant spolié lui a mis son poing dans la gueule (encore une grave manifestation d'antisémitisme recrudescent).
* Malgré la faillite (ou plutôt grâce à elle), Richard Fuld, le PDG milliardaire de Lehman, a touché 450 millions de dollars supplémentaires à titre d'indemnité. Revers de la médaille : un épargnant spolié lui a mis son poing dans la gueule (encore une grave manifestation d'antisémitisme recrudescent).
Pour terminer cette belle journée du 29, le Congrès américain rejette le plan de sauvetage légèrement amendé par les soins de Bernanke-Paulson. Certains opposants, surtout républicains, estiment que le projet est trop dirigiste. D'autres, surtout démocrates, pensent que le projet ne va pas assez loin. Quelques "contestataires de gauche" vont même jusqu'à exiger une limitation générale des salaires versés aux dirigeants de banques bénéficiant de l'aide gouvernementale. Les escrocs de Wall Street et leurs complices de Washington protestent, affirmant qu'une telle mesure "affecterait la compétitivité" (sic).
La discussion reprendra prochainement, mais pas demain. Le Congrès ne siègera pas le 30 septembre, car il s'agit d'un jour férié juif. Personne ne peut exiger des "patriotes" de la Knesset américaine qu'ils viennent "travailler" ce jour-là, au lieu de fêter le Nouvel An israélite comme tout le monde. A plus tard, donc, dans les territoires occupés de Capitol Hill. Shalom USraël...30 septembre 2008 : Rosh Hashana millésime 5769. Sur CNN, chaîne judéophile s'il en est, l'animateur (juif) Larry King interroge deux économistes (juifs) sur le rejet du plan de sauvetage : Ben Stein (supporter de McCain) et Paul Krugman* (supporter d'Obama). Merveilleuse pluralité américaine...
En Europe, sans le moindre respect pour le caractère sacré de cette journée, les gouvernements belge, luxembourgeois et français transfèrent 6,4 milliards d'euros à la banque Dexia pour lui éviter la faillite.
* En octobre 2008, Krugman obtiendra le Prix Nobel d'Economie - un prix presque toujours attribué à des professeurs juifs (Hurwicz, Maskin et Myerson en 2007, Phelps en 2006, Aumann en 2005, etc. jusqu'à Samuelson en 1970, en passant par Milton Friedman en 1976). Comme l'écrit Wikipédia, "le choix des lauréats a été critiqué, pour avoir souvent favorisé des économistes 'orthodoxes' (dont ceux de l'école de Chicago)" - il s'agit des fameux "Chicago Boys" de Friedman, le théoricien et justificateur du cannibalo-capitalisme que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui.3 octobre 2008 : Le Congrès américain vote le plan de sauvetage après avoir été soumis à de très fortes pressions : menace de décréter la loi martiale en cas de second refus, achat de voix par Goldman Sachs, etc. Entre-temps, il n'est plus question de 700 milliards mais de 850, car le paquet contient maintenant, à la demande de certains députés, de nombreux cadeaux fiscaux en faveur de groupes "menacés par la crise" - comme par exemple l'industrie du cinéma et de la télévision, le sport automobile et les propriétaires de circuits, les énergies renouvelables, et même la recherche scientifique visant à améliorer la qualité de la laine (!) Les membres du Congrès ont profité de l'occasion pour faire passer d'un seul coup tous les projets d'aide fiscale qu'ils avaient dans leurs cartons. Pour les lobbyistes, la date du 3 octobre est à marquer d'une pierre blanche.
Au cours de la dernière semaine de septembre, les banques américaines ont emprunté en moyenne, chaque jour, 368 milliards de dollars à la Fed. La semaine d'avant, la moyenne journalière était encore de "seulement" 188 milliards. Bien sûr, il ne s'agit que de sommes prêtées, mais il est clair que les banques ne se contentent plus d'emprunter de nouveau ce qu'elles remboursent à la banque centrale ; elles empruntent chaque fois davantage. Tant que la Fed le permet, les banquiers n'ont aucune raison de se gêner. Le marché monétaire entre banques est pratiquement gelé ; le seul moyen de satisfaire ses besoins de trésorerie est de passer par la Fed. (La situation n'est pas tellement différente en Europe.)
Tout cela n'empêche pas Wells Fargo de se porter acquéreur de Wachovia, entrant ainsi en concurrence directe avec le Citigroup.5 octobre 2008 : Echec du plan de sauvetage de la banque Hypo Real Estate (HRE) de Munich. Il s'avère que le trou n'est pas de 35 mais de 150 milliards d'euros. Les banques privées refusent de s'engager (pour 8 milliards) comme elles l'avaient promis le 29 septembre. L'Etat va donc devoir tout prendre à sa charge, s'il veut éviter la plus grande faillite allemande de tous les temps. Dans un premier temps, le gouvernement accorde 50 milliards, ce qui devrait suffire jusqu'à la fin de l'année (ou jusqu'à la fin de la semaine). Parallèlement, le PDG de HRE (salaire annuel : 1,9 million d'euros) est "sanctionné" (comme dirait Sarkozy). Il doit démissionner et se contenter d'une pension de retraite correspondant à 70 % de son salaire (plus une indemnité de départ de l'ordre de 10 millions).
Comme pour HRE, le premier "sauvetage" de Fortis (décidé également le 29 septembre) s'avère inefficace, de sorte que le gouvernement des Pays-Bas nationalise en totalité le réseau hollandais de la banque, tandis que BNP Paribas reprend la partie non-étatisée de Fortis-Belgique et Fortis-Luxembourg.6 octobre 2008 : Les dirigeants des pays européens assurent les uns après les autres qu'ils ont l'intention de "protéger l'épargne". Comme des dispositions concrètes existent déjà un peu partout, ces promesses n'apportent pas grand-chose de nouveau ; elles sont vagues et n'engagent à rien... En Islande, le gouvernement décrète l'état d'urgence financier et prend le contrôle du système bancaire. La couronne islandaise perd 30 %.
7 octobre 2008 : Le gouvernement de Londres débloque 500 milliards de livres (640 milliards d'euros) en faveur des banques. 200 milliards seront "prêtés" pour trois mois ; 250 milliards serviront à garantir les actifs dépréciés ; 50 milliards seront utilisés pour recapitaliser les principaux établissements financiers, dont Barclays, Royal Bank of Scotland, HBOS, HSBC et Lloyds TSB. Ces 500 milliards de livres dont vont bénéficier les banques britanniques correspondent à 870 milliards de dollars, soit plus que le récent plan de sauvetage américain.
Aux USA, en Espagne, au Japon, les banques centrales continuent d'injecter les milliards sans compter. Comme dit un courtier de Tokyo, la transfusion sanguine se poursuit tandis que l'hémorragie continue de plus belle.8 octobre 2008 : La Fed, la Bank of England, la BCE ainsi que les banques centrales suisse, suédoise et canadienne abaissent simultanément leurs taux directeurs de 0,5 point. Cette mesure censée ranimer la bourse en chute depuis trois semaines, reste sans effet - c'est le contraire qui aurait été étonnant. Autre signe que les marchés ne suivent pas la Fed : alors que le taux directeur de cette institution est maintenant de 1,5 %, le taux correspondant sur le marché monétaire "libre" (Libor - London interbank offered rate) est de 4,75 % pour les prêts en dollars à trois mois et même de 5,1 % pour les prêts "au jour le jour".
9 octobre 2008 : Après avoir été "sauvée" le 30 septembre, Dexia est de nouveau en danger de mort. La France, la Belgique et le Luxembourg garantissent donc tous les emprunts qu'elle effectuera sur les marchés - sans aucun contrôle, cela va de soi. Le "programme antidrogue" mis en place par les gouvernements assure aux camés de la finance un approvisionnement illimité aux frais des contribuables.
Si l'on veut savoir à quoi servent les "sauvetages", il suffit de regarder du côté d'AIG : "Six jours après avoir été sauvés de la faillite par une injection de 85 milliards de dollars frais, une poignée de dirigeants de la société d'assurance ont fêté ça dans un hôtel de luxe pour la modique somme de 440.000 $." Vive la crise ! (Le 9 octobre, AIG annonce qu'il lui manque encore 37,8 milliards de dollars.)
En Europe, Fortis imite AIG et s'offre un petit banquet au Restaurant Louis XV de l'Hôtel de Paris à Monte-Carlo. Mais vu que les amis belges sont tout de même plus modestes que leurs collègues américains, ils ne dépensent que 150.000 euros pour 50 convives.
Un adage juif de Wall Street recommande de vendre à Rosh Hashana (c'était le 30 septembre) et d'acheter à Yom Kippour (c'est aujourd'hui). Les financiers, eux, ont vendu à l'une et l'autre de ces dates - tant pis pour l'adage. Et tant pis aussi pour la repentance (c'est le sens profond du Yom Kippour). Les banquiers ne croient pas en Dieu, mais ils espèrent que Dieu croit en eux - et qu'il les aidera à sortir enrichis de la crise (on peut compter sur lui).10 octobre 2008 : A Washington, les sionistes Dominique Strauss-Kahn (patron du FMI) et Robert Zoellick (chef de la Banque mondiale) "déplorent" que la crise frappe aussi les pays pauvres (des pays que ces salauds ont pourtant eux-mêmes contribué à appauvrir).
En Amérique latine, les Etats anti-impérialistes (Cuba, Venezuela, Equateur, Bolivie) proposent de mettre en place un Fonds monétaire alternatif. Il existe déjà une banque de développement indépendante, la Banque du Sud, qui regroupe le Brésil, l'Argentine, le Venezuela, la Bolivie, l'Equateur, le Paraguay et l'Uruguay. Le Brésil, encore tributaire il y a quelques années des organisations prédatrices de Washington, a entre-temps totalement remboursé sa dette extérieure et dispose même de 200 milliards de dollars de réserves.
Pour le président venezuelien Hugo Chávez, il faut dissoudre le FMI et faire le procès des responsables, à commencer par Strauss-Kahn et Bush. "Le capitalisme de rapine devient de plus en plus insupportable pour les peuples du monde... La crise actuelle n'est pas seulement une crise financière, économique et alimentaire. Elle marque le commencement de la fin d'une époque dominée par un système pervers..."
En attendant, selon une étude menée par le World Economic Forum auprès de dirigeants d'affaires britanniques, le classement des pays par ordre de solvabilité ne correspond plus du tout à ce qu'il était il y a encore quelques mois. En tête, on trouve le Canada, la Suède, le Luxembourg et l'Australie. La France est 19ème, l'Allemagne 39ème (derrière le Botswana), les USA 40ème, le Royaume-Uni 44ème. C'est un classement sans doute très subjectif, mais au moins aussi valable que celui des agences de notation à la solde des fauteurs de crise.
"Le capitalisme est un système fait pour enrichir les riches en appauvrissant les pauvres. Pendant la 'crise' cet enrichissement des plus riches au détriment de moins riches qu'eux se fait d'un seul coup. La crise, par conséquent, ce n'est pas quand le capitalisme fonctionne mal, c'est au contraire quand il fonctionne au mieux." : La crise, c'est l'orgasme du capitalisme !
Virons-les tous ! par Danielle Bleitrach.
Selon le Wayne Madsen Report, les USA s'apprêteraient à proclamer la loi martiale pour faire face aux troubles sociaux en cas d'effondrement financier et bancaire.
Dans Le Figaro, le sioniste Ivan Rioufol écrit : "Le capitalisme financier est utile..." Utile pour qui ?... Rioufol (ça rime avec branquignol) part en guerre contre les "antilibéraux", les "antiaméricains" et même les "enfants de Robespierre" (?) qui profitent de la crise pour donner leur avis, alors que Wall Street ne leur a rien demandé. Au passage, il exécute le Hamas, dont le porte-parole Fawzi Barhoum a osé déclarer que les problèmes actuels s'expliquent par "la mauvaise gestion administrative et financière et un mauvais système bancaire mis en place et contrôlé par le lobby juif". Parce que, bien entendu, ce lobby (que Rioufoldingue met entre guillemets, comme s'il s'agissait d'une invention palestinenne), ce lobby inexistant, donc, n'a strictement rien à voir avec la crise actuelle.12 octobre 2008 : Le leader altermondialiste José Bové demande la création d'un Tribunal pénal international pour juger les responsables des crises économiques, les spéculateurs et les criminels financiers. (En France, ce sont ces criminels et leurs complices qui font juger les contestataires comme Bové.)
13 octobre 2008 : Action concertée des pays de la zone euro pour "sauver le secteur bancaire". Les ennemis déclarés de l'assistanat consacrent des centaines et des centaines de milliards pour renflouer les banquiers spéculateurs. L'effort le plus important est consenti par l'Allemagne : 500 milliards de fonds publics qui seront, paraît-il, "soit remboursés, soit pas du tout utilisés" - de qui se moque-t-on ?...
L'opération, un peu copiée sur le plan Darling (c'est le nom du ministre britannique des Finances, ça ne s'invente pas), prévoit un fonds de 100 milliards servant à recapitaliser les établissements financiers et à reprendre leurs actifs toxiques. Le gros du paquet-cadeau : 400 milliards d'euros de garanties devant permettre aux banques de se prêter mutuellement de l'argent. Cela signifie que si la Deutsche Bank avance 20 milliards à la Commerzbank, pour que celle-ci puisse faire face à ses obligations, l'Etat en garantit le remboursement. Personne ne cherche à savoir à quoi servira cette somme : faire tourner l'économie réelle ou alimenter le grand tonneau des Danaïdes de Wall Street ?... Peu importe... Bien sûr, rien n'est prévu pour stopper l'hémorragie dérivative, mais on encourage les dons de sang. Allez-y, on a besoin de 15 milliards de litres par jour. (De toute façon, c'est obligatoire...)
Toutefois, pour prouver que tout cela n'est pas "pour rien", on envisage également, le cas échéant et sous toutes réserves, de fixer - peut-être - un plafond éventuel aux sommes perçues par les PDG, mais seulement s'il s'avère que la situation le justifie compte tenu du contexte, vous comprenez... Il paraît que ça va être très efficace et dissuasif - un peu comme lorsque les villes américaines limitent les ventes d'armes à deux mitraillettes par semaine et par personne de plus de seize ans.
Quelques heures après sa voisine, Sarkozy présente un plan analogue*, mais pour 360 milliards seulement (quand on est petit, il faut assumer). Les autres pays font de même : Espagne 100 milliards, Autriche 100 milliards, Pays-Bas 200 milliards, etc... En tout, 1.700 milliards.
* Le projet de loi, quasiment identique dans tous les pays, à l'exception de la somme engagée, a éte rédigé par des "stagiaires" délégués auprès du ministère allemand des Finances par le lobby des banques. C'est ainsi que fonctionne la "démocratie" européenne en 2008... [Cette méthode très efficace, inventée par les mafias communautaristes, finira par se généraliser. Quelques années plus tard, dans les secteurs les plus divers, comme les assurances, l'énergie, l'environnement, la "protection" des consommateurs, les médias, l'armement, la fiscalité, etc. etc., les textes législatifs nationaux ou européens seront formulés mot pour mot par les lobbies professionnels. On n'est jamais si bien servi que par soi-même...]
Bien sûr, ces sommes astronomiques entraînent un accroissement de la dette publique, même si ce n'est qu'en partie, même si ce n'est pas dans l'immédiat. Et à qui vont s'adresser les Etats pour combler leurs gigantesques déficits ? Au marché financier et... aux banques, bien entendu... Prête-moi de l'argent pour que je puisse te faire un cadeau. Mais si t'as pas assez, t'inquiète pas, je te dépannerai...
The woman who could have prevented this financial mess was silenced by Greenspan, Rubin and Summers - En 1997, Brooksley Born, directrice d'une agence fédérale américaine chargée de suivre les opérations à terme et sur options, a témoigné devant le Congrès et mis en garde contre les dangers émanant de l'anarchie des dérivés. Au lieu de l'écouter, Alan Greenspan (chef de la Fed), Robert Rubin (ministre des Finances, ancien de Goldman Sachs) et Lawrence Summers (ministre-adjoint des Finances) l'ont réduite au silence. Arthur Levitt, patron de la Commission de contrôle des opérations de bourse (SEC), les a soutenus contre Born. (Par le plus grand des hasards, il se trouve que ces quatre hommes sont juifs - ce sont des choses qui arrivent...)14 octobre 2008 : Aux Etats-Unis, le gouvernement débloque 250 milliards de dollars (sur les 850 autorisés récemment) pour entrer au capital de plusieurs grandes banques, dont Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Merrill Lynch.
Après la dégringolade de ces derniers jours, la bourse remonte. C'est bien, disent les "experts" payés par le patronat, c'est un bon début, mais il faut continuer d'aider les entreprises. En revanche, pas question d'augmenter le pouvoir d'achat de la population pour stimuler la conjoncture. Un plan de relance de 100 milliards serait "trop cher" et "trop inflationnaire", et puis tout le monde en profiterait - on ne peut quand même pas faire ça. Mieux vaut donner directement 5 ou 10 fois plus à la bande de banksters qui a provoqué la crise...15 octobre 2008 : Wall Street et les autres bourses repartent vers le bas ; la reprise n'aura été que de courte durée... En Islande, pour faire comme tout le monde mais sans trop savoir pourquoi, la banque centrale baisse son taux directeur de 15,5 à 12%.
16 octobre 2008 : Aide du gouvernement suisse à l'UBS - participation au capital à hauteur de 6 milliards de francs et rachat d'actifs toxiques pours 50 autres milliards (en tout environ 36 milliards d'euros). La bourse continue de chuter.
A Bruxelles, la démagogie bat son plein. On veut paraît-il s'attaquer aux paradis fiscaux (mais sans mettre en cause Jersey et Monaco, qui sont dans l'UE sans y être - d'ailleurs ces paradis fiscaux n'ont pas grand-chose à voir avec la crise actuelle - pour le grand capital, le monde entier est un paradis, à commencer par la City de Londres). On propose de réglementer les fonds spéculatifs (que l'on a autorisés partout et qui continuent d'attiser la crise jour après jour). On s'apprête à "réformer" le FMI moribond pour lui donner un rôle de supervision universelle (afin que Strauss-Kahn et les prédateurs qu'il représente puissent mieux dominer la planète, en particulier les pays qui s'opposent au nouvel ordre mondial). On parle à tout bout de champ de "nouveau Bretton Woods" (alors que ce qui en sortira n'aura rien à voir avec l'esprit de 1944, bien au contraire - voir plus haut).

Les banques européennes adorent le paradis fiscal de Saint-Hélier (Jersey)
Voir également plus bas :
Intérêts notionnels et paradis fiscal - une histoire belge peu connue17 octobre 2008 : Comme l'écrit l'AFP, "la Caisse d'Epargne*, symbole de sécurité pour des millions d'épargnants français, a perdu 600 millions d'euros à cause des risques inconsidérés pris par certains de ses traders en plein krach boursier, une affaire qui rappelle en partie celle de la Société Générale." 600 millions d'euros, cela correspond à un dommage de 0,12 kerviel - pas de quoi fouetter un écureuil... Sauf, bien sûr, si Le Canard enchaîné a raison et qu'il manque à la Caisse d'Epargne non pas 0,6 mais 6,5 milliards d'euros pour rendre ses comptes présentables. Depuis le début de cette crise, les banques ont toujours adopté la même tactique : avouer moins pour cacher plus.
Ainsi, par exemple, Citigroup, qui annonce près de 3 milliards de pertes pour le trimestre écoulé, soit 50 milliards "en tout". En additionnant les chiffres publiés de trimestre en trimestre, on arrive à un total moindre : c'est la dynamique du trou noir de la haute finance...
Idolâtrie du marché : 30 ans de mensonges, la divinité s'effondre
* Derrière l'affaire de la Caisse d'Epargne se cache aussi le scandale Natixis. Cette banque d'investissement fondée par les Caisses d'Epargne et les Banques Populaires afin de spéculer discrètement (ou secrètement) sur le marché des subprimes, a laissé un très mauvais souvenir à 3,5 millions de petits actionnaires aux revenus souvent très modestes (lesquels actionnaires, bien entendu, ignoraient tout des activités de la banque). L'action émise à 19,55 € fin 2006 ne vaut plus que 2,10 aujourd'hui (-90 %). [Le 9 mars 2009, le cours tombera même à 0,80, soit -96 %.]20 octobre 2008 : Devant le parlement de l'UE, à Strasbourg, Sarkozy, obéissant à ses commanditaires, réclame la mise en place d'un "gouvernement économique européen" - premier pas, on s'en doute, vers un gouvernement économique mondial au service du grand capital. On commence à comprendre ce que certains entendent par "nouveau Bretton Woods" : il faut absolument, à l'avenir, que toutes les décisions soient prises par un centre unique, sans aucune discussion ni opposition possible de la part d'autorités régionales relativement indépendantes de type BCE ou autre.
La crise financière en cours est aussi peu fortuite que les attentats du 11 septembre. Ses conséquences sont voulues et s'inscrivent elles aussi dans le plan d'instauration du nouvel ordre mondial.27 octobre 2008 : L'euro continue de baisser (ou le dollar de monter). Après la pointe de 1,60 $ pour 1 € en juillet et la chute à 1,40 en septembre, on en est maintenant à moins de 1,25. Aucune explication convaincante n'est fournie par les "experts" pour élucider ce phénomène. (S'ils comprenaient vraiment ce qui se passe aujourd'hui, ces gens auraient aussi une petite idée de ce qui se passera demain* - et n'auraient donc nul besoin de donner des conseils aux autres pour gagner leur vie.) Quoi qu'il en soit, l'interprétation la moins stupide circulant actuellement, est que les hedge funds (principalement américains), après avoir spéculé contre le dollar, débouclent à présent leurs positions, ce qui fait grimper la demande. D'un autre côté, il est évident que les grands créanciers des Etats-Unis, comme la Chine et les pétro-milliardaires arabes, ne font toujours rien pour se débarrasser de leurs avoirs en dollars.
* Les meilleures prophéties sont celles que l'on formule a posteriori (voir la Bible).
Les subprimes expliqués aux Chtis28 octobre 2008 : La banque centrale d'Islande relève son taux directeur de 12 à 18 %, deux semaines à peine après l'avoir fait passer de 15,5 à 12. Les trolls semblent avoir pris le pouvoir à Reykjavík - à moins qu'il ne s'agisse tout simplement de vautours étrangers soucieux de faire fructifier leurs dérivés basés sur les taux. Toujours est-il que l'Etat islandais est en faillite.* (Voir plus haut 23 mai 2008.)
* Wall Street on the Tundra - un texte du journaliste juif américain Michael Lewis, paru en avril 2009 dans le magazine Vanity Fair. Lewis dresse un tableau assez saisissant des conséquences pratiques de l'hystérie spéculative islandaise. Très intéressant, même si le ton de l'article laisse percer une certaine arrogance, et même si les vrais fauteurs et profiteurs de crise ne sont pas nommés (on ne peut s'empêcher de penser à ces banquiers voyous qui reprochent à leurs victimes d'avoir fait preuve de cupidité).
Derrière la crise islandaise - quelle surprise - on trouve des escrocs israéliens, à commencer par l'épouse du premier ministre Ólafur Ragnar Grímsson, Dorrit Moussaieff. La "First Lady" de Reykjavík, alias Madame Pied-dans-la-porte, a la triple nationalité israélienne-britannique-islandaise - très pratique... Autre arnaqueur "élu" : Robert Tchenguiz, milliardaire juif britannique d'origine iranienne. Tchenguiz a été le principal emprunteur de la Kaupthing Bank (voir plus haut 23 mai 2008) et, à ce titre, coresponsable de la faillite. Ce qui ne l'empêchera pas de réclamer plus tard un "dédommagement" de 2,3 milliards de £. Comment dit-on chutzpah en islandais ?...
La folie règne également à Francfort. A l'opposé de toutes les autres valeurs cotées au Dax, Volkswagen ne cesse de grimper depuis des semaines au rythme de 30, 50, 70, et parfois même 100 % par jour. L'action VW vaut maintenant 1.000 euros (200 début septembre). Là aussi, les explications logiques font défaut. Hedge funds contraints d'acheter à n'importe quel prix après avoir vendu à découvert ? Coup de main de Porsche* pour s'assurer le contrôle de l'entreprise ? Acte insensé d'un autre investisseur ?... (Malgré l'euphorie boursière, Volkswagen va très mal dans l'économie réelle : recul des ventes de véhicules, chômage "technique"... et des délais de livraison toujours aussi longs.)
* Comme l'a fait remarquer un analyste allemand, Porsche lui-même est devenu entre-temps une sorte de hedge fund, faisant plus de profit financier que de chiffre d'affaires commercial. 29 octobre 2008 : Oubliez tout ce que vous avez lu ou entendu sur les victimes de la crise, sur les gens qui ont perdu leur maison, leurs économies, leur emploi ou la perspective d'une retraite décente. Si quelqu'un est à plaindre, se dit-on à la lecture de
Ha'aretz,
c'est "le Juif le plus riche du monde", ce pauvre Sheldon Adelson, milliardaire et "philanthrope"*, patron de LVS, une société propriétaire de casinos à Las Vegas, Macao [et, à partir de 2010, Singapour]. En quelques semaines, l'action LVS a vu sa valeur boursière chuter de 80 %, soit 10 miilliards de dollars. Oh, ma mère !...
29 octobre 2008 : Oubliez tout ce que vous avez lu ou entendu sur les victimes de la crise, sur les gens qui ont perdu leur maison, leurs économies, leur emploi ou la perspective d'une retraite décente. Si quelqu'un est à plaindre, se dit-on à la lecture de
Ha'aretz,
c'est "le Juif le plus riche du monde", ce pauvre Sheldon Adelson, milliardaire et "philanthrope"*, patron de LVS, une société propriétaire de casinos à Las Vegas, Macao [et, à partir de 2010, Singapour]. En quelques semaines, l'action LVS a vu sa valeur boursière chuter de 80 %, soit 10 miilliards de dollars. Oh, ma mère !...
* Il finance les colonies sionistes en Palestine occupée.
Adelson a-t-il moins d'argent sur son compte ? A-t-il dû vendre à perte un de ses hôtels ? Bien sûr que non... C'est seulement la valeur comptable des "fruits de son travail" qui a baissé (provisoirement). Quand on détient, comme lui, 70 % du capital d'une société, on ne vend pas ses actions en bourse ; la "perte" reste donc purement virtuelle. Les vrais perdants, dans cette affaire, ce sont les petits actionnaires. De même bien sûr que les salariés de l'entreprise, la chute des cours étant une excellente occasion pour licencier du personnel et réduire les "frais généraux".
Nous ne sommes plus à l'époque de Frank Sinatra. Sur le "Strip" de Las Vegas, la mafia italienne a depuis longtemps cédé la place à une autre mafia autrement plus puissante et plus nocive - pas nécessairement plus belle mais toujours souriante.
Voir également la page suivante 10 avril 201230 octobre 2008 : La Fed fait passer son taux directeur à 1 % et annonce son intention de poursuivre en direction de zéro*. La banque centrale va-t-elle bientôt verser des intérêts aux banques lorsque celles-ci lui feront l'honneur d'accepter son argent (celui des contribuables) ? Cette politique aberrante permet bien entendu aux banquiers d'abaisser les taux créditeurs offerts aux épargnants, tout en laissant les taux débiteurs à un niveau élevé (si tant est qu'il soit encore possible d'obtenir un crédit). On continue donc d'évoluer simultanément dans deux directions opposées (déflation au profit du grand capital, inflation aux dépens de la masse des citoyens - voir plus haut).
* Six semaines plus tard, un autre taux, celui "versé" par l'Etat aux souscripteurs de bons du Trésor à trois mois, passera effectivement à 0 % - une première depuis la grande crise des années 1930. Le 9 décembre, le taux en question sera même négatif : -0,01 %. Comme dit le Financial Times, "les investisseurs sont prêts à payer pour avoir un placement sûr".31 octobre 2008 : Si dans le secteur bancaire, des dizaines de milliers d'employés modestes ont déjà perdu leur gagne-pain ou sont sur le point de le perdre, il en va tout autrement au sommet de la pyramide. Comme le révèle cet article du Daily Mail, les grands serviteurs de la finance vont toucher, en cette fin d'année 2008, plus d'argent que jamais, y compris ceux d'entre eux qui sont responsables de la débâcle. Quelques exemples : chacun des 443 cadres supérieurs de Goldman Sachs empoche en moyenne plus de 3 millions de £ (= 5 millions de dollars ou 4 millions d'euros) ; les banqueroutiers de Lehman touchent 1,5 million de £ chacun ; le patron de Northern Rock (banque renflouée par l'Etat en septembre 2007) rafle 400.000 £ ; etc... Joli cadeau de Noël aux frais du contribuable.
Autre cadeau : le vœu formulé par le patron de la Deutsche Bank le 21 mai 2008 a été exaucé. Désormais les actifs dépréciés peuvent être comptabilisés à leur valeur initiale. Conséquence directe : il n'est plus nécessaire d'entamer ses réserves pour compenser des pertes. Au lieu d'afficher un résultat négatif de 800 millions d'euros pour le troisième trimestre, la banque allemande annonce donc un "benéfice" net de plus de 400 millions. Ce tour de passe-passe est rendu possible par le plan de sauvetage du 13 octobre, dont le texte a été rédigé par les "stagiaires" de M. Ackermann.
Le PDG de la Deutsche Bank, fin démagogue, a renoncé à son bonus annuel. Il paraît qu'il lui reste encore quelques euros sur les 14 millions perçus l'année dernière - de quoi patienter en attendant le paiement compensatoire qui viendra certainement en 2009. Peter Sodann, un acteur très populaire dans l'est de l'Allemagne et commissaire de la série télévisée Tatort, a beaucoup choqué le monde de la politique et des affaires en déclarant : "Si j'étais un vrai flic, la première chose que je ferais, ce serait d'aller arrêter Josef Ackermann..."3 novembre 2008 : Au Venezuela, bien que les banques soient aux mains de la finance privée, la crise n'a pas encore fait de victimes. Comme l'a rappelé le président Chávez, l'Etat ne viendra jamais en aide aux capitalistes "en difficulté" ; au moindre signe négatif, les banques seront nationalisées.
Aux USA, autre son de cloche. Selon le Wall Street Journal, les provisions constituées par les neuf plus grandes banques américaines pour couvrir les indemnités et pensions à verser à leurs dirigeants, totalisaient fin 2007 plus de 40 milliards de dollars. Ces mêmes neuf banques ont reçu du fonds de "sauvetage" de Henry Paulson 125 milliards de fonds publics. Autrement dit, près d'un tiers des sommes prises aux contribuables servent à accroître la fortune personnelle d'une poignée de milliardaires et multimillionnaires new-yorkais.6 novembre 2008 : La BCE fait passer son taux directeur de 3,75 à 3,25 %. La Banque d'Angleterre l'imite (de 4,5 a 3 %).
10 novembre 2008 : Nouvelle aide financière publique de 27 milliards de dollars pour AIG. La compagnie d'assurances avait déjà bénéficié de 85 milliards le 16 septembre et - plus discrètement - d'une rallonge de 38 milliards en octobre. Soit un total de 150 milliards. Profiteur numéro un : l'escroc sioniste Maurice Greenberg, ex-PDG et grand actionnaire d'AIG (American Israeli Gangsters) - Avant de partir, l'administration Bush offre un cadeau de 150 milliards de dollars à ses amis.
11 novembre 2008 : La crise financière commence à se transformer en crise économique. Le secteur le plus touché, surtout aux Etats-Unis, est celui de l'automobile. General Motors* est au bord de la faillite, Chrysler ne va guère mieux. Le hedge fund Cerberus Capital Management, qui a fortement investi dans les deux groupes automobiles, cherche à obtenir pour eux (c'est-à-dire pour lui-même) une aide de l'Etat similaire au bailout dont bénéficient les banques - détails. Le patron de Cerberus, le milliardaire juif Steve Feinberg, voudrait aussi faire payer les gouvernements européens, qui craignent l'effondrement des filiales locales de GM, en particulier Opel Allemagne.
* Tandis que les dirigeants de General Motors prétendent qu'ils ont besoin des milliards de l'Etat pour "sauver les emplois à Détroit", on apprend qu'une somme d'au moins un milliard de dollars sera investie au Brésil.
Autre candidat à la manne publique, qui n'y avait pas droit jusqu'à présent : American Express. Pour y accéder, cet établissement va quitter le domaine étroit des cartes de crédit et devenir une banque "comme les autres" - c'est-à-dire "renflouable comme les autres". Même chose, en gros, pour GE Capital, la filiale financière du groupe General Electric. Bien que n'étant pas une banque, elle va néanmoins avoir droit à la couverture du FDIC à hauteur de 139 milliards de dollars. En cas de défaillance, c'est bien entendu l'Etat qui paiera et non le fonds de garantie bancaire qui ne dispose même pas de la moitié de cette somme. General Electric, autrefois un groupe purement industriel, a réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires 2007 dans le secteur financier.14 novembre 2008 : Pour la première fois depuis la création de la monnaie européenne (en 1999), la zone euro est officiellement en récession.
La prochaine bombe : le financement des collectivités locales (voir également plus haut Emprunts structurés)
L'agence financière Bloomberg (propriété du millardaire juif Michael Bloomberg, maire de New York) a intenté une action en justice contre les cinq Sages de Sion qui président la Fed. But de cette manœuvre gravement antisémitique (ou judaïquement honteuse, comme on voudra) : obliger Ben Shalom Bernanke et consorts à dévoiler au public quels titres (sans valeur) ils ont reçus "en garantie" des "prêts" de 1,5 billion de dollars accordés aux banques américaines (en tête desquelles Goldman Sachs et Citigroup). Cette somme astronomique, qui ne comprend pas l'aide publique de 700 (ou 850) milliards décrétée en octobre, alourdit le bilan de la Réserve fédérale en attendant d'être effacée sur le dos du contribuable. (Le 13 novembre, la Fed avait un total de bilan de 2.214 milliards, contre 1.770 milliards le 15 octobre et 870 milliards un an plus tôt.)20 novembre 2008 : Citigroup, numéro un mondial de la finance il y a tout juste quelques mois, est sur le point de s'effondrer. L'action perd 50 % en deux jours (moins 90 % depuis début 2007). On recherche d'urgence un repreneur. Est-ce l'annonce d'une nouvelle faillite crapuleuse à la Lehman ?...
La Banque Dexia, sauvée le 9 octobre grâce aux fonds publics français, belges et luxembourgeois, utilise une partie de cet argent pour financer les colonies juives de Palestine. On voit que la mafia sioniste profite sur tous les fronts.
En Allemagne, la banque publique LBBW de Stuttgart va recevoir de l'Etat un joli cadeau de 5 milliards d'euros. Une partie de ces fonds servira à "venir en aide" au pauvre milliardaire Adolf Merckle*, roi de l'industrie pharmaceutique (Ratiopharm).
* Début janvier 2009, Merckle se suicide. On ignore la raison exacte de ce geste.24 novembre 2008 : Citigroup est sauvé de la faillite grâce à une aide fédérale directe de 45 milliards de dollars, assortie de 305 milliards de garanties de l'Etat. A Londres, le gouvernement débloque 110 milliards de livres supplémentaires en faveur des banques.
25 novembre 2008 : La Fed va utiliser 600 milliards de fonds publics pour racheter aux banques leurs actifs hypothécaires sans valeur, plus 200 milliards pour la reprise d'autres créances menacées dans le secteur du crédit à la consommation. Depuis le début de la crise, le gouvernement américain a sacrifié au moins 4.000 milliards de dollars pour "venir en aide" aux spéculateurs. Bloomberg pense que la somme réelle pourrait être deux fois plus élevée.
28 novembre 2008 : La BayernLB de Munich (secteur public) a besoin de 30 milliards d'euros pour amortir ses pertes : peanuts, comme on dit en bavarois.
4 décembre 2008 : La BCE fait passer son taux directeur de 3,25 à 2,5 % ; la Banque d'Angleterre abaisse le sien de 3 à 2 %.
10 décembre 2008 : Dans un éditorial du Financial Times, le sioniste Gideon Rachman, revendique à haute voix ce que ses acolytes de la City et de Wall Street ne réclament encore qu'en chuchotant : la formation d'un gouvernement mondial. C'est le seul moyen, paraît-il, de venir à bout de la crise financière, de la crise climatique et de la crise du terrorisme (une crise réelle et deux pseudo-crises dues à ces mêmes gangsters).
11 décembre 2008 : Le financier juif Bernard Madoff, patron du hedge fund BMIS et ancien président de la bourse NASDAQ de New York, est accusé de faillite frauduleuse après avoir escroqué la bagatelle de 65 milliards de dollars à l'aide d'un système pyramidal. Dans une arnaque de ce type, l'argent des clients n'est pas du tout investi en bourse ; le fonds de placement sert uniquement de couverture. Après avoir prélevé une commission bien rondelette, l'escroc utilise une partie des capitaux pour verser aux premiers souscripteurs un "dividende" largement supérieur à la moyenne habituelle. Ce qui, bien entendu, attire de nouveaux clients. Le système fonctionne à la perfection aussi longtemps que l'argent frais continue de rentrer et que personne - ou presque - ne demande à être remboursé. Mais avec la crise financière, les nouveaux investisseurs se font rares et les anciens retirent leur mise. La bulle finit par éclater.
Profitant de la situation, d'ignobles antisémites du FBI osent procéder à l'arrestation de Madoff, mais heureusement le juge le relâche aussitôt moyennant une caution de 10 millions. (C'est un peu comme si un comptable accusé d'avoir détourné 100.000 euros était libéré contre paiement de 20 euros.) Madoff a de bons avocats : Dan Horwitz et Ira Sorkin, très appréciés dans la communauté, vont certainement lui obtenir des circonstances atténuantes* (pour cause de choc financier) avec, au bout du compte, le sursis ou une extradition pure et simple vers Israël où il pourra se remettre de ses émotions**.
* Autre bon point : Madoff, comme le signale Sionipédia (ex-Wiki), est un grand philanthrope. Quelques-uns des objectifs de cette âme charitable : "Mettre un frein à l'assimilation et aux mariages mixtes qui menacent la communauté juive, permettre aux jeunes Juifs américains de découvrir Israël, et améliorer les moyens mis à la disposition des éducateurs juifs."
** La condamnation de Madoff interviendra le 30 juin 2009.
Parmi les victimes de l'escroc Madoff figurent plusieurs banques suisses, la BNP Paribas, le Crédit Mutuel-CIC, la Société Générale, le Crédit Agricole, Dexia, Fortis Pays-Bas, la Royal Bank of Scotland, HSBC et le groupe Santander. Pas grave, toutes ces banques n'auront qu'à se faire renflouer par leurs gouvernements respectifs - certaines d'entre elles pour la seconde fois en l'espace de quelques mois. Quant aux "investisseurs privés américains" arnaqués par Madoff (des Juifs aisés pour la plupart), ils seront indemnisés par Washington (c'est-à-dire par le contribuable). Après tout, ils n'y peuvent rien : comment auraient-ils pu se douter qu'un placement à 12 % comportait des risques ?
L'affaire Madoff : Mode d'emploi pour "antisémites" perplexes - par Israël Shamir, journaliste antisioniste israélien.
Shakespeare aurait certainement aimé Madoff :

Le Marchand de Venise
Portrait de l'usurier juif Shylock vu à travers le prisme déformant
de la judéophilie wikipédesque.
Une pièce que le lobby innommable n'a pas encore réussi à faire interdire.
Le drame de la finance :

Il suffit de 90 % de brebis galeuses
pour contaminer l'ensemble de la profession...12 décembre 2008 : Tandis que les trois géants américains de l'automobile (GM, Chrysler, Ford) sont au bord de la faillite, les responsables tentent de retarder le plus possible la mise en place d'un plan de sauvetage. But de la manœuvre : réduire massivement les salaires et faire main basse sur les fonds de pension - détails.
16 décembre 2008 : La Fed fait passer son taux directeur de 1 % à 0,25 %. Mais ce n'est pas parce que les banques ont la possibilité de lui emprunter toujours plus d'argent à des taux toujours plus bas, qu'elles accordent elles-mêmes davantage de crédits à leurs clients. Au contraire, elles conservent ces fonds sur leurs comptes auprès de la banque centrale en attendant que "la confiance revienne". En l'espace d'une année, le total des dépôts bancaires à la Réserve Fédérale est ainsi passé de 14 milliards à 778 milliards de dollars. Ce qui prouve bien que la politique du taux zéro ne crée aucune liquidité supplémentaire au profit de l'économie réelle. A ce stade, seuls des investissements publics massifs (comme à l'époque du New Deal de Roosevelt) pourraient sortir le pays de la récession-dépression. Les banques privées, elles, en sont bien incapables, et elles s'y opposent d'ailleurs farouchement.
L'objectif véritable des "élites" financières et économiques n'est pas la relance, mais une aggravation de la crise permettant une redistribution accélérée des richesses du bas vers le haut.27 décembre 2008 : Imitant General Electric (voir 11.11.2008), la filiale financière de General Motors se transforme en banque, grâce à quoi elle aura accès à tous les avantages réservés aux établissements bancaires (fonds de sauvetage, Fed, etc.). En tant que constructeur automobile, GM aurait dû se contenter des "miettes" accordées à l'industrie (15 milliards de dollars pour les "trois grands" de Détroit). C'est le banquier juif Ezra Merkin, partenaire financier de l'escroc Madoff*, qui devient le patron de la banque de General Motors - tout cela, bien entendu, pour "sauver" l'industrie automobile américaine.
* Parmi bien d'autres investissements, Madoff et Merkin détiennent une grande partie du capital de la banque israélienne Leumi - une excellente adresse pour blanchir l'argent sale de la mafia sioniste internationale. Il est d'ailleurs probable qu'une bonne partie des fonds escroqués en 2008 ont pris le chemin de Tel Aviv.
Who is Bernard Madoff, the man behind the $50 billion fraud ? - un très intéressant article de Christopher Bollyn, journaliste investigateur américain.
De source sûre, nous apprenons que l'Etat voyou juif d'Israël envisage également de se transformer en banque, ce qui lui permettrait de bénéficier d'une aide immédiate de 800 milliards de dollars. Cette somme (remboursable aux calendes grecques) servirait à combler le gigantesque déficit public (réel) du régime sioniste et à poursuivre la politique d'extermination ethnique dans le ghetto de Gaza. Les milliards raflés jusqu'à présent par les Shylock de Wall Street sont en effet insuffisants pour faire face au "danger" du Hamas.

Chèque, chèque, chèque, shekel...
Faites passer la monnaie...7 janvier 2009 : Aux Etats-Unis, après l'automobile, c'est l'industrie pornographique qui réclame une aide de l'Etat (5 milliards de dollars). Comme par hasard, il se trouve que la plupart des "industriels" de ce secteur d'activité sont juifs, notamment Ron Braverman, John Bone, Wesley Emerson, Paul Fishbein, Herbert Feinberg alias Mickey Fine, Hank Weinstein, Lenny Friedlander, Bobby Hollander, Rubin Gottesman, Fred Hirsch et ses enfants Steven et Marci, Paul "Norman" Apstein, Steve Orenstein, Jack Richmond, Theodore "Redstone" Rothstein, Reuben et David Sturman, Ron Sullivan, Jerome Tanner, Armand, Sam et Mitch Weston, etc... Cinq milliards partagés entre tous ces gens-là, ça ne fait pas beaucoup pour chacun (à peine 200 millions). Ils sont vraiment trop modestes... Un peu d'audace, les mecs, un peu de chutzpah ; l'industrie du jeu, l'industrie de la drogue et l'industrie de la prostitution sont déjà sur les rangs. (Comment ?... Toutes ces industries sont également à vous à plus de 50 % ?... Ah bon... Alors dans ce cas...)
8 janvier 2009 : La Banque d'Angleterre baisse son taux directeur à 1,5 %, le niveau le plus bas depuis 1694.
9 janvier 2009 : Le gouvernement fédéral allemand fait cadeau de 18 milliards d'euros à la Commerzbank et reçoit en échange 25 % du capital, mais renonce à participer à la gestion de l'entreprise comme il en aurait le droit. La valeur boursière des actions acquises par l'Etat ne dépasse pas 1,25 milliard d'euros, soit 14 fois moins que le prix payé !... Une partie de la somme versée par le contribuable allemand servira à financer le rachat du concurrent Dresdner Bank, jusqu'alors propriété de l'assureur Allianz.
Aux Etats-Unis, le gangster Madoff profite de sa liberté "surveillée" pour mettre à l'abri les actifs encore disponibles. Le parquet le prend la main dans le sac alors qu'il s'apprêtait à faire disparaître 173 millions de dollars. Vraiment antisémite, ce procureur... Heureusement que les juges, eux, ne le sont pas et qu'ils laissent Shylock en liberté. Sur les trois juges qui s'occupent de cette affaire, deux sont juifs (Gabriel Gorenstein et Theodore Katz), le troisième (Ronald Ellis) est un Noir qui a reçu des subsides de Madoff lorsqu'il travaillait pour la NAACP, une association pour la "promotion des gens de couleur". (Les sionistes adorent "promouvoir les gens de couleur", du moins les plus prometteurs et les plus dociles d'entre eux, comme par exemple Obama).14 janvier 2009 : La Deutsche Bank annonce pour le trimestre écoulé des pertes de 4,8 milliards d'euros. Apparemment, les artifices comptables (voir 31.10.08) ne suffisent plus pour masquer la situation réelle.
15 janvier 2009 : Le taux de la BCE passe de 2,5 à 2 %, en attendant pire - la chose est déjà annoncée pour février ou mars 2009.
La politique des taux extrêmement bas n'a pas pour but de "combattre la récession", comme le prétendent les banquiers, les politiciens et les médias, mais de déposséder un peu plus la masse des citoyens. Désormais l'argent déposé en banque ne rapporte pratiquement plus rien, tandis que l'inflation (pas les 3 % officiels de 2008 mais les 8 ou 10 % réels) dévore les sommes mises de côté. En revanche les taux pratiqués par les banques pour les crédits consentis aux particuliers et aux petites entreprises restent élevés, sous prétexte que les risques le sont également. La marge entre taux débiteurs et taux créditeurs n'a jamais été aussi grande.
L'absence de rémunération véritable des dépôts incite les particuliers à se tourner vers la bourse ou à acquérir des certificats et autres "produits" véreux qui, s'ils ne s'effondrent pas complètement eux aussi, coûtent les yeux de la tête à ceux qui ont le malheur d'en acheter. C'est bien là le but de la manœuvre : encaisser le plus possible en primes d'émission et frais de gestion (6 % à l'achat + 3 % annuels sont tout à fait courants).16 janvier 2009 : La Bank of America n'a pas encore digéré la reprise de Merrill Lynch (15 septembre 2008). Mais heureusement, il y a l'aide fédérale (20 milliards de dollars "cash" + 118 milliards pour garantir les actifs toxiques). Quant à Citigroup, l'ex-numéro un de la finance, il annonce 10 milliards de pertes supplémentaires. Après avoir vendu toutes ses filiales vendables dans l'espoir de se renflouer, le groupe est sur le point d'éclater.
22 janvier 2009 : Pratiquement toutes les banques britanniques sont maintenant en faillite "technique". La "nationalisation" totale, c'est-à-dire la recapitalisation permanente à l'aide de fonds publics sans aucun droit de regard de l'Etat sur la gestion, est pour ainsi dire accomplie. Mais tout cela est encore insuffisant. Au Royaume-Uni, mais aussi dans le reste de l'Europe et aux USA, les jongleurs de la finance, toujours aussi insatisfaits, exigent la création de "bad banks" dans lesquelles seraient concentrés tous les actifs sans valeur. Bien entendu, si l'on était en mesure d'opérer une distinction entre ce qui a encore de la valeur et ce qui n'en a plus, il est évident qu'on l'aurait fait depuis longtemps. C'est tout simplement une tentative de plus pour retarder la catastrophe finale sans rien changer au système. On a l'impression que le dernier acte est proche.
28 janvier 2009 : Aux Etats-Unis, la crise financière s'est depuis longtemps transformée en crise économique majeure - Témoignage édifiant à l'intention des américanophiles.
11 février 2009 : Le Congrès de Washington adopte un plan de stimulation de l'économie de 790 milliards de dollars : 510 milliards pour financer des "projets" encore assez vagues et 280 milliards de réductions fiscales dont on ignore à qui au juste elles profiteront. Le sioniste Tim Geithner, ministre des Finances et ancien patron de la Federal Reserve Bank of New York, s'efforce également de faire passer un paquet-cadeau supplémentaire de 2.000 milliards en faveur de ses copains de Wall Street.
Selon une estimation de Bloomberg, les différentes mesures prises au cours des derniers mois aux Etats-Unis se montent à un total de 9.700 milliards de dollars - une somme représentant 90 % de l'ensemble des crédits hypothécaires des particuliers, ou encore les deux tiers du PIB américain.17 février 2009 : A Munich, l'affaire Hypo Real Estate (voir plus haut - 5.10.08) prend des proportions toujours plus gigantesques. En l'espace de quelques mois, l'Etat a injecté plus de 100 milliards d'euros pour sauver cette banque de la faillite et empêcher ainsi un effondrement complet du marché national des obligations hypothécaires. Ce marché est à la fois la source privilégiée de refinancement immobilier outre-Rhin (surtout pour les grands projets) et la forme de placement grand public la plus sûre depuis près de 150 ans.
Les problèmes de HRE ont commencé il y a quelques années avec l'entrée en force de private equity funds américains dans le capital de la banque, ce qui a entraîné une dérive spéculative incontrôlée. Ces fonds (JC Flowers, Grove International, Capital Research & Management, Close Trustees Cayman, Orbis Global Bermuda) détiennent environ 47 % des actions HRE, le reste étant paraît-il aux mains de petits porteurs. La valeur boursière du titre est au plus bas, mais les requins de Wall Street refusent de vendre et exigent des pouvoirs publics qu'ils épongent indéfiniment les pertes sans intervenir dans la gestion. Bien entendu, la solution la plus simple consisterait à nationaliser purement et simplement HRE, comme cela a été fait en Angleterre et dans d'autres pays, mais le gouvernement allemand s'y refuse pour ne pas "violer les droits des actionnaires" (lisez : les droits des vautours).18 février 2009 : Nouvelle arnaque à la Madoff : le financier et milliardaire texan Allen Stanford vole 8 milliards de dollars à ses clients et peut lui aussi rester en liberté. Le FBI se contente de le localiser en Virginie sans l'arrêter - et ce, bien que le danger de fuite soit évident. Le siège de l'empire Stanford se trouve en effet à Antigua-et-Barbuda, un petit paradis fiscal des Antilles dont l'escroc est également citoyen. La fortune personnelle connue de Stanford se monte à trois fois le PIB annuel de cet Etat indépendant.
Washington : sur les 790 milliards de dollars prévus au plan de relance, 75 milliards seront utilisés, paraît-il, pour sauver neuf millions de familles en difficulté et empêcher qu'elles ne perdent leurs maisons. Avec 8.000 dollars en moyenne par famille, ce n'est pas de "sauvetage" qu'il faudrait parler, mais de sursis. On donne tout simplement de l'argent aux banques pour qu'elles acceptent un moratoire ; les dettes des familles menacées ne disparaissent pas pour autant.19 février 2009 : Fin du secret bancaire suisse : l'UBS transmet aux autorités fiscales des Etats-Unis les données confidentielles de ses clients américains. Cette mesure approuvée par le gouvernement de Berne intervient apparemment sans nécessité réelle, pour des raisons purement politiques.*
Lutte contre la fraude fiscale ou mainmise sur le système financier international ? "Malgré les apparences, cette manœuvre ne vise pas à obtenir des informations, car Washington les détenait probablement déjà, mais à casser la place bancaire suisse. L'Empire tente d'éliminer par la force les 'paradis fiscaux' qu'il ne contrôle pas, au profit des siens qu'il protège."
Depuis les années 1990, la Suisse est dans le collimateur de la mafia sioniste - voir l'affaire des "fonds en déshérence", qui a coûté des milliards à l'UBS et au Crédit Suisse. On sait que ces milliards sont allés enrichir les organisateurs de l'Industrie de l'Holocauste (Shoah Business). Un des principaux agitateurs de la campagne antisuisse de 2009 est le député juif américain Carl Levin.
Lire aussi : La Suisse : un obstacle à la dictature financière de l'UE
* Plus tard, on découvrira petit à petit les dessous du scandale UBS. A Washington, une commission fédérale conduite par le sioniste Carl Levin menaçait secrètement d'entamer une procédure contre la banque de Zurich pour le cas où celle-ci refuserait de trahir ses clients américains. Si le public avait eu vent de l'affaire, le cours de l'action se serait effondré, ce qui aurait eu des conséquences incalculables non seulement pour la banque mais aussi pour l'économie suisse dans son ensemble. Le directoire de l'UBS et le gouvernement de Berne ont donc cédé, sachant parfaitement qu'il ne s'agissait que d'une première étape. Leur volonté de résistance était de toute manière assez faible.24 février 2009 : L'assureur américain AIG, qui avait déjà reçu 150 milliards de dollars de fonds publics en 2008 (voir plus haut), a besoin de 60 milliards supplémentaires. L'Etat lui en accorde 30 dans un premier temps. Sachant qu'AIG a émis pour 500 milliards de dollars de CDS (credit default swaps), il y a fort à parier qu'on n'en restera pas là.
En Europe, comme au bon vieux temps, la grande menace vient de l'Est. Les banques ouest-européennes détiennent l'équivalent de 1.700 milliards de dollars de créances (1.350 milliards d'euros) que les pays "réformés" ne pourront sans doute pas rembourser.
La prochaine déferlante arrive d'Europe de l'Est par William Engdahl.26 février 2009 : La Royal Bank of Scotland (entre-temps "nationalisée") annonce des pertes de 24 milliards de livres (27 milliards d'euros). Qui plus est, la RBS détient encore pour 325 milliards de livres d'actifs toxiques. Le principal responsable de la catastrophe, l'ancien PDG Fred Goodwin (banquier juif écossais) a touché une indemnité de départ de 8 millions de £ assortie d'une pension annuelle à vie de 650.000 £ (= 60.000 € par mois). A 50 ans et après 9 ans passés à la RBS, Goodwin estime qu'il a bien mérité sa retraite.
27 février 2009 : Dans la zone euro, l'Irlande est le pays le plus touché par la crise économique. Des voix s'élèvent à Dublin pour réclamer l'abandon de la monnaie unique - détails. (Les Irlandais avaient dit non au référendum européen de juin 2008.)
5 mars 2009 : Nouvelle baisse des taux directeurs de la Banque d'Angleterre (à 0,5 %) et de la Banque centrale européenne (à 1,5 %).
17 mars 2009 : L'assureur américain AIG, bénéficiaire de 180 milliards de dollars de fonds publics, fait parler de lui après avoir accordé 180 millions de gratifications à ses dirigeants (soit 0,1 % des sommes dilapidées). Comme le fait remarquer Eliot Spitzer (voir plus haut), le vrai scandale n'est pas là : The real AIG scandal it's not the bonuses. It's that AIG's counterparties are getting paid back in full. Les véritables profiteurs sont les banques de Wall Street, en tête desquelles Goldman Sachs. Comme par hasard, le PDG de cette banque, Lloyd Blankfein, est coresponsable, avec Bernanke, Paulson et Geithner, du plan de "sauvetage" d'AIG.
19 mars 2009 : Après avoir épuisé toutes ses munitions en matière de politique des taux, la Fed annonce qu'elle va racheter aux banques pour 300 milliards de dollars de bons du Trésor et autres emprunts publics. Cette mesure, qui serait compréhensible si l'Etat disposait d'excédents lui permettant un amortissement anticipé de ses dettes, est inattendue dans le contexte actuel. Elle équivaut à transformer en monnaie disponible immédiatement ("planche à billets") des obligations d'Etat normalement payables à plus long terme. Le bilan de la Fed devrait s'en trouver gonflé dans les prochains mois.
Autre mesure de la banque centrale américaine : elle va racheter aux banques pour 750 milliards supplémentaires d'emprunts immobiliers dévalorisés. (Elle a déjà acquis précédemment pour 500 milliards de ces actifs toxiques.)23 mars 2009 : Le Trésor américain (ministère des Finances) présente un nouveau plan d'un volume de 1.000 milliards de dollars, destiné à absorber les actifs dépréciés des banques. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que le plan en question fait en grande partie double emploi avec les mesures annoncées par la Fed quatre jours plus tôt. Le Trésor va s'engager à hauteur de 100 milliards, tandis que le reste sera pris en charge par la banque centrale et par... des investisseurs privés. Autrement dit, le naufragé va se sauver de la noyade en se lançant une bouée de sauvetage. Espérons qu'il réussira à l'attraper.
En accumulant des initiatives plus confuses les unes que les autres, le gouvernement Obama (au service de Wall Street) veut donner l'impression qu'il fait quelque chose et que cela ne coûtera rien au contribuable. Le réveil risque d'être brutal...2 avril 2009 : Baisse du taux directeur de la BCE à 1,25 % (record historique).
A Londres, réunion-spectacle du G20*. Résultat : cadeau de mille milliards de dollars au FMI et à la Banque mondiale (les sionistes Strauss-Kahn et Zoellick se frottent les mains), "meilleure surveillance" des hedge funds et des agences de notation (poudre aux yeux), "nouvelles règles" sur les salaires et les bonus des dirigeants de la finance (diversion - les réunions style G20 coûtent au moins autant), offensive contre certains paradis fiscaux (boucs émissaires de la crise) et pour finir, assouplissement des règles comptables (permettra aux banques de faire comme si leurs actifs toxiques n'étaient pas dépréciés).
* Le Groupe des 20 comprend les pays suivants : USA, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Australie, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Russie, Turquie, Arabie saoudite, Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Afrique du Sud et Union européenne.
Ces sommets de plus en plus fréquents (G20, G7, G8, Davos, etc.) et de plus en plus chers (car soi-disant menacés par le "terrorisme international") ont pour seule fonction de rassurer l'opinion et de doper provisoirement la bourse. Les véritables décisions sont prises en cercle restreint, sans témoins et sans journalistes. Le moteur du "nouvel ordre mondial" salué par le premier ministre anglais Gordon Brown, c'est le "G2" dont personne ne parle (USA + mafia financière internationale).
A qui profite la fin du secret bancaire ? par Jean-Claude Paye. On s'attaque à la Suisse, au Luxembourg et même à la Belgique, mais les vrais paradis (City de Londres, Jersey, Caraïbes, Delaware...) restent tabous.6 avril 2009 : On apprend que le banquier juif Ezra Merkin (voir 27.12.2008) a reçu de l'escroc Madoff 470 millions de dollars de "commissions". Il servait de rabatteur dans l'arnaque du siècle. Merkin est propriétaire de trois hedge funds (Ascot, Gabriel et Ariel) et président de la synagogue de la 5ème Avenue, la plus riche des Etats-Unis.
17 avril 2009 : Depuis quelque temps, la bourse remonte, entraînée par les titres financiers. Pas étonnant, l'artifice comptable du G20, qui permet aux banques de réévaluer leurs actifs dépréciés en leur attribuant la valeur qu'ils avaient au départ, joue maintenant à fond. C'est un peu comme si un particulier ruiné avait la possibilité légale d'obtenir un crédit de sa banque en lui remettant en gage - au prix d'achat initial - des certificats Lehman à présent sans valeur. Dans ce cas précis, la chose serait pourtant défendable moralement, vu que les banques ont souvent agi de façon criminelle en vendant ces titres empoisonnés à des clients confiants et inexpérimentés. Malheureusement, les lois n'ont pas pour but de protéger les victimes de la crise, mais d'aider les responsables du pillage.
Autre aspect de cette complicité destinée à enrichir toujours plus les prédateurs : le "partenariat" public-privé décrété le 23 mars pour absorber les actifs dépréciés des banques, implique en fait que pour chaque million "investi" par le privé dans ce projet, l'Etat s'engage à hauteur de 925.000 dollars. Pour les "investisseurs", l'opération ne comporte un risque que si la perte réelle dépasse 92,5 %. Dans le cas contraire, ils empochent la totalité des profits. Dans ces conditions, il est évident que le "naufragé" n'a pas à s'inquiéter...7 mai 2009 : Le taux de la BCE passe à 1 %.
29 mai 2009 : Les statisticiens-illusionnistes de la zone euro annoncent sans rire que l'inflation est tombée à 0,0 % en mai sur un an. Le taux réel, lui, n'est jamais publié ni même calculé. S'il a baissé un peu par rapport à 2008, il devrait encore se situer entre 5 et 10 %.
19 juin 2009 : Pour accréditer l'idée que le gros de la crise financière est surmonté, plusieurs grandes banques américaines remboursent une petite partie des fonds empruntés au Trésor. Il est question de 68 milliards de dollars en tout - ce qui représente à peine 1 % de l'aide totale. Pendant ce temps, les petites banques de province continuent de sauter les unes après les autres - déjà 40 depuis le début de l'année, 65 depuis le début de la crise.
L'économie réelle est frappée de plein fouet, et même des géants comme General Motors sont mis en faillite. Le chômage croît à vue d'œil.
L'administration Obama annonce une "réforme" financière qui constitue en fait une véritable capitulation devant Wall Street : Obama's Surrender to Wall Street par Michael Hudson, économiste, professeur à l'Université du Missouri à Kansas City. Guidé par ses conseillers sionistes (voir Jewish Power), comment le nouveau président pourrait-il produire autre chose ?
La Fed, principale responsable du désastre actuel, se verra accorder des pouvoirs accrus pour "contrôler" l'ensemble du système. Mais rien ne sera fait pour empêcher la fraude et les arnaques ; les requins resteront à l'abri de poursuites judiciaires émanant d'autorités locales. Rien non plus ne viendra limiter la création de "produits" financiers. Hudson : "L'économie a besoin d'un nouveau Franklin D. Roosevelt ; c'est le contraire qu'on lui donne. M. Obama avait promis le changement ; il défend le statu quo."30 juin 2009 : L'escroc Madoff - voir plus haut - est condamné à 150 ans de prison. Si nos calculs sont exacts, il sortira de taule en 2159, à l'âge de 221 ans. En supposant qu'il vive aussi vieux que ses "ancêtres" bibliques Noé (mort à 950 ans) ou Mathusalem (mort à 969 ans), il lui restera suffisamment de temps pour profiter de sa retraite. Comme on n'a récupéré qu'un petit milliard de dollars sur les 65 disparus, les "vieux jours" de Madoff semblent assurés.
Plus sérieusement, il est probable que l'escroc ne finira pas sa vie en prison. Au plus tard dans quelques années, il sera relâché pour raisons de santé ou pour bonne conduite.
Toujours est-il que cette condamnation sévère a beaucoup surpris, car la justice américaine fait normalement preuve de mansuétude pour les criminels en col blanc. Il faut dire que Madoff avait franchi une ligne rouge, ne limitant pas ses arnaques à la clientèle habituelle, mais escroquant aussi de riches investisseurs de la communauté juive. La justice américaine - très proche de cette communauté - ne pouvait pas classer le dossier ; on imagine les pressions qu'elle a dû subir au cours des six derniers mois.
Le procès a néanmoins eu lieu à la va-vite, ne laissant à personne l'occasion de s'interroger sur les complicités des instances dites de contrôle. Madoff "au trou", c'est la "preuve" qu'il s'agit d'une bavure atypique et que le système lui-même fonctionne très bien.
Et pourtant, un second Madoff - beaucoup plus modeste, il est vrai - vient de défrayer la chronique en Afrique du Sud. Barry Tannenbaum, financier juif lui aussi, a fait disparaître 15 milliards de rands (= 2 milliards de $US ou 1,4 milliard d'euros).6 juillet 2009 : La presse financière annonce que la Bank of America vient de détrôner l'UBS à la tête des gestionnaires de fortune. Manœuvre réussie, pourrait-on dire. Une banque suisse qui accepte de trahir ses clients à la demande de Wall Street, ne mérite pas autre chose.
10 juillet 2009 : La Commerzbank allemande, qui vit aux crochets du contribuable depuis le 9 janvier 2009, se flatte de la place de choix qu'elle occupe dans la vente de dérivés financiers. Malgré la crise, le nombre de "produits" offerts sur les marchés n'a pas baissé, au contraire : on en dénombre aujourd'hui plus de 96.000 différents. L'argent public dont on a inondé le système bancaire jusqu'à présent ne sert pas à "faciliter le crédit aux entreprises", comme on le prétend, mais à alimenter une nouvelle bulle. Les banquiers n'ont toujours rien compris et reprochent même à leur clientèle "de réagir de manière extrêmement émotionnelle, sans se montrer sensible à aucun argument logique". Incroyable...
14 juillet 2009 : Aux USA, les grandes banques de Wall Street, à commencer par Goldman Sachs, annoncent de faramineux profits, plus élevés encore qu'avant la crise. Pas étonnant, avec tous les cadeaux reçus de l'Etat et tout cet argent qui coule à flot au taux de 0 %... Comme les taux débiteurs, eux, restent très élevés, il en résulte que le crédit n'a jamais été si lucratif pour les banques américaines. Mais la spéculation purement financière est plus lucrative encore. C'est pourquoi la bourse se porte bien - contrairement à l'économie réelle.
31 juillet 2009 : Les petites banques américaines de province sont toujours plus nombreuses à faire faillite. On en est maintenant à un total de 69 depuis le 1er janvier 2009, dont 29 rien qu'au cours des six dernières semaines (une par jour).
En Europe, le taux d'inflation officiel (imaginaire) tombe à -0,6 %.
Un texte très édifiant : Goldman Sachs - La grande machine à bulles - article de Matt Taibbi paru dans le magazine Rolling Stone et traduit par Jean Lasson pour Agoravox : "La puissance et le pouvoir sans précédent de la banque lui ont permis de transformer l'Amérique en une pompe à fric géante, manipulant pendant des années des secteurs économiques entiers, déplaçant ses pions quand tel ou tel marché s'effondre, et tout le temps se gorgeant de coûts cachés qui brisent des familles partout - prix du pétrole, taux des crédits à la consommation, fonds de pension à moitié mangés, licenciements massifs, futurs impôts pour rembourser les renflouages. Tout cet argent que vous perdez, il va quelque part et, au sens propre comme au figuré, il va à Goldman Sachs. Cette banque est une immense machine, hautement sophistiquée, pour convertir la richesse utile en la substance la moins utile, la plus gâchée qui soit - le pur profit d'individus déjà riches."
Goldman Sachs est la seule banque qui soit sortie enrichie de cinq bulles financières qu'elle a elle-même créées (soit seule, soit en compagnie d'autres escrocs) : la bulle de 1929, la bulle de l'Internet, la bulle de l'immobilier, la bulle du pétrole, la bulle du renflouement des banques. Et la prochaine sera une bulle de CO2 - vive le réchauffement financier...1er septembre 2009 : Le gouvernement irlandais fait appel à Rothschild Investment Banking (!) pour "remettre en ordre" son système bancaire durement touché par la crise. Rothschild "conseille" déjà l'administration Obama en matière de restructuration de l'industrie automobile (General Motors).
Aux Etats-Unis, on a enregistré 20 nouvelles faillites bancaires au mois d'août (total depuis le 1er janvier : 89). Le fonds de garantie bancaire FDIC commence à manquer d'argent.15 septembre 2009 : Un an après la faillite de Lehman Brothers, on ne fait toujours rien pour stopper les spéculateurs. Au contraire, on les encourage en permettant la création de nouveaux "produits" potentiellement toxiques : Wall Street veut titriser la mort - ou comment la finance va profiter de la "réforme" des soins de santé de Barack Obama.
"L'idée de nos petits génies de la finance, c'est d'acheter des 'life settlements', c'est-à-dire des polices d'assurance vie que les personnes âgées et malades seront bien contentes, en fonction de leur espérance de vie, de vendre pour une poignée de dollars afin de payer leurs soins médicaux. Par exemple, des polices d'une valeur d'un million de dollars pourraient se vendre pour 400.000 dollars. Ensuite, à l'image des valeureux 'subprimes', il s'agit de titriser ces polices en les regroupant en paquet de centaines ou de milliers. Les banques revendront alors ces titres à des investisseurs qui recevront l'usufruit des assurances vie quand les personnes mourront. La logique nous informe que la marge de profit augmente en fonction de l'abaissement de l'âge du décès du titulaire de l'assurance vie. On a tout intérêt à garantir que ce dernier ne vive pas plus longtemps qu'espéré, car l'investisseur verrait ses revenus baisser et perdrait même de l'argent. Pour Wall Street, c'est du gagnant-gagnant, car les banques encaisseraient une marge juteuse pour l'émission, puis la vente, et enfin l'échange des titres."
Lire aussi : La grippe H1N1 pourrait faire le bonheur de la titrisation des assurances vie
Le "sauvetage" de Fannie Mae et Freddie Mac, qui perdure depuis avril 2008 (voir plus haut 25.4.08, 11.7.08 et 8.9.08), a déjà coûté au contribuable américain plus de 1.000 milliards de dollars. Si l'on en croit le Washington Post, ce chiffre continue de grimper rapidement et pourrait atteindre 5.000 milliards, soit la quasi-totalité des prêts immobiliers couverts par les deux établissements.20 novembre 2009 : Deux ans et demi après les premiers signes de défaillance sur le marché des subprimes américains et plus d'un an après la liquidation de la banque Lehman, on peut se demander où en est la crise. Le pire est-il derrière nous, comme le suggèrent certains ? Ou bien faut-il, au contraire, croire ceux qui affirment que nous n'avons encore rien vu ?

Jusqu'à présent, les responsables politiques, conseillés par les grands banquiers fauteurs de crise, se sont contentés de traiter les symptômes au lieu de s'en prendre aux causes. Leur action se limite à débloquer des centaines et des centaines de milliards et à débiter des lieux communs - voire des quasi-bushismes comme le "Nous voulons que les banques se dotent de fonds propres" de François Fillon.* (Et si le gouvernement français se dotait de ministres ?...)
* Quelque temps plus tard, son patron dira : "Il faut limiter la taille des banques..." Comme si cela avait le moindre rapport avec la crise, et comme si on ne nous rabâchait pas mille fois par jour que, pour être viable à l'échelle mondiale, une entreprise doit voir grand, toujours plus grand.

" Small is beautiful...
A partir de dorénavant, aucune banque hexagonale
ne pourra faire plus de 1 m 62. "
Les actifs toxiques sont toujours là. La haute finance continue d'en créer de nouveaux chaque jour, et personne ne songe à la stopper. Pour la forme, on parle depuis un an de "limiter les boni", mais au sommet rien de tel ne s'est produit, bien au contraire.
Comme les médias mesurent l'intensité de la crise en regardant le niveau atteint par le Dow-Jones ou le CAC 40, et que les sommes astronomiques offertes aux banquiers ont stimulé la spéculation boursière, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On croit revivre - au ralenti - l'histoire de l'homme qui se jette du toit d'un gratte-ciel et qui se dit, en passant devant le 50ème étage, que les choses ne se déroulent pas trop mal puisqu'il est encore en vie.
Les conséquences de la crise pour l'économie réelle n'intéressent pas les journalistes, pas plus que le sort de la masse des citoyens. Le taux de chômage officiel, maintenu artificiellement à un niveau "acceptable", permet aux "élites" de faire comme si rien n'avait changé.25 novembre 2009 : Qui l'eût cru ?... La crise frappe Dubaï, jusqu'alors l'économie la plus dynamique du Moyen-Orient. L'émirat est menacé de faillite. Dubai World, la holding publique propriétaire de l'île artificielle en forme de palmier, est dans l'impossibilité de rembouser les 59 milliards de dollars qu'elle doit aux investisseurs étrangers ; elle demande un moratoire à ses créanciers (parmi lesquels des banques européennes comme HSBC, Barclays, Lloyds, RBS, Crédit Suisse, BNP Paribas). Dubaï, qui fait partie des Emirats arabes unis, affiche à lui seul une dette totale de 80 milliards, dont 70 milliards dus par ses entreprises publiques. Si les Emirats sont riches en pétrole (en particulier Abu Dhabi), ce n'est pas le cas de Dubaï dont la prospérité repose (ou reposait) sur les services : tourisme, immobilier, transports aériens, exploitations portuaires un peu partout dans le monde, commerce à grande échelle, finance internationale, etc.
Toutes ces activités, démesurées pour un pays de cette taille (4.000 km², 1,6 million d'habitants), sont en train de s'effondrer. La tour Burj-Dubai, la plus haute du monde (828 mètres, 164 étages), semble tenir bon, elle, mais l'aménagement intérieur n'est pas terminé et nul ne sait quand il le sera. Des douzaines d'autres chantiers de construction sont en panne faute d'argent.

30 novembre 2009 : L'Union européenne capitule un peu plus face aux USA. Toutes les données concernant les virements internationaux réalisés via SWIFT sont officiellement mises à la disposition des services secrets américains. Cette pratique immorale, en vigueur depuis le 11 septembre 2001 et révélée en 2006, est donc maintenant "légalisée" - à sens unique - au nom de la lutte contre un prétendu "terrorisme international". Elle sert, bien entendu, les véritables terroristes internationaux qui contrôlent de plus en plus le monde par Etats-Unis interposés. (En fait, ce ne sont pas seulement les virements, mais toutes les autres données bancaires - jusqu'à un certain niveau - qui deviennent potentiellement transparentes pour les maîtres de la planète.)
1er décembre 2009 : Nouvelle arnaque pyramidale à la Madoff. Scott Rothstein, avocat et financier juif de Fort Lauderdale en Floride (Fraud Lauderdale pour le FBI), escroque un peu plus d'un milliard de dollars. Une broutille, serait-on tenté de dire, à côté des 65.000.000.000 du Shylock new-yorkais. Trois mois plus tôt, un journaliste indépendant qui avait osé enquêter sur une affaire de pots-de-vin versés par Rothstein à des politiciens locaux, s'était vu menacé par lui : "Je suis le vengeur juif, je vous détruirai..." A l'époque, on ignorait encore tout des magouilles financières du "Jewish Avenger".
7 décembre 2009 : Le bruit court que la Grèce (membre de l'UE et de la zone euro) est au bord de la faillite, mais il est assez difficile d'y voir clair. Le pays a en effet accumulé une dette publique correspondant à 125 % de son PIB, mais d'autres pays européens - et non des moindres - sont à peine moins mauvais. La France affiche 82 %, l'Allemagne 79 %, l'Italie 116 %, la Belgique 100 %. L'économie grecque a toujours moins bien tourné que celle des "grands". On peut donc se demander pourquoi on s'en inquiète maintenant. Si les agences de notation, qui distribuent les mauvaises notes sans jamais être elle-mêmes notées, ont décidé de rétrograder la Grèce, c'est que les financiers qui les contrôlent préparent sans doute un mauvais coup.
(En février 2009, c'est l'Irlande qui était dans le collimateur de la spéculation internationale. Entre-temps, les Irlandais ont annulé et inversé leur non au traité de Lisbonne, et plus personne ne parle de ce pays - du moins pour le moment. L'Islande, de son côté, a été touchée beaucoup plus sévèrement par la crise, mais elle ne dépend ni de Bruxelles ni de la BCE.)9 décembre 2009 : Obama's Big Sellout par Matt Taibbi (dans le magazine Rolling Stone). Comment les conseillers du président (des hommes de Wall Street) ont transformé le sauvetage financier en grande braderie.
15 décembre 2009 : Selon la Banque des Règlements Internationaux, Bâle, le total des dérivés en circulation se monte à 605 billions (605.000 milliards) de dollars, contre 516 billions deux ans plus tôt. Au cours des derniers mois, loin d'avoir éliminé les "armes financières de destruction massive", Wall Street en a produit de nouvelles presque quotidiennement. 605 billions de dollars équivalent à 11 fois le PIB annuel de l'ensemble des pays de la planète.
21 décembre 2009 : Le hedge fund Appaloosa Management du milliardaire juif David Tepper, dont la spécialité consiste à reprendre des actifs "en détresse", a réalisé 7 milliards de dollars de bénéfices en 2009. Entre autres choses, Tepper avait "parié" sur le "sauvetage" du système par le gouvernement et acheté des titres bancaires quand les cours étaient au plus bas (par exemple Citigroup à 0,97 $ ou Bank of America à 2,50 $). En septembre 2009, ces mêmes actions valaient respectivement 5 et 15 $... Naturellement, chacun était libre de faire comme Tepper et de multiplier sa mise dans des proportions identiques. Mais sans être parfaitement au courant de ce que préparait l'administration Obama pour venir en aide à ses sponsors de Wall Street, il aurait fallu être fou pour s'y risquer. Sur les 7 milliards encaissés par Appaloosa, 2,5 milliards (= 1.800.000.000 d'euros) vont dans la tirelire personnelle du milliardaire.
Bien sûr, le vaillant David n'est pas le seul à s'être enrichi de la sorte, mais il est celui dont le Wall Street Journal (prononcez : Jew-rnal) parle avec le plus d'admiration. Le Time Magazine, lui, a choisi d'honorer Ben Shalom Bernanke, le président de la Fed, l'homme qui disait que pour éviter la crise, il suffisait de jeter des dollars sur Wall Street depuis un hélicoptère :

Helicopter Ben - Bankster of the Year22 décembre 2009 : Adieu l'euro ? Les conséquences de la crise grecque.
2 février 2010 : L'Union européenne et la zone euro contraignent la Grèce à des coupes budgétaires draconiennes dans le but de réduire sa dette publique. Le pays n'a plus la moindre souveraineté en matière économique et financière. Bruxelles et Francfort ont pratiquement placé Athènes sous tutelle. Il va en résulter un accroissement considérable du chômage et un démantèlement systématique de la protection sociale et des services publics.
Il ne fait aucun doute que d'autres pays européens suivront. Si la Grèce a été choisie pour commencer la descente aux enfers, ce n'est pas parce que sa position est beaucoup plus mauvaise que celle d'autres Etats. Sa taille modeste la rend seulement plus vulnérable. Et comme les syndicats y sont plus combatifs, il est certain que ce qui réussira à Athènes passera d'autant plus facilement partout ailleurs.
Les centaines de milliards d'euros de fonds publics gaspillés au profit de la finance internationale vont être récupérés sur le dos de la population, de même que les généreux cadeaux faits aux autres parasites de l'oligarchie et les dépenses astronomiques causées par les diverses guerres américano-sionistes. Après avoir ruiné les Etats, les banksters ont le culot de leur reprocher leur endettement excessif... et s'apprêtent à leur consentir de nouveaux crédits à des taux encore plus élevés. C'est ainsi que fonctionne le monde globalisé.
La deuxième phase de ce qui pourrait devenir la plus grande crise capitaliste de tous les temps, vient probablement de s'ouvrir. Et pourtant - c'est là le drame de la période actuelle - il n'existe aucune force organisée capable de s'opposer efficacement à la catastrophe.4 février 2010 : La Deutsche Bank annonce un benéfice net après impôts de 5 milliards d'euros pour l'année 2009. Ce résultat n'aurait pas été possible sans l'argent reçu grâce au renflouement public de Hypo Real Estate (HRE) dont la Deutsche Bank était un des gros créanciers (voir plus haut : 29.9.08, 5.10.08, 17.2.09) et dans une moindre mesure grâce au sauvetage de l'assureur américain AIG. Si les grandes banques semblent se porter si bien en ce début de 2010, ce n'est pas parce qu'elles ont assaini leurs comptes et leurs méthodes, mais parce que les sommes fabuleuses dont on les a inondées et les ressources quasiment gratuites qu'on continue de mettre à leur disposition cachent tout le sérieux de la situation réelle.
Pour détourner l'attention du public, la caste politico-médiatique d'outre-Rhin s'acharne contre les derniers restes du secret bancaire suisse (voir 19.2.09) et rend son voisin helvétique responsable de tous les maux : la crise financière mondiale, c'est à cause de l'UBS, du Crédit Suisse et de tous ces Guillaume Tell qui refusent de se plier aux volontés de Bruxelles... (Ironie du sort : le PDG de la Deutsche Bank, Josef Ackermann, a la nationalité suisse - inutile de préciser que l'indépendance de son pays est le cadet de ses soucis.)9 février 2010 : Contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à présent, ce n'est apparemment pas le dollar qui plongera le premier, mais plutôt l'euro. En l'espace de quelques semaines, le cours de la monnaie européenne est tombé de 1,50 $ à 1,36 $. Derrière cette évolution, on cherchera en vain un motif économique sérieux : la Grèce et l'UE ne sont pas plus "ruinées" que les Etats-Unis et rien ne justifie objectivement la panique actuelle. Comme toujours, les spéculateurs "anonymes" (les George Soros et les Goldman Sachs) agissent de manière totalement imprévisible (pour le grand public).
12 février 2010 : Le marasme économique frappe durement les USA et l'Europe. En dépit de l'habileté dont font preuve les bidouilleurs de statistiques, il est difficile de cacher que le chômage progresse inexorablement. En France, le PIB a reculé - officiellement - de 2,2 % en 2009, beaucoup moins qu'en Allemagne (5 %). Mais quand on sait que dans le même temps, la production industrielle française a chuté de près de 12 % et les exportations de 11 %, les doutes sont permis. Les donneurs de leçons de la zone euro reprochent à la Grèce d'avoir manipulé ses indicateurs économiques ; elle n'est certainement pas la seule.
16 février 2010 : Le magazine allemand Der Spiegel explique comment Goldman Sachs a aidé Athènes à camoufler l'ampleur de sa dette publique. Cette révélation est davantage dirigée contre la Grèce que contre la banque de Wall Street ; il est de bon ton, ces jours-ci, de présenter les Grecs comme des tricheurs et des fainéants. En fait, le montant dont il est question (un milliard d'euros) ne représente qu'une minuscule fraction de l'endettement de l'Etat : 300 milliards, pour un PIB de 242 milliards en 2008, soit 124 %. (L'Allemagne n'en est pas encore là, mais elle y va à pas de géant ; avec près de 80 %, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité.)
Comment procédaient les banquiers de Goldman Sachs ? Ils effectuaient avec la Grèce des opérations de crédit réciproques appelées currency swaps. Dans des conditions normales, un currency swap consiste pour une banque A à prêter, par exemple, un million d'euros à une banque B pour une durée déterminée, tandis que la banque B prête à la banque A, pour la même durée, l'équivalent en dollars. A l'échéance, chacun rembourse à l'autre la somme empruntée, éventuellement majorée d'une commission pour tenir compte du différentiel de taux d'intérêts des deux monnaies. L'avantage de cette opération est que la banque A peut disposer de dollars qui lui font provisoirement défaut, sans pour autant vendre les euros qu'elle possède et dont elle aura besoin plus tard - et inversement pour la banque B. Le risque de crédit est nul puisque chacun détient en garantie la monnaie de l'autre. Le risque de change n'existe pas non plus, sauf si l'une des banques vient à faire failite et que la monnaie "remise en gage" par elle se déprécie. C'est un risque que l'on peut gérer et, le cas échéant, compenser par une commission.
Dans le cas présent, Goldman Sachs a prêté au Trésor grec dix milliards d'euros, tandis que celui-ci n'a prêté aux banquiers new-yorkais que l'équivalent de neuf milliards. De la sorte, la Grèce a bénéficié d'un prêt occulte d'un milliard maquillé en opération de swap. Tandis que les emprunts publics sont déclarés comme tels et pris en considération par les autorités de la zone euro, les jongleries financières passent totalement inaperçues.
Inutile de préciser que cette opération a été très lucrative pour la banque de Wall Street... qui continue de s'enrichir en spéculant à la fois contre la Grèce et contre l'euro. Voir également plus bas : 15 novembre 2011
La Grèce s'est-elle ruinée ou a-t-elle été conduite par d'autres à la faillite ? par Karl Müller.6 mars 2010 : L'Islande (voir plus haut - 23.5.08) refait parler d'elle à propos de la faillite (frauduleuse) de la banque IceSave. Cette banque Internet de Reykjavík recueillait des fonds à l'étranger (principalement en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas) et les plaçait on ne sait trop où. L'effondrement de la banque, lucratif pour quelques privilégiés anonymes mais pas pour les clients, a laissé un trou de 3,7 milliards d'euros. Les gouvernements de Londres et de La Haye ont remboursé leurs nationaux mais veulent récupérer l'argent auprès de l'Islande. 3.700.000.000 € pour 300.000 habitants, cela représente, par personne, 12.000 € d'impôts supplémentaires, sans compter les intérêts.
Dans ces conditions, les Islandais se rebiffent, et c'est bien compréhensible. Un référendum a dû être organisé. Résultat : plus de 93 % des citoyens disent non* au pillage (1,8 % sont pour). Le gouvernement de Reykjavík, à la solde des maîtres du monde comme la plupart des gouvernements, a déjà cédé. Il ne tiendra pas compte de la volonté nationale. Son argument le plus pervers consiste à dire que faute de "rembourser" les 3,7 milliards, l'Islande ne pourra adhérer à l'Union européenne. Comme si l'UE présentait un quelconque avantage pour les Islandais, à l'exception du 1,8 % de profiteurs. Au contraire, dès que le pays sera membre de l'UE, il devra renoncer au seul atout qui lui reste : la pêche. Les chalutiers étrangers, mieux équipés, plus performants et surout plus nombreux, mettront vite fin à cette activité.
Avec la Grèce et l'Islande, on voit que les petits pays développés sont maintenant traités de la même façon que les pays du tiers-monde. Les pays moyens, comme la France ou l'Allemagne, disposent encore d'un sursis, mais pour combien de temps ?...
* Le 9 avril 2011, un deuxième référendum donne "seulement" 59 % de "non".17 mars 2010 : Hedge funds : l'Espagne, cheval de Troie de la City - "Face à l'opposition de la City de Londres et de Wall Street, la présidence espagnole de l'UE a retiré in extremis son projet visant à encadrer l'activité des hedge funds et autres fonds de private equity. Tout en disposant d'une majorité écrasante (26 des 27 !) contre Londres, la présidence espagnole de l'UE, au lieu de passer en force, a renoncé à mettre le texte au vote."
30 mars 2010 : Deux jours avant le 1er avril, les gouvernements français et allemand décident d'instaurer une taxe bancaire destinée à alimenter un fonds de sauvetage financier. Le produit de cette taxe représenterait (pour les deux pays) entre 1 et 1,2 milliard d'euros par an. Sachant que le sauvetage d'octobre 2008 a coûté 860 milliards (voir plus haut 13.10.08), le fonds pourrait être opérationnel dès 2727 (après seulement 717 années de cotisations).
20 avril 2010 : A New York, la Commission de contrôle des opérations de bourse (SEC) dépose une plainte civile pour fraude contre Goldman Sachs : Un volcan peut en cacher un autre. Début 2007, John Paulson, patron du hedge fund Paulson & Cie avait fait appel à GS pour trouver des pigeons susceptibles d'acheter du subprime. Alors que la banque savait que Paulson spéculait sur l'effondrement des obligations titrisées (CDO) créées à cette occasion, elle en vantait les mérites à ses clients et encaissait en retour une grassouillette commission. Autre scandale : Paulson avait fait assurer au moyen de CDS les titres toxiques qu'il voulait couler.
Conclusion du consultant américain Sylvain Raynes sur la magouille Goldman-Paulson : "C'est l'usage le plus cynique de l'information de crédit que j'aie jamais vu... Lorsque vous achetez une protection contre un événement que vous contribuez à susciter, c'est comme si vous achetiez une assurance incendie sur la maison de quelqu'un d'autre avant d'y mettre le feu."
Profitant de la situation, l'assureur AIG annonce son intention d'engager à son tour des poursuites judiciaires contre Goldman Sachs, la banque lui ayant fait perdre 2 milliards de dollars (pris en charge par le contribuable). Sachant que les trois protagonistes principaux de ce magnifique spectacle (Maurice Greenberg d'AIG, Lloyd Blankfein de Goldman Sachs et John Paulson) ont l'honneur et le privilège de faire partie du "peuple élu", il n'est pas difficile d'imaginer comment tout cela va se terminer.
ATS, HFT & Flash ou Goldman Sachs et l'arnaque informatisée
Depuis l'été 2009, on parle de plus en plus de ces techniques utilisées pour manipuler les marchés.
Les ATS (Alternative Trading Systems) sont des systèmes informatiques boursiers existant depuis une douzaine d'années, qui permettent d'équilibrer presque instantanément les ordres de vente et d'achat des opérateurs - ce qui prenait un certain temps autrefois car la plupart des ordres importants sont assortis d'un cours limite, et il s'agit de déterminer à tout moment le cours auquel le plus grand nombre d'ordres sera satisfait. Lorsque des humains faisaient ce travail, il était toujours possible de reconstituer et donc de comprendre ce qu'ils avaient fait. A présent que des ordinateurs ont pris le relais, plus personne ne sait ce qui se passe vraiment, à l'exception des manipulateurs eux-mêmes (c'est un peu comme pour le vote électronique).
L'idée de base du HFT (High Frequency Trading) consiste à "deviner" avant tout le monde (et avant les ATS) à quel cours limite les opérateurs sont disposés à vendre ou acheter. On a donc mis au point des programmes très sophistiqués qui permettent, à l'aide d'ordinateurs ultra-performants, d'obtenir ces informations à l'instant même où elles sont envoyées par les banques, c'est-à-dire avant qu'elles n'aient été traitées par le système. Tout cela se déroule - automatiquement, sans intervention humaine - en l'espace de quelques fractions de secondes ; un trader en chair et en os, même s'il est très rapide, ne peut réagir qu'après un délai de plusieurs secondes, voire minutes.
Supposons par exemple que quelqu'un veuille acheter 100.000 actions XYZ à 29,40 $ maximum*. L'ordinateur HFT l'ignore encore, mais il teste en permanence le marché en envoyant lui-même des ordres de vente limités ne portant que sur un très petit nombre de titres. Il s'agit d'ordres libellés IOC (immediate or cancel) qui seront automatiquement annulés si la limite n'est pas atteinte ; ils ont la durée de vie d'un éclair, d'où l'expression Flash Trade.
La limite choisie par le "robot" HFT est supérieure au cours du marché à cet instant (par exemple 29,20* contre 29,10). S'il n'y avait pas d'ordres limités, le premier flash ne donnerait rien mais comme il trouve une contrepartie (l'acheteur à 29,40), on peut continuer. L'ordinateur envoie donc un deuxième flash à 29,25 (qui fonctionne lui aussi) puis un troisième (à 29,30) et ainsi de suite jusqu'à 29,45. Là, l'ordre de vente est annulé : c'est signe que personne ne veut acheter à ce prix. Le flash suivant reviendra donc à 29,40 et portera sur une grande quantité de titres, 1.000.000 par exemple (dont seulement 100.000 changeront de main, le reste sera annulé). L'ordinateur achètera aussitôt "au mieux" (à 29,10 ou à un cours très proche) les 100.000 actions qu'il vient de vendre pour 29,40 (dont une poignée un peu moins cher). Bénéfice approximatif en moins d'une seconde : 0,30 x 100.000 = 30.000 $.
L'acheteur, lui, a payé 30.000 $ de plus que s'il n'y avait pas eu le HFT - pas grave, il y a des chances pour qu'il s'agisse d'un fonds de pension ou d'une autre vache à lait institutionnelle ou publique. De toute façon, il n'en saura rien. Et puis, il n'a pas vraiment été lésé puisqu'il était disposé à payer ce prix (au maximum). On ne lui a pas fait de cadeau, voilà tout. Bien sûr, on dira que l'acheteur, s'il avait été malin, aurait pu fixer un cours limite plus proche du cours du marché. Mais son banquier aura pris soin de lui expliquer auparavant que : 1) le cours est toujours affiché a posteriori et ne vaut que pour les transactions qui viennent juste d'être effectuées, par pour celles à venir - 2) les fluctuations peuvent être considérables d'un instant à l'autre - 3) un ordre limité a justement pour but de libérer le client de cette observation attentive et sans faille de l'évolution des marchés à la seconde près (observation impossible pour lui car il ne dispose pas des moyens techniques adéquats**).
* Un ordre d'achat limité à 29,40 ne sera exécuté que s'il se trouve un vendeur disposé à accepter ce prix ou un prix moindre. Un ordre de vente limité à 29,20 ne sera exécuté que s'il se trouve un acheteur disposé à payer ce prix ou un prix supérieur. Tous les ordres non assortis d'une limite sont exécutés "au mieux", c'est-à-dire au cours en vigueur sur le marché au moment de la transaction.
** Chaque banque d'une certaine importance publie ses propres cours en temps réel, et il est parfaitement impossible de tout suivre en même temps. Bien qu'elles s'en tiennent à l'essentiel, les salles de marchés ont cet aspect bizarre qu'on leur connaît, avec dix fois plus d'ordinateurs que de traders.
Depuis quelque temps, le HFT est utilisé massivement et représente maintenant près de 75 % de l'ensemble des transactions. Les gros calibres de Wall Street - Goldman Sachs en tête - en sont les profiteurs immédiats. Contrairement à la Bourse proprement dite, qui n'est ouverte que de 10 heures à 16 heures du lundi au vendredi, ATS et HFT fonctionnent 24 heures sur 24 à raison de 365 jours par an. L'escroquerie informatique rapporte à GS 100 millions de dollars par jour (36 milliards par an).
Le scandale a plus ou moins éclaté en juillet 2009, lorsqu'un ancien collaborateur de Goldman, Sergey Aleynikov, a été accusé d'avoir volé à son patron le code source d'un programme HTS. La presse a présenté l'homme comme un "programmeur". En réalité, il dirigeait le département Projets informatiques de la banque. Son "pedigree", que l'on peut voir sur LinkedIn, montre qu'il s'agit d'un spécialiste de haut niveau. Il a probablement écrit lui-même le programme "volé". La raison de son geste est que Goldman Sachs lui versait un salaire ridiculement bas compte tenu de ses mérites : 400.000 dollars annuels, ce qui est beaucoup pour un Américain moyen, mais insignifiant en comparaison des milliards qu'Aleynikov faisait gagner - et fait encore gagner - à GS. Tandis que les dirigeants de cette banque (Lloyd Blankfein, Gary Cohn et quelques autres oncles Picsou) doivent une bonne partie de leur fortune personnelle à cette arnaque, celui qui l'a mise au point est en prison. Le FBI l'a arrêté à l'aéroport de Newark alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour Moscou (son ancienne patrie) en attendant de continuer vers Israël (cette autre patrie qu'il a en commun avec ses voyous de patrons).
Entre-temps, beaucoup d'autres banques - que des clowns comme Obama et Sarkozy prétendent vouloir "contrôler" - surfent sur la vague HFT. Le 20 avril 2010, c'est un employé de la Société Générale de New York, Samarth Agrawal, qui est accusé d'avoir "volé un programme". Cette fois, le "coupable" est Indien.
Les véritables profiteurs, les pillards, les gangsters, les parrains qui dirigent l'économie américaine et la Maison Blanche, les fauteurs de crise, eux, n'ont pas de souci à se faire : ils ne seront jamais inquiétés.
A partir de mai 2010, Wall Street a également recours à une autre forme de manipulation électronique : le "quote stuffing" (voir plus bas).22 avril 2010 : Obama présente son projet de "réforme" financière, censé mettre au pas les banquiers de Wall Street. En fait, le texte a été rédigé sous la direction du sioniste Barney Frank, président de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, à l'initiative des nombreux conseillers sionistes juifs de l'équipe présidentielle (dont beaucoup ont des liens avec Goldman Sachs). Inutile de préciser que cette réforme bidon est approuvée par tous ceux qui ont leur mot à dire dans la haute finance new-yorkaise. A l'occasion de la présentation effectuée à la Cooper Union (université privée située non loin du district financier), les places d'honneur étaient occupées par Lloyd Blankfein et Gary Cohn (Goldman Sachs), Jamie Dimon et Barry Zubrow (JPMorgan), Tom Nides (Morgan Stanley), Bob Greifeld (Nasdaq), etc... Comme l'a remarqué un journaliste (juif), on se serait cru à une bar mitzva (une première communion juive).
Les "régulateurs" chargés de surveiller l'application de la "réforme" viendront du ministère des Finances (Tim Geithner et ses Jewish boys), de la SEC (Mary Schapiro, Arthur Levitt et Harvey Goldschmid), de la FDIC (Sheila Bair), de la Commodity Futures Trading Commission - CFTC (Gary Gensler) et de la Fed (Ben Shalom Bernanke et son directoire 100 % "élu") - encore une jolie liste de bar mitzva.
Tous ces gens sont satisfaits d'Obama. Aucun autre président avant lui, pas même Bush, ne leur a été aussi utile et dévoué. Entre eux, ils l'appellent le "schwartza" (le noir, en yiddish). Bien sûr, dans ses discours démagogiques destinés à Main Street, c'est-à-dire à l'homme de la rue, le président fait mine d'attaquer les excès de la finance.27 avril 2010 : Le patron de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, "témoigne" devant une commission "d'enquête" du Sénat de Washington sur le rôle joué par sa banque dans la magouille des subprimes. La commission est présidée par Carl Levin, sénateur juif sioniste du Michigan. Comme on dit à Hollywood : "The Jewish show must go on..."
28 avril 2010 : La spéculation internationale (toujours Goldman) s'acharne sur la Grèce. Pour faire face à ses échéances, l'Etat grec est obligé d'emprunter auprès des banques étrangères à des taux proches de 10 %, le triple de ce que paient des pays dits "solvables" comme la France ou l'Allemagne. Les agences de notation, auxiliaires de Wall Street, jettent de l'huile sur le feu en rétrogradant Athènes. Le FMI (officiellement : Fonds monétaire international - en réalité : Foutoir mafieux israélophile) déballe ses instruments de torture. Son patron, le gangster sioniste Strauss-Kahn, que les maîtres du monde ont décidé de placer à l'Elysée en 2012, fait parler de lui à longueur de journée. L'objectif du FMI, en Grèce et partout ailleurs, est d'effacer toutes les avancées sociales de ces cent dernières années et d'abattre tout ce qui fait encore obstacle à la destruction de la société telle que nous la connaissons.
Les banques françaises et allemandes sont fortement engagées en Grèce. Elles détiennent pour respectivement 80 et 40 milliards d'euros de créances sur ce pays (principalement sur l'Etat) et refusent de renouveler leurs crédits sans la caution de leurs gouvernements. Lorsque ceux-ci parlent d'aider la Grèce, c'est donc surtout à leurs propres banques qu'ils songent : Prendre aux pauvres en France pour donner aux banques françaises exposées en Grèce
Comme la crise actuelle n'a rien d'un problème grec, le Portugal et l'Espagne sont attaqués à leur tour ; les "grands" de la zone euro ne perdent rien pour attendre.6 mai 2010 : Le gouvernement "socialiste" grec - instrument de l'UE, du FMI et de Wall Street - impose à "sa" population des coupes drastiques qui vont se solder par une réduction des revenus de 30 % et plus. Et ce, dans un pays où le salaire moyen oscille autour de 1000 € par mois. La colère est grande à la base, mais les états-majors syndicaux grecs font tout leur possible pour la canaliser et l'étouffer. Les grèves et les protestations ont lieu en ordre dispersé. Hier les transports, aujourd'hui les enseignants, demain la voirie, les banques ou tel autre secteur du privé. Surtout pas tous ensemble, on risquerait de mobiliser des millions de victimes, ce serait trop dangereux. Alors que la nécessité d'une véritable grève générale - unanime, illimitée, politique - n'a jamais été aussi aiguë, tout est fait pour l'empêcher.
Pour aggraver les choses, une provocation criminelle, à Athènes, coûte la vie à trois personnes : des voyous incendient une agence bancaire au cocktail Molotov. Comme en décembre 2008, le gouvernement a recours à la pègre pour briser le mouvement populaire. Il y a un an et demi, on avait recruté des gangsters albanais pour faire cette besogne. Et aujourd'hui ?...
La crise dite grecque ne va pas tarder à s'étendre à toute l'Europe, c'est bien le but de la manœuvre. Déjà des voix dans l'entourage de Sarkozy - et pas seulement là - réclament la mise en place d'un gouvernement économique européen (qui faciliterait le pillage systématique du continent en court-circuitant d'éventuelles résistances nationales spontanées et constituerait une étape vers la "gouvernance mondiale" souhaitée par le grand capital). Malheureusement, il n'existe pas d'opposition organisée en Europe. Ce qui fait défaut à l'échelle nationale est à plus forte raison absent au niveau supérieur. Rien n'arrêtera les vautours.
On reste parfois stupéfait devant la stupidité de l'argumentation officielle. Pour combattre le déficit budgétaire, c'est-à-dire le manque de recettes fiscales et de cotisations sociales, on ne trouve rien de mieux que de créer encore plus de chômage, ce qui signifie bien sûr encore moins de recettes et de cotisations, donc davantage de déficit - une spirale mortelle. Il est vrai que la stupidité est une "qualité" indispensable pour bien réussir dans la sphère politique (et médiatique). Mais derrière elle se cache - malheureusement - la triste réalité : l'accomplissement d'un agenda destructeur visant à la tiers-mondisation de l'ensemble de la planète.
L'endettement public est un des prétextes avancés pour réaliser cet agenda. Tout comme un usurier n'a aucun intérêt à voir disparaître la dette de ses victimes, puisqu'elle lui permet de mieux les pressurer, les spéculateurs et les banksters vivent de la dette des Etats. C'est une chose que les Goldman, les Blankfein, les Paulson, les Bernanke, les Strauss-Kahn, les Soros et autres Shylock modernes connaissent mieux que quiconque. Ils sont bien placés pour savoir qu'elle se pratique depuis des siècles.
Il n'est pas nécessaire d'être devin pour se douter que tout cela va très mal se terminer. Dans le passé, les crises majeures (créées artificiellement comme la présente) ont presque toujours débouché sur la guerre.9 mai 2010 : En ces jours de crise, les responsables grecs savent marquer les priorités.
10 mai 2010 : Trois jours à peine après avoir fait cadeau de 110 milliards d'euros aux banquiers sous prétexte de "sauver la Grèce", les (ir)responsables européens débloquent 750 milliards supplémentaires pour "sauver l'euro", c'est-à-dire - encore une fois - pour garantir à la finance que les créances qu'elle détient sur les Etats, et que sa spéculation a rendues "douteuses", seront remboursées par le contribuable. Comme en octobre 2008, on nous raconte que cette "aide" est purement virtuelle, qu'il n'y aura aucun décaissement, que tout cela n'alourdit pas la dette publique. Si c'était vrai il y a dix-huit mois, on se demande pourquoi l'endettement a progressé si fortement, au point de mettre en danger la monnaie.
Autre décision fatale des "protecteurs" de l'euro : la Banque centrale européenne - organisme soi-disant indépendant des gouvernements - est maintenant tenue d'acheter les obligations d'Etat des pays menacés, c'est-à-dire de financer à l'aide d'argent frais la dette de ces pays. L'inflation ne va plus tarder.
Toutes ces mesures dictées par les banquiers aux politiciens n'ont qu'un effet : stimuler la bourse, en particulier les titres bancaires. Le cours de l'euro, après être remonté de 1,27 à 1,30 $ pendant quelques heures, retrouve son niveau d'avant le "sauvetage" et va probablement poursuivre sa dégringolade dans les prochains jours. Rien ne changera tant qu'on continuera de combattre l'incendie au lance-flammes.
Sauver les banques jusqu'à quand ? par Frédéric Lordon : "Sur la période 2005-2010, la dette publique grecque a été souscrite à 43 % par des banques, 22 % des fonds mutuels, 15 % des fonds de pension, 8 % des gérants (asset managers) et 4 % des hedge funds. Voilà la population des nécessiteux auxquels il est urgent que les fonds publics viennent en aide. Et à rappeler la sympathie spontanée qu'attirent tous ces braves gens, la question vient immanquablement à l'esprit de savoir pourquoi finalement on ne les laisserait pas choir."
Frédéric Lordon écrit aussi : "Un secteur bancaire privatisé n'est pas tolérable."
750 milliards : chronique d'une fin non annoncée par John Lloyds (avec, en bas de page, une très intéressante interview audio de François Asselineau).
Le politburo bruxellois veut instaurer une dictature économique sur la zone euro11 mai 2010 : Citation du jour (elle est de John Taylor, patron du hedge fund FX Concepts de New York, spécialisé dans la spéculation sur devises) : "L'euro est comme un poulet décapité qui court encore pendant quelques minutes avant de s'effondrer et de mourir pour de bon. Oui, la monnaie européenne en est à ce stade-là..."
Tandis que Taylor et ses semblables sont libres d'agir en toute impunité, politiciens et médias nous "expliquent" qu'il faut se serrer la ceinture pour "calmer les marchés".14 mai 2010 : Citation du jour (elle est de Jean-Claude Trichet, serreur de ceintures et patron de la Banque centrale européenne) : "L'euro n'est pas menacé..." En quelques jours, le cours est tombé de 1,30 à 1,23 $ ; il y a encore de la marge vers le bas...
(Soit dit en passant, Trichet-le-bien-nommé fait partie de la communauté sioniste. Il compte bien s'installer à Bercy lorsque la "gouvernance mondiale" aura mis son acolyte DSK à l'Elysée.)15 mai 2010 : Bonne nouvelle en provenance de New York : Lloyd Blankfein, PDG de Goldman Sachs, vient de s'acheter un duplex en bordure du Central Park - prix 26 millions de dollars.
Tout va bien, donc. C'est ce que confirme d'ailleurs George Soros au cours d'un dîner à l'Université Columbia, en présence de Paul Volcker (ancien président de la Fed et conseiller sioniste d'Obama) : "Le système financier international est en train de se désintégrer et il n'y a aucun espoir de voir la crise se résoudre d'ici peu. Les turbulences actuelles sont pire qu'au temps de la Grande Dépression des années 1930 ; la situation est comparable à la chute de l'Union soviétique." Soros le milliardaire sait de quoi il parle : il a profité de toutes les crises des 20 ou 30 dernières années - quand il ne les a pas lui-même provoquées.20 mai 2010 : Un banquier suisse annonce la fin de l'euro - "Je considère que la constitution de l'Europe autour de la monnaie unique est un non-sens politique, économique et culturel. L'histoire à montré que toute monnaie plurinationale est vouée a exploser s'il y a des déséquilibres dans les économies qui la partagent... Le plan de 750 milliards est une fuite en avant. L'Europe est euphorique car elle est droguée à la dette. Cette solution ne fait qu'augmenter la dose de drogue en créant encore plus de dettes. Tout cet argent sera finalement ponctionné auprès des contribuables, ce qui risque d'entraîner une crise sociale importante... Ce sont les Etats-Unis qui ont planifié et souhaité la création de l'euro, avec la complicité de la Communauté européenne, pour 'contaminer' l'Europe avec leur concept de mondialisation et de profit maximum à court terme. Le problème, c'est qu'ils ont créé un endettement abyssal et démantelé leur industrie, rapidement imités en cela par les Etats européens."
Solution pour les pays de la zone euro : "Se protéger par un retour à la souveraineté monétaire et territoriale, visant à la reconstruction d'un tissu industriel, seul gage d'une stabilité économique à long terme."21 mai 2010 : Comme l'a calculé un site Internet allemand (détails) un contribuable qui gagne 30.000 € bruts par an et paie 5.625 € d'impôt sur le revenu, consacre (sans le vouloir et sans le savoir) 66 % de cette somme au "sauvetage de l'euro", 12 % au "sauvetage de la Grèce" et 21 % au paiement des intérêts sur les emprunts souscrits par l'Allemagne. Autrement dit, 99 % de l'impôt sur le revenu prélevé au contribuable va enrichir les banques. Comme le 1 % restant est bien entendu insuffisant pour financer les dépenses courantes, l'Etat allemand doit s'endetter davantage... et payer encore plus d'intérêts. (Bien sûr, l'impôt sur le revenu - IR - n'est pas le seul impôt perçu, mais il représente 38 % des recettes fiscales en Allemagne. Malgré des différences, la situation globale est comparable dans les autres pays. En France, où la part de l'IR est plus faible - 17 % des recettes - et la dette publique proportionnellement plus élevée, le seul paiement des intérêts de la dette engloutit la presque totalité de l'IR.)
L'auteur de l'article conclut : "Jamais, au cours de l'histoire récente, les gouvernements n'ont pillé les contribuables de manière aussi criante. Si rien n'est fait pour renverser la situation, l'effondrement économique et social en Allemagne, en Grèce et dans les autres pays de l'UE est inévitable." Voir également plus haut : La dette publique, source d'enrichissement des banques privées.
La crise économique mondiale : la Grande Dépression du XXIe siècle par Michel Chossudovsky et Andrew Gavin Marshall.9 juin 2010 : En taule, Bernard Madoff se la coule douce et considère qu'il est "enfin libre" - un reportage du New York Magazine. Dans sa prison modèle de Caroline du Nord (où il ne court aucun risque, même lorsqu'il doit ramasser sa savonnette), l'escroc juif qui arnaqua 65 milliards (voir plus haut) est un "héros" que tout le monde admire pour ses "exploits", y compris et surtout les petits truands qui ne comprennent pas la différence entre millions et milliards. Bernie est célèbre mais il ne donne pas d'autographes à n'importe qui ("Ils iraient les revendre sur eBay"). Dans cette jolie colonie de vacances, il côtoie Jonathan Pollard, l'espion juif qui fournit au Mossad, dans les années 1980, la liste des espions américains en URSS - une liste que Tel Aviv s'empressa de faire suivre à Moscou en échange d'une émigration accélérée des Juifs soviétiques vers Israël. Résultat : des arrestations et des exécutions en série, le démantèlement du plus grand réseau de la CIA derrière le rideau de fer. Depuis, malgré les efforts permanents du lobby, les USA refusent de relâcher le traître Pollard. Mais il va bien, lui aussi. Il ne manque de rien. Quand il a besoin d'une nouvelle kippa, il peut s'en acheter une pour 2,60 $. Et il est heureux de pouvoir discuter le bout de gras avec l'ancien titan de Wall Street.
Celui-ci, interrogé par le journaliste Steve Fishman (également juif, of course) n'est pas tendre pour ses victimes. Il les emmerde, dit-il. Il les a supportées pendant 20 ans, et maintenant il a 150 ans à tirer. Madoff se moque de David Kotz (un autre juif, inspecteur général de la SEC, la Commission de contrôle des opérations de bourse), un nullard qui se prend pour Colombo mais qui n'y connaît rien et qui avait la prétention de "contrôler" (après coup) les activités du grand jongleur. Madoff : "Les règles de trading, c'est en grande partie moi qui les ai rédigées..."
Pour tuer le temps, Madoff a offert de s'occuper de la comptabilité de la prison, en rappelant qu'il avait des références, puisqu'il avait présidé la bourse NASDAQ. Le responsable l'a remercié poliment en lui disant qu'il savait parfaitement ce qu'il avait fait à l'extérieur.
Pour le patron Europe de Goldman Sachs, la crise n'est qu’un problème de com
"Invité de Jean-Pierre Elkabbach, le patron Europe de la banque, Yoel Zaoui, s'est livré à un exercice de langue de bois, lisant ses notes de bout en bout de l'entretien, pour finalement réduire la responsabilité des banques dans la crise financière à un vulgaire problème de communication." - un spectacle burlesque 100 % judéo-juif avec des questions-réponses préparées d'avance (lien vidéo).14 juin 2010 :
TU M'ÉTONNES !

(vu sur le site des "Patrons juifs de France")
Tout ce que fait le sioniste DSK à la tête du Foutoir Mafieux Israélophile (FMI)
enthousiasme toujours nos patrons voyous.26 juin 2010 : Dans une interview à la chaîne russe anglophone RT (Russia Today), le journaliste américain Webster Tarpley montre que la réforme financière bidon de Barack Obama se solde par un éblouissant triomphe du lobby des dérivés : Obama's Phony Financial Reform Bill a Stunning Triumph of the Wall Street Derivatives Lobby (lien vidéo).
Cette "réforme" ne contient aucune mesure pour protéger la clientèle bancaire, limiter le coût des crédits, stopper les saisies immobilières, freiner l'effet de levier de la spéculation et limiter les pouvoirs de la Fed. Rien n'est prévu non plus pour mettre fin aux dérivés qui sont à l'origine de la crise. Au contraire, une tentative de les proscrire a été complètement vidée de sa substance. Un "compromis" autorise formellement les dérivés de change, de crédit et de taux d'intérêts. (Voir plus haut ce que sont les CDS, CDO, etc.)
Un autre projet, qui voulait interdire aux banques commerciales [en principe, il n'y a plus de différence juridique entre banques commerciales et banques d'affaires] de spéculer pour leur propre compte, a également été balayé. Les banques grand public peuvent au contraire s'engager dans les hedge funds et - levier aidant - se retrouver en faillite du jour au lendemain.
Tarpley : "Ce n'est pas pour rien que Goldman Sachs a financé Obama... Le président est au service des banquiers de Wall Street... Parallèlement, un projet de loi visant à étendre la durée de versement des allocations chômage a été repoussé. 1,3 million de chômeurs n'auront plus rien à la fin du mois. On a 24.000 milliards de dollars pour les banques sous forme de divers plans de sauvetage, mais il est impossible de trouver 20 milliards pour venir en aide à des chômeurs et à leurs familles qui vont tout perdre... Et parce qu'il manque soi-disant 20 autres milliards, on va licencier 300.000 enseignants... Il faut faire des économies ?... Et les guerres?... Et l'Afghanistan ?..."
Webster Tarpley ne parle que des USA mais la situation n'est pas différente en Europe, même si la politique-spectacle essaie parfois de nous faire croire le contraire. Les rencontres internationales de type G8 ou G20, où les uns veulent soi-disant ceci et les autres soi-disant cela, ne trompent plus personne. Celle de Toronto, ces jours-ci, aura coûté un milliard de dollars US (1.000.000.000 !) et aura eu pour seul effet de mettre en scène la "violence des opposants".*
* The Toronto G20 Riot Fraud : Undercover Police engaged in Purposeful Provocation At Tax Payers' Expense
Les émeutiers du bloc noir étaient des provocateurs de la police - exactement comme en août 2007, à Montebello dans l'Outaouais (Québec), au sommet nord-américain réunissant George Bush et ses deux clones Stephen Harper et Felipe Calderón. La seule différence : en 2007, les casseurs étaient des agents de la Sûreté du Québec (SQ) ; en 2010, des agents de la Police Provinciale de l'Ontario (OPP) et/ou de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC - le FBI canadien).
Deux choses sont sûres en cette fin juin 2010 : 1) il n'y a pas plus de plan de relance économique aux Etats-Unis qu'en Europe (seule la Chine a pris des mesures concrètes pour stimuler sa consommation intérieure) - 2) pour endiguer cette crise qui risque de surpasser celle des années 1930, rien de sérieux ne sera fait. A l'époque, Roosevelt mettait les banquiers au pas et s'appuyait sur la gauche et les syndicats. Aujourd'hui, il n'y a plus ni gauche ni syndicats, et Obama est le fidèle serviteur de banquiers infiniment plus puissants. Pour aggraver le tout, plus aucun pays européen n'est souverain.27 juin 2010 : On apprend que les banques Goldman Sachs, Wachovia et UBS ont massivement vendu leurs actions BP au premier trimestre 2010 - comme si elles avaient été au courant de ce qui allait se passer le 20 avril (explosion de la plateforme pétrolière au large de la Louisiane et marée noire du siècle). Entre-temps, BP a perdu la moitié de sa valeur boursière ; les banquiers sont restés à l'abri. On ne s'étonne plus de rien... (Le PDG de BP, Tony Hayward, a lui aussi vendu ses actions en février-mars).
1er juillet 2010 : Gordon Long, ancien dirigeant d'IBM et de Motorola, spécialiste dans le domaine des dérivés et des private equity funds, pense que le danger qui émane de la marée noire du siècle n'est pas seulement d'ordre environnemental mais également d'ordre financier. Comme le pétrole continue de se déverser depuis le 20 avril sans qu'il soit possible de dire quand la fuite sera colmatée, BP doit s'attendre à des coûts sans précédent au niveau du nettoyage et des dédommagements. Et en cas d'insolvabilité de BP, d'autres risques gigantesques guettent les banques et l'économie. Une quantité astronomique de dérivés basés sur les activités et les dettes de l'entreprise se trouve en effet en circulation, sans que personne ne sache au juste de quelle somme il s'agit.
BP a externalisé la majeure partie de ses opérations spéculatives dans des "entités spéciales" (Special Purpose Entities) dont on ignore tout mais qui se comptent par milliers. Seules les plus grandes banques pourraient avoir une idée (plus ou moins précise) de la nature de cette bombe à retardement composée de CDS, de CDO et même de CSO (Collateralized Synthetic Obligations - ce sont des intruments titrisés qui, contrairement aux CDO, ne reposent pas sur des emprunts obligataires mais sur des dérivés de crédit - CDS - eux-mêmes basés sur ces emprunts). Et pour corser le tout, il existe même des CSO adossés à d'autres CSO. Le jour où BP tombera en faillite, tout cela produira une déflagration infiniment plus violente que celles qui ont emporté Bear Stearns (le 17 mars 2008) et Lehman Brothers (le 15 septembre 2008).2 juillet 2010 : Dernière citation de Strauss-Kahn : "La crise est une opportunité pour pousser à la création d'une monnaie mondiale et d'une banque centrale unique." Le Sage du FMI a dû trouver son inspiration dans ses Protocoles préférés (son livre de chevet)... DSK veut d'ailleurs depuis longtemps "transformer le FMI en une véritable ONU de l'économie mondiale" et lui accorder "une vaste autorité élargie pour agir comme banquier mondial des gouvernements riches et pauvres".
25 juillet 2010 : Le Comité européen des superviseurs bancaires, qui ne supervise pas grand-chose, vient de faire passer des tests de résistance (stress tests) aux principales banques européennes. Sur 91 établissements, 84 réussissent les tests (soit 92 %). Même les banques grecques, sauf une, terminent en beauté. Pas étonnant, puisque les "superviseurs" n'ont pas tenu compte (entre autre) du risque réel de dépréciation des obligations d'Etat détenues par les banques.
En théorie, il ne devrait pas être nécessaire d'effectuer de "tests" pour déterminer si une banque dispose de suffisamment de fonds propres. C'est une obligation comptable qui coule de source et qui devrait s'imposer quotidiennement à l'ère du tout informatisé. Il est vrai que les ordinateurs et les logiciels, aussi performants soient-ils, ne peuvent pas évaluer ce qui a été intentionnellement "oublié" ou manipulé en connaissance de cause.
La transparence des "stress tests" ne démontre pas leur fiabilité - De petits "stress tests" avant un grand crash
Aux Etats-Unis, 103 (petites) banques ont déjà fait faillite cette année (140 en tout en 2009, 25 en 2008, 3 en 2007). Depuis le début de la crise, le FDIC (fonds de garantie des dépôts) a dû effectivement débourser 71 milliards de dollars.
A propos de la loi (dite loi Dodd-Frank) sur la prétendue "réforme" financière présentée par Obama, l'économiste Laurence Kotlikoff, professeur à l'Université de Boston, déclare : "Avec cette loi, on reste sur sa faim. C'est comme si on était invité à dîner et qu'on se voyait servir des photos représentant des plats gastronomiques." Dans le Telegraph, Liam Halligan écrit : "Obama n'a jamais envisagé l'éventualité de rétablir la loi Glass-Steagall [loi promulgée sous Roosevelt pour protéger les banques de dépôts de la spéculation et de la cupidité des banques d'affaires]. Au contraire, il a mis dans son administration tous les gens qui avaient aidé Clinton à abroger cette loi... La loi Glass-Steagall, dans toute son efficacité, tenait sur seulement 17 pages. La loi Dodd-Frank, poussive et pleine de lacunes, en a 2.319. Quand on a dit ça, on a tout dit..."
Exemple à suivre : La Hongrie rembarre le FMI ! Au lieu d'obéir à Strauss-Kahn, le gouvernement hongrois veut taxer les banques, interdire les prêts immobiliers en devises (qui ruinent les emprunteurs hongrois mais enrichissent les banquiers), empêcher les évictions et les saisies de logements, et s'en prendre au "capitalisme spéculatif, nuisible et dégradant". La finance internationale pousse des cris et voit déjà le communisme rétabli à Budapest. Attention à la reprise en mains (depuis quelque temps, les Israéliens s'intéressent de très près à la Hongrie).16 août 2010 : Spéculation - le retour des affameurs. A la faveur de la canicule russe, "le volume des paris financiers sur les matières premières alimentaires a été multiplié par cinq en deux mois, atteignant des niveaux supérieurs à ceux de 2008. Le blé, l'orge, le maïs, le cacao, etc., voient leurs cours exploser. On s'attend à une forte hausse du prix du pain et de la viande dès l’automne, de l'ordre de 8 à 12 %. La spéculation sur l'alimentaire est aujourd’hui 50 fois supérieure aux volumes produits et échangés réellement, puisqu'il n’est pas besoin d'acheter et vendre des produits pour jouer avec les instruments d'assurance financiers que sont censés être les produits dérivés."
1er septembre 2010 : Le monde souterrain de la finance, de la politique et de la corruption - une vidéo de plus d'une heure présentée par "Le Libre Penseur". Malgré sa forme apparemment "dilettante", elle contient une mine d'informations concrètes et de nombreuses remarques très pertinentes. Demande un certain effort de concentration mais permet de mieux comprendre qui détient le pouvoir en France (et ailleurs).
3 septembre 2010 : Un été financier pourri par Olivier Chazoule (avocat international spécialisé dans la finance). Plus de trois ans après le début de la crise des subprimes, ces crédits immobiliers bas de gamme, une seconde vague de faillites personnelles commence à balayer les Etats-Unis, touchant cette fois des emprunteurs plus aisés, voire riches, mais néanmoins en difficultés après la perte de leur emploi ou de leur commerce : "Aujourd'hui, un prêt immobilier résidentiel sur sept n'est plus remboursé... 40,5 millions d'Américains sur 311 millions, soit 13 % de la population, vivent de food stamps." [Ce sont des bons alimentaires distribués aux personnes à faible revenu.] Le taux de chômage officiel est inférieur à 10 %, mais le taux effectif atteint 18 %.
Pour ce qui est des marchés financiers, une nouvelle forme de spéculation éclair a fait son apparition : après les ATS, le HFT et le Flash Trade (voir plus haut), voici le quote stuffing ou manipulation de la cotation. Utilisé bien entendu par les grandes banques et les hedge funds, il consiste à placer électroniquement des ordres d'achat ou de vente en quantités énormes à un cours déterminé, puis à les retirer aussitôt, en l'espace d'une fraction de seconde, et à recommencer ensuite à un cours différent, le tout au rythme de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de cotations par seconde. C'est un procédé en principe interdit, car nul ne peut afficher une cotation sans qu'il y ait eu de transaction véritable. Il est néanmoins utilisé et provoque de très importantes fluctuations de cours pendant une même séance, permettant ainsi des profits démesurés.
 Ainsi, par exemple, le 6 mai 2010, à 14 h 42, le Dow Jones commence subitement à chuter. A 14 h 47, il a perdu près de 1.000 points, soit 9,2 %. A 15 h 07, il a récupéré 600 points. Les auteurs de la manipulation - et eux seuls - savent ce qui se passe sur le marché et en tirent le profit maximum. Les autres opérateurs n'y comprennent rien, et pour cause. Leurs ordinateurs détectent une baisse et vendent à leur tour, dans le but - croient-ils - de limiter les pertes, ce qui bien sûr accentue la baisse au point de la transformer en dégringolade. Dès que le cours a atteint un niveau minimum, les opérateurs rachètent automatiquement, faisant ainsi remonter le cours. Mais comme les non-initiés mettent un certain temps à interpréter la situation, le cours remonte plus lentement qu'il n'a baissé. Comme toujours, la plupart des petits ou moyens investisseurs sont à la traîne, se contentant de suivre le mouvement. Bien souvent, ils font les frais de l'opération. Et pendant que les banksters comptent leur butin, les "experts", eux, se creusent les méninges pour trouver une "explication" au phénomène - voir la page
Flash Crash
de Wikipédia. Les journalistes, eux, invoquent la conjoncture, la faiblesse des indicateurs économiques, les déclarations ambiguës du chef de la Fed ou les dernières menaces d'Al-Qaïda... D'autres fluctuations subites ont eu lieu après le 6 mai, quoique moins spectaculaires ; on semble entre-temps opérer plus discrètement, mais rien n'est sûr.
Ainsi, par exemple, le 6 mai 2010, à 14 h 42, le Dow Jones commence subitement à chuter. A 14 h 47, il a perdu près de 1.000 points, soit 9,2 %. A 15 h 07, il a récupéré 600 points. Les auteurs de la manipulation - et eux seuls - savent ce qui se passe sur le marché et en tirent le profit maximum. Les autres opérateurs n'y comprennent rien, et pour cause. Leurs ordinateurs détectent une baisse et vendent à leur tour, dans le but - croient-ils - de limiter les pertes, ce qui bien sûr accentue la baisse au point de la transformer en dégringolade. Dès que le cours a atteint un niveau minimum, les opérateurs rachètent automatiquement, faisant ainsi remonter le cours. Mais comme les non-initiés mettent un certain temps à interpréter la situation, le cours remonte plus lentement qu'il n'a baissé. Comme toujours, la plupart des petits ou moyens investisseurs sont à la traîne, se contentant de suivre le mouvement. Bien souvent, ils font les frais de l'opération. Et pendant que les banksters comptent leur butin, les "experts", eux, se creusent les méninges pour trouver une "explication" au phénomène - voir la page
Flash Crash
de Wikipédia. Les journalistes, eux, invoquent la conjoncture, la faiblesse des indicateurs économiques, les déclarations ambiguës du chef de la Fed ou les dernières menaces d'Al-Qaïda... D'autres fluctuations subites ont eu lieu après le 6 mai, quoique moins spectaculaires ; on semble entre-temps opérer plus discrètement, mais rien n'est sûr.
Analysis of the May 6 'Flash Crash' - Quote Stuffing, A Manipulative Device. Cette analyse du "market-data provider" Nanex a montré que pendant la période en question, on a enregistré des cas extrêmes de 5.000 cotations différentes en une seconde pour une seule transaction portant sur le même titre. Les cas de l'ordre de 1.000 cotations à la seconde se comptent par centaines. Il existe une compétition acharnée entre les divers systèmes HFT, et seul le manipulateur - ou plutôt son ordinateur - sait à quel moment il faut intervenir pour empocher le gain maximum ; ses concurrents tâtonnent dans l'obscurité. Selon Nanex, quelques microsecondes (millionièmes de seconde) peuvent faire toute la différence. Les ordinateurs adverses doivent en effet réagir à toutes les cotations qu'ils trouvent, ce qui leur fait perdre un temps précieux, tandis que le système du manipulateur est en mesure de distinguer le vrai du faux. Mais comme tous les systèmes HFT ont tendance à agir de la même façon, on court le risque d'une congestion totale du marché.
Voir également page 2 - 23 mars 2012 - ou comment les géants de Wall Street ont mis à genoux un concurrent (BATS Global Markets de Kansas City).12 septembre 2010 : En Suisse, beaucoup de bruit pour rien. Le Comité de Bâle de la Banque des Règlements Internationaux, "montagne" créée par les principales banques centrales, accouche d'une souris qui répond au nom de Bâle III. Ce n'est pas cela qui stoppera la crise.
26 septembre 2010 : Rachida Barbie, ancienne Garde des Sots de Maître Sarkouille, nous explique à sa façon les excès de la finance (lien vidéo). C'est le lap-suce du jour - on notera que l'intervieweuse blonde ne pipe pas.
30 septembre 2010 : Après trois tentatives de renflouage en trois ans, la banque irlandaise Anglo Irish Bank est en liquidation. Le gouvernement de Dublin l'avait nationalisée début 2009, c'est-à-dire qu'il avait nationalisé les pertes. Ces pertes s'élèvent maintenant à plus de 50 milliards d'euros, soit 30 % du PIB - beaucoup pour une seule banque. La spéculation internationale traite à présent l'Irlande un peu de la même façon que la Grèce quelques mois plus tôt, mais le taux d'intérêt des emprunts publics irlandais ("seulement" 7 %) n'a pas encore atteint le niveau grec. Curieusement, le cours de l'euro remonte depuis quelque temps (1,37 $ ces jours-ci).
5 octobre 2010 : Jérôme Kerviel, l'ancien trader-spéculateur de la Société Générale (voir plus haut), est condamné en première instance à cinq ans de prison, dont deux avec sursis. Il doit en outre rembourser à son ex-employeur la somme de 4.915.610.154 € - ce qui lui prendra au moins 178.000 ans, si l'on en croit les "experts". Pour le tribunal (11ème chambre correctionnelle de Paris, présidée par Dominique Pauthe) Kerviel a agi seul, à l'insu de ses supérieurs hiérarchiques ; la direction de la banque est blanchie. Un jugement surréaliste, vide de bon sens, mais pas très étonnant de la part du juge Pauthe, qui se prend pour le superman du Palais de Justice (il s'occupe également de l'affaire Clearstream-Sarkozy-Villepin et du procès Chirac). Pour donner l'impression qu'il comprend quelque chose à la finance, Pauthe s'est acheté un dictionnaire des termes financiers, ce qui lui a permis de les utiliser à tort et à travers pendant le procès.
Non seulement les grands banksters de la Société Générale - qui ont encouragé et couvert leur employé - sont à l'abri de toute poursuite, mais le juge complice ou inconscient leur a concédé en totalité une perte dont ils avaient déjà déduit un tiers (1,6 milliard) de leur charge fiscale 2008.3 novembre 2010 : Le lendemain des élections américaines de mi-mandat*, Ben Shalom Bernanke annonce que la Fed va racheter à Wall Street pour 600 milliards de dollars d'obligations d'Etat, transformant ainsi une dette à long terme en argent comptant (ce n'est pas la première fois). Bien entendu, les banquiers vont s'empresser d'investir cette somme dans la prochaine bulle spéculative. Et pendant ce temps, gouvernement et opposition, gauche et droite, ne cessent de répéter qu'il faut faire des coupes et se serrer la ceinture.
* Résultats : défaite pour Obama et les Démocrates, victoire pour les Républicains, les anarchistes de droite (Tea Parties) et les entreprises de vote électronique, situation inchangée pour les laquais d'Israël et de Goldman Sachs (98,5 % des sièges).

Pendant que Barack Obama et Joe Biden se félicitent des résultats électoraux,
Ben Shalom Bernanke active la planche à billets -
600.000.000.000 $, ça ne s'imprime pas tout seul...
C'est ce que les banksters appellent quantitative easing (allègement quantitatif)
alors qu'il s'agit en fait d'un alourdissement de la masse monétaire et de la dette.
Voir également plus haut : Interventions de la Fed12 novembre 2010 : L'UE et les hedge funds - "La nouvelle directive est une passoire qui aura un effet inverse à celui qui est annoncé. Son objectif réel est de contrôler sommairement les fonds européens, tout en ouvrant la porte aux fonds états-uniens qui, eux, pourront spéculer sans limite au détriment des Européens."
16 novembre 2010 : C'est maintenant l'Irlande qui est au centre des spéculations. Bruxelles et Francfort s'apprêtent à "aider" Dublin, comme ils avaient "aidé" Athènes. Les créanciers de l'Irlande (toujours les mêmes banksters) se frottent les mains et préparent déja leur prochain coup.

Acculé toi-même !4 décembre 2010 : La Fed américaine vient de publier des documents renseignant sur les aides financières apportées aux banques entre 2008 et 2010 dans le cadre des divers programmes de renflouage. Cette retombée de la loi Dodd-Frank de juillet 2010 sur la prétendue "réforme" du système financier (voir plus haut), était réclamée depuis longtemps. Malheureusement, les données publiées sont très difficiles à interpréter. Le tableau suivant donne cependant une petite idée de la question. Il ne reprend que les programmes TAF (Term Auction Facility), PDCF (Primary Dealer Credit Facility) et TSLF (Term Securities Lending Facility). Il s'agit d'avances renouvelables à court terme consenties aux banques en difficulté.
Le plus grand récipiendaire de ces aides de la Fed a été Citigroup*, qui en a bénéficié 370 fois pour un total cumulé de 2,4 billions de dollars. Derrière ce chiffre astronomique se cache une réalité que l'on pourrait, dans le meilleur des cas, interpréter ainsi : Citigroup a, pour simplifier, emprunté 6,5 milliards pour deux jours et, après remboursement, a réemprunté cette même somme pour deux autres jours, et ainsi de suite pendant deux ans. C'est beaucoup moins dramatique que ça en a l'air. A condition, bien sûr, que Citigroup ait vraiment remboursé (les doutes sont permis) et à condition aussi que les titres remis en garantie des avances ne soient pas sans valeur (là aussi, on peut en douter). On sait que la Fed a aidé les banquiers à échanger leurs actifs toxiques contre de l'argent frais. Ce que l'on ignore, c'est l'ampleur exacte de cet échange. La banque centrale américaine ne dit rien à ce sujet.
En deux ans, le total du bilan de la Fed n'a pas beaucoup augmenté (2.385 milliards de dollars contre 2.214). La dette publique américaine cumulée, elle, s'est alourdie de 35 % (= 3.700 milliards - voir plus haut). Il y a certainement eu un discret petit "jeu d'écritures" d'une "caisse" à l'autre.
* Après Citigroup, on trouve Merrill Lynch, Morgan Stanley, Bear Stearns (entre-temps disparu), Bank of America, Goldman Sachs et plusieurs grandes banques européennes de New York.8 décembre 2010 - Deux sujets dominent l'actualité :
■ La crise de l'euro - Revendiquer la fin de la monnaie unique ou du moins prédire son effondrement prochain n'est plus un tabou. Bien entendu, la manière dont l'euro a été mis en place, il y douze ans, défie le bon sens. En bonne logique, l'union monétaire aurait dû être l'expression de l'union économique, l'aboutissement de celle-ci. Or, l'union économique n'existait pas au départ, et elle n'existe toujours pas aujourd'hui. Les différences structurelles entre les divers Etats membres n'ont pas disparu. Ce qui a disparu, c'est la possibilité pour chaque pays d'ajuster souverainement ses déséquilibres en dévaluant ou en réévaluant sa monnaie nationale par rapport aux autres monnaies. Les monnaies nationales ayant été supprimées, c'est la monnaie unique qui en pâtit. Alors que presque partout ailleurs dans le monde, on trouve un Etat et un taux de base derrière chaque monnaie, l'Euroland ne connaît rien de tel. Le taux auquel chaque Etat peut emprunter varie d'un endroit à l'autre sans que la monnaie locale (la même partout) puisse en tenir compte. L'euro grec et l'euro irlandais sont "plus chers" que l'euro allemand en matière de taux d'intérêts*, mais ils conservent toujours la même valeur l'un par rapport à l'autre en matière de taux de change. Un tel système ne peut pas durer et finira sans doute par imploser, les divers Etats retrouvant leur indépendance monétaire.
* 3 % pour l'Allemagne, 3,3 % pour la France, plus de 8 % pour l'Irlande, plus de 11 % pour la Grèce.
Mais la véritable raison de la crise de l'euro n'est pas là. Elle a sa source dans la spéculation et dans le pouvoir illimité de la grande finance. Tant que les banksters n'auront pas été neutralisés, tant que les Etats ne se seront pas libérés du joug de l'endettement public auprès du secteur privé (voir plus haut), rien ne changera - avec ou sans euro. Retrouver sa souveraineté monétaire, c'est bien, mais c'est insuffisant tant qu'on ne se libère pas de la dictature de la mafia financière. La reprise économique en Islande, pays hors UE et hors euro ayant laissé les banques faire faillite (sans spolier les épargnants), pourrait servir d'exemple à tous les pays européens victimes de Bruxelles, de Francfort et des créanciers-vampires. Sans être parfaite, loin de là, la voie islandaise nous montre ce qu'un pays ayant conservé quelques bribes de souveraineté nationale peut faire pour se protéger dans le cadre du système existant.
■ L'opération "Ruée vers les banques" d'Eric Cantona - L'ancienne vedette du ballon rond avait appelé le public à retirer son argent afin de donner une leçon aux banquiers spéculateurs. Indépendamment de l'aspect folklorique du mot d'ordre, de la difficulté de le mettre en œuvre (tout l'argent n'est pas disponible du jour au lendemain), de l'impossibilté de se passer des banques (comment payer ses factures ?) et du danger couru par tous les épargnants en cas de "succès" de l'opération (retraits massifs et crash généralisé), l'appel de Cantona a eu le mérite de mettre le doigt sur le problème - mais sans apporter de solution. (Cantona, pour sa part, a retiré 1.500 €... dont il avait besoin pour ses achats de Noël.)
On a recommandé au footballeur de s'occuper de ses affaires et de ne pas se mêler de ce qu'il ne comprenait pas. C'est pourtant exactement ce que font la plupart des politiques et des journalistes : moins ils maîtrisent un sujet, et plus ils en parlent. L'ignorance est devenue un gage d'expertise. Ce que des "spécialistes" comme Christine Lagarde, ministre des Finances du gang Sarkozy, reprochent avant tout à Cantona, ce n'est pas de donner son avis dans un domaine qui n'est pas le sien, mais de le faire à contre-courant de la pensée dominante. Tant qu'on répète les âneries entendues à la télévision, on est libre de dire n'importe quoi - mais gare quand on commence à exprimer des idées personnelles.

Echec aux banksters ?...10 décembre 2010 : Irving Picard, administrateur judiciaire chargé de liquider la société de Bernard Madoff, c'est-à-dire de récupérer quelques miettes, demande 19,6 milliards de dollars de dommages-intérêts à Sonja Kohn, actionnaire majoritaire de la Banque Medici de Vienne. Incroyable : ce gros zantisémite américain ose attaquer la pauvre banquière juive rescapée de l'Holocauste® (elle est née en 1948), sous prétexte qu'elle servait de rabatteuse au financier de Wall Street et recevait en échange une partie du butin. Décidément, le monde est tombé bien bas ; le recrudomètre est vraiment dans le rouge.
9 février 2011 : Le plus gros détenteur de la dette américaine n'est plus la Chine, c'est... la Fed (un article de La Tribune). Trois mois après l'annonce faite par Bernanke que la Fed allait racheter aux banques pour 600 milliards de dollars d'obligations d'Etat (voir plus haut), c'est fait pour moitié.
De novembre 2010 à février 2011, la valeur totale des bons du Trésor US aux mains de la Fed est passé de 773 milliards de dollars à 1.077 milliards, dépassant ainsi la quantité détenue par les Chinois. Le total du bilan de la banque centrale américaine a augmenté au cours de la même période de 200 milliards "seulement" (2.540 contre 2.340). 100 milliards ont donc été remboursés par ailleurs - miracle...
Malgré l'aspect inquiétant de l'opération Bernanke, on peut se demander si le rachat par la Fed de bons du Trésor de son propre gouvernement n'est pas finalement plus "moral" que le rachat par la BCE d'obligations de l'Etat grec, irlandais ou portugais. En Europe, la composante nationale a complètement disparu.
La Chine, quand on le lui permet, préfère racheter des entreprises américaines en difficulté plutôt que de transformer ses excédents commerciaux en bons du Trésor. On a pu voir récemment à la télévision un reportage sur un sous-traitant de Ford, près de Détroit, qui appartient depuis peu aux Chinois. Les ouvriers sont reconnaissants qu'on les ait sauvés du chômage. Ils s'accommodent très bien de leur patron chinois et font même, comme en Chine, quelques minutes de gymnastique tous les matins avant de commencer le travail.15 février 2011 : L'UE, la BCE et le FMI préparent le pillage du patrimoine grec par François Asselineau.
8 avril 2011 : Après la Grèce et l'Irlande, c'est au tour du Portugal de perdre le peu de souveraineté dont il disposait encore. Les autorités de Bruxelles et de Francfort obligent Lisbonne à "demander" l'aide européenne pour "rembourser" sa dette. Comme dans les cas précédents, ce n'est pas le débiteur qui reçoit cette prétendue "aide", mais ses créanciers (c'est-à-dire avant tout les banques étrangères). En contrepartie, le Portugal se voit imposer des coupes drastiques dans le domaine social.
Tant que les gens ne se révoltent pas pour contraindre leurs gouvernements à quitter l'UE et la zone euro, ce petit jeu peut se poursuivre en toute impunité. Prochain victime probable : l'Espagne.9 avril 2011 : Nouveau référendum islandais sur le "remboursement de la dette". La réponse du 6 mars 2010 (93 % de "non") avait pourtant été claire. Mais selon un principe fondamental de la démocrasserie occidentale, quand le peuple refuse quelque chose, on revient à la charge jusqu'à ce qu'il ait "changé d'avis". Par contre, quand il accepte, la réponse est définitive et irréversible. Comme le résultat de la deuxième consultation, bien que "moins mauvais" qu'il y a un an, est encore "insuffisant" (59 % de "non"), les mondialistes ont le choix entre passer outre ou recommencer en 2012. Une troisième solution, à la libyenne, consisterait à déclencher un "soulèvement spontané" dans une partie du pays et à organiser ensuite une expédition punitive "humanitaire" de l'OTAN.
13 avril 2011 : Le total du bilan de la Fed est passé à 2.670 milliards de dollars (+ 325 milliards en un an, + 900 milliards en deux ans et demi, + 1.800 milliards en trois ans et demi). Malgré toutes les astuces comptables, la politique suivie depuis fin 2007 ne reste pas sans effet.
19 avril 2011 : La Hongrie adopte une nouvelle constitution que nos médias clonés qualifient de "controversée", bien que le Parlement de Budapest l'ait approuvée avec plus des deux tiers des voix. (La "controverse" vient en fait de Washington, New York. Tel Aviv, Bruxelles, Francfort, Londres, Paris, etc. Elle est tellement bien orchestrée que même le "patron" de l'ONU, Ban Riquiqui-Moon, y va de sa "mise en garde".)
Entre autres mesures renforçant la souveraineté, la loi fondamentale hongroise prescrit maintenant le forint comme monnaie nationale. Un passage à l'euro n'est donc pas possible sur un simple coup de tête de quelques banksters étrangers, comme cela avait été le cas jusqu'ici dans beaucoup d'autres pays européens. On ne peut que féliciter les Hongrois - même si certaines autres dispositions constitutionnelles ne sont pas aussi heureuses. (Le 25 juillet 2010, le gouvernement de Budapest avait déjà manifesté son indépendance vis-à-vis de la mafia financière internationale.)
Autre sujet d'inquiétude pour les pillards apatrides de la planète : les élections législatives en Finlande. Un parti relativement nouveau, les Vrais Finlandais, recueille 19 % des suffrages sur la base de son programme économique. Il réclame la sortie de l'euro et de l'UE et refuse l'austérité sous prétexte de sauvetage des pays rongés par la dette.
Si les autres peuples d'Europe suivaient les modèles finlandais, hongrois et islandais, bien des choses pourraient changer. Mais on en est encore très loin.7 mai 2011 : Après les 110 milliards d'euros offerts un an plus tôt aux banquiers étrangers créanciers de la Grèce (voir plus haut - 28.04.10 et jours suivants, les autorités européennes annoncent une rallonge de 25 milliards. Pour mieux faire passer la pilule, on répand le bruit que les Grecs sont sur le point de sortir de l'euro.
Quelles seraient les conséquences pratiques d'une telle sortie ?... Dans le cas de la Grèce, et si ce pays était le seul de la zone à rétablir son indépendance monétaire, il est probable que l'effet extérieur serait des plus réduits. Mais les épargnants grecs y perdraient ; leurs euros seraient automatiquement convertis en drachmes qui se déprécieraient assez vite. En cas d'annonce officielle préalable, on assisterait à une véritable ruée sur les banques (rien de comparable avec la plaisanterie d'Eric Cantona), ce qui entraînerait inévitablement des faillites en série ou une fermeture générale imposée à brève échéance, comme en Argentine il y a dix ans.
En cas d'abandon général de la monnaie unique, seuls des pays comme l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas (et dans une moindre mesure la France et quelques autres) se tireraient bien d'affaire (en termes de cours des changes) puisque chacun retrouverait en gros la situation d'avant l'euro. Bien entendu, l'endettement accumulé au cours des dernières années continuerait de peser sur les populations de ces pays (en termes de fiscalité et de régression sociale). Les effets catastrophiques de l'euro ne disparaîtraient pas comme par enchantement, mais leur aggravation future s'en trouverait stoppée.
L'euro n'est pas la seule cause de nos malheurs. En laissant subsister tout le reste (pillage systématique des économies par la mafia financière, spéculation effrenée, mondialisation à outrance), on garantit la pérennité du mal.11 mai 2011 : En l'espace de quatre jours, les nouveaux "besoins" de la Grèce (c'est-à-dire de la finance internationale) sont passés de 25 milliards d'euros à 60 milliards. Et demain ?... 100, 200, 500 milliards ?... Plus on leur en donne, plus ils en demandent. L'endettement public du pays représenterait à présent 150 % du PIB, contre 125 % un an plus tôt. Mais on peut évidemment douter de la fiabilité de ces chiffres, d'autant plus que le PIB réel s'effondre au fur et à mesure que croît l'endettement réel.
Pas un jour ne s'écoule sans nouvelle mesure antisociale, hausse d'impôts ou de tarifs, baisse de salaires, etc... Chômage de masse et précarité s'installent à demeure. Et pendant ce temps, les syndicats grecs poursuivent leur campagne de démoralisation à coup de grèves bidon.
Au point où l'on en est, une "restructuration" de la dette, c'est-à-dire une annulation partielle semble inévitable. Et si elle a lieu, elle ne se fera certainement pas au détriment des banques. Celles-ci recevront de leurs Etats respectifs ou de l'UE une "compensation adéquate". Autrement dit, les contribuables des autres pays européens devront faire un "effort supplémentaire" - l'objectif final étant d'instaurer partout le "système grec".
Le Marchand de Venise à Athènes :

Dominique Shylock-Kahn (patron du FMI) s'apprête à prélever
la livre de chair que "lui doit" son débiteur grec insolvable.
"Un contrat, c'est un contrat..."
Quand il n'exige pas de nouveaux sacrifices de ses victimes grecques,
DSK fait l'inventaire de son patrimoine immobilier*
ou s'en prend au personnel féminin des hôtels de New York** - détails.
* Superbe appartement historique de 240 m² place des Vosges,
penthouse de luxe avec toit-terrasse dans le 16ème, en bordure du bois de Boulogne,
imposante maison dans le quartier chic de Georgetown à Washington (avec six salles de bain),
résidence princière à Marrakech (où la famille Strauss-Kahn a ses racines judéo-berbères).
Valeur totale : 20 millions d'euros, et il ne s'agit que des biens connus
(on ne serait pas étonné d'apprendre que notre Shylock possède aussi une villa à Jérusalem).
Sans oublier tout le reste : comptes, investissements, voitures de luxe, train de vie pharaonique,
costumes sur mesure à 35.000 $ pièce, coupes de cheveux à 500 $, etc. etc...
** Habitué à tout ce luxe, il est évident que le "socialiste" DSK exige que les femmes de chambre soient jour et nuit
à son entière disposition. Qu'elles refusent de le satisfaire, et il n'hésite pas à les prendre de force.
Quand on viole des pays entiers, on a le droit de violer des femmes. Et pourtant, une de ces zantisémites
est allée se plaindre à la police qui a osé arrêter le patron du FMI - incroyable, cette recrudescence,
si ça continue comme ça, ils vont nous repasser le film Jud Süß...
Les mésaventures du sioniste DSK
19 mai 2011 : Conséquence du scandale qu'il a lui-même causé, Strauss-Kahn doit quitter le FMI. Mais la continuité est assurée : c'est son adjoint John Lipsky, ancien banquier de JPMorgan, qui prend (provisoirement) la succession. Rien ne change, évidemment, sinon qu'un Juif séfarade né à Neuilly et originaire du Maroc est remplacé par un Juif ashkénaze né dans l'Iowa et originaire de Pologne. Les femmes de chambre des grands hôtels sont - peut-être - moins menacées, mais certainement pas les Etats victimes des prédateurs mondialistes.
Début juillet 2011, Christine Lagarde devient directrice générale du FMI. Malgré son manque de judaïté*, elle surmonte bien son handicap. Le site Israel Valley écrit : "La question va très vite se poser à Jérusalem : Christine Lagarde est-elle pro-israélienne ? Va t-elle 'sentir' les sensibilités du pays ? En fait, la réponse est limpide : OUI..." La nouvelle patronne du FMI a commencé très tôt, puisque dès l'âge de 19 ans, juste après le bac, elle suit des cours aux Etats-Unis et "effectue un stage au Capitole en tant qu'assistante parlementaire du représentant républicain du Maine, William S. Cohen, qui deviendra ensuite secrétaire à la Défense de Bill Clinton" (Wikipédia). Après ses études de droit, Lagarde travaille pendant 25 ans pour le cabinet d'avocats Baker & McKenzie, un cabinet assez "qualifié" pour figurer en bonne place dans le Jewish Guide de New York. Elle est également membre du think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) où Henry Kissinger côtoie Zbigniew Brzezinski - la synthèse des "forces vives", juives et non-juives, de la mondialisation... Avant même de prendre ses nouvelles fonctions, Christine Lagarde lance un avertissement à la Grèce ; les banksters de Wall Street et leurs représentants dans l'administration Obama applaudissent, à commencer par le sioniste Tim Geithner, ministre des Finances et ancien patron de la Fed de New York.
* Certains Juifs la revendiquent cependant comme une des leurs - voir ici

Ça change agréablement du prédateur précédent
Intérêts notionnels et paradis fiscal - une histoire belge peu connue
Tandis que la caste politique européenne et la presse alignée dénoncent depuis des années la nuisance des paradis fiscaux extérieurs (voir plus haut 16.10.2008), le véritable paradis pour les grandes entreprises, européennes ou non, est au cœur même de l'UE, en Belgique. Fin avril, la chaîne RTBF a diffusé un reportage critique à ce sujet. Depuis 2005, une réforme fiscale belge assure aux multinationales une quasi-exonération de l'impôt sur les sociétés (en théorie 33,99 %). Il suffit pour cela qu'elles aient une filiale financière dans le pays, laquelle "supporte" la "totalité" des charges fiscales. En vertu des accords contre la double imposition conclus avec la plupart des Etats, une entreprise taxée en Belgique ne peut plus l'être ailleurs. Le seul problème, c'est que cette taxation belge est pour ainsi dire nulle. Ainsi par exemple, ArcelorMittal Belgique, avec un bénéfice de près de 1,3 milliard d'euros, n'a payé que 496 € d'impôt en 2009 - et 0 € à l'étranger pour les activités fiscalement "relocalisées" en Belgique (détails - voir également ici).
Le principe à la base de ce mirifique cadeau : le fisc considère que les fonds propres apportés de l'étranger à la société établie en Belgique sont du "capital-risque" (ce qui n'est évidemment pas le cas) et que cela justifie le "paiement", à la maison-mère, d'intérêts à un taux comparable à celui d'un emprunt. Comme le paiement n'a pas vraiment lieu, les intérêts sont dits "notionnels", c'est-à-dire fictifs. (Si l'on employait le mot fictifs, tout le monde comprendrait, ce qu'il faut bien sûr éviter.) Ces intérêts bidon sont fiscalement déductibles par la filiale belge, comme s'ils avaient été réellement déboursés par elle. La maison-mère, de son côté, ne déclare pas les dits "intérêts" puisqu'elle n'a rien touché en réalité. Dans l'exemple ci-dessus : ArcelorMittal aurait dû payer 438 millions d'euros d'impôts (33,99 % de 1.288.806.525). A déduire : intérêts notionnels de 4,473 % (taux fixé par arrêté royal) sur un peu moins de 10 milliards de capitaux. Reste dû : 496 €. Taux d’imposition effectif : 0,000038% (environ un millionième du taux officiel).
Un des arguments invoqués pour faire passer la réforme fiscale a été celui de la prétendue "création d'emplois". En fait, la société financière belge d'ArcelorMittal emploie, en tout et pour tout, 34 personnes - et encore, on ne sait pas dans quelles conditions. D'ailleurs, ces places existaient peut-être déjà avant la réforme. Mais même si ce n'était pas le cas, on peut dire que la création présumée de 34 emplois est subventionnée par l'Etat à hauteur de 438 millions annuels, soit une subvention de 13 millions d'euros par emploi et par an. 13 millions gaspillés pour permettre à un patron milliardaire de verser mille fois moins à une secrétaire à mi-temps ?...
Bien que de nombreux autres pays fassent eux aussi les frais de cette "générosité" belge, aucune voix officielle ne s'est élevée contre cet aspect particulièrement pervers du "libéralisme" (= capitalisme de rapine).
30 mai 2011 : Derrière la crise grecque, l'explosion de l'euro ? par Jacques Sapir.
"La Grèce sera probablement le premier des maillons de la chaîne de l'euro à sauter. Les taux sur les bons du Trésor à 10 ans ont atteint 16,81 %. De plus, les taux d'intérêt sur les bons du Trésor à deux ans sont montés à 26,1 %, un chiffre astronomique qui ne fait sens que parce que les opérateurs du marché s'attendent à ce que la Grèce fasse défaut dans un délai de moins de deux ans, en dépit du plan de privatisation. Ceci entraînera très probablement une nouvelle crise au Portugal et en Irlande..."
"Il est clair que la situation n'est plus tenable, ni pour la Grèce, qui ne peut s'infliger une austérité aussi drastique [que l'exigent l'UE et le FMI], ni pour l'Europe qui ne peut mettre la Grèce sous perfusion sans courir le risque de voir d'autres pays demander le même traitement. Un défaut sur la dette est donc inévitable et ne signifie pas la fin du monde. Cependant, il entraînera la sortie de la Grèce de la zone euro afin de pouvoir dévaluer et retrouver sa compétitivité, car un défaut sans une dévaluation n'a pas de sens. Compte tenu de la structure du commerce extérieur de la Grèce (dont seulement 35 % se fait avec la zone euro) et des sources de revenus de l'économie de ce pays (le tourisme, les exportations vers les pays arabes et les revenus de la flotte de commerce), une forte dévaluation apparaît comme la moins mauvaise des solutions..."
"Si la sortie de l'euro posera certainement des problèmes, le choc social sera cependant bien moins important que dans l'austérité continue que la Grèce devrait s'imposer pour plusieurs années si elle voulait à tout prix rester dans l'euro. Dans ces conditions, le plus vite une telle décision sera prise, le mieux cela vaudra pour la population et l'économie."
10 juin 2011 : François Asselineau sur la Chine, le protectionnisme, l'euro, l'UE, etc. (lien audio - 1 h 16 mn)
Bien qu'économiste sérieux et de haut niveau (énarque, inspecteur des Finances, ancien directeur de cabinet de plusieurs ministres), Asselineau est systématiquement boycotté par les médias officiels. Motif : ce gaulliste souverainiste est partisan de la sortie de l'euro. Sa page Wikipédia, qu'il était impossible de "corriger" comme c'est habituellement le cas quand le contenu déplaît, a été purement et simplement supprimée - détails.
28 juin 2011 : Christine Lagarde est nommée directrice générale du FMI à compter du 5 juillet - voir détails ci-dessus 19 mai 2011. Est-ce une bonne nouvelle pour l'euro ? Certains médias allemands, comme le Spiegel, annoncent la mort subite mais attendue de la monnaie unique et prononcent déjà son oraison funèbre. On enterre la Grèce, mais c'est l'euro qui est dans le cercueil.
12 juillet 2011 : Attaque massive des spéculateurs contre l'euro, qui repasse en dessous de 1,40 $. La Grèce est toujours ciblée, de même que le Portugal et l'Irlande. Nouvelle victime depuis peu : l'Italie, que l'on veut obliger à effectuer immédiatement pour plus de 40 milliards d'euros de coupes (pour commencer). Il devient de plus en plus évident qu'il ne s'agit pas ici de "réduire la dette" comme on le prétend. On utilise tout simplement ce prétexte pour démanteler les systèmes sociaux - le plus vite possible et le plus profondément possible. Les dépenses militaires et le financement des guerres (Libye, Afghanistan, etc.) ne sont pas mis en cause, pas plus que les gigantesques cadeaux aux prédateurs financiers.
Les Etats-Unis servent d'exemple à l'Europe entière. Si le gouvernement Obama n'accepte pas d'urgence les coupes drastiques voulues par Wall Street, le Congrès a la possibilité de provoquer la faillite de l'Union, ou du moins de la mettre en cessation de paiements. La chose existe déjà partiellement au niveau des communes et des Etats. Le Minnesota, par exemple, a cessé certaines de ses activités publiques faute d'argent. Ailleurs, en attendant de congédier des fonctionnaires, on commence par réduire de moitié, voire complètement, les pensions versées aux retraités - pensions pour lesquelles ils avaient pourtant cotisé toute leur vie. On voit ainsi des gens de 70 ans et plus reprendre du service, quand ils ont la chance de trouver un job sous-payé où on leur permet de concurrencer de jeunes diplômés de 30 ans qui se sont lourdement endettés pour financer leurs études, mais n'ont encore jamais pu décrocher de véritable emploi. La pauvreté et la misère s'étendent partout, amplifiées par la crise financière et par la crise de l'immobilier. La désertification urbaine s'accentue, créant d'innombrables "villes fantômes" (dans la région de Détroit, par exemple). Les USA sont la matérialisation de ce qui attend l'Europe dans pas très longtemps. Tout cela a un nom : mondialisation.
21 juillet 2011 : Énième "sauvetage" de la Grèce - un sujet ardu...

Au lieu de vous résigner...
... écoutez plutôt les explications d'un expert :
Autre lien
28 juillet 2011 : Depuis quelque temps, la spéculation fait de nouveau grimper les prix alimentaires, causant même la famine dans les pays de la Corne de l'Afrique. Dans cet entretien Jean Ziegler déclare : "La première raison de la catastrophe est l'absence de stocks de réserve. La sécheresse dure depuis cinq ans. Depuis, les récoltes sont déficitaires. Dans n'importe quel pays, il existe des réserves alimentaires. Les Etats se préparent en cas de catastrophe. En Somalie, Erythrée, Kenya, Ethiopie, Djibouti, les greniers sont vides. Ils le sont parce que les prix alimentaires (aliments de base, c'est-à-dire riz, maïs, céréales qui couvrent 75 % de la consommation mondiale) ont explosé en raison de la spéculation des hedge funds et grandes banques. Les spéculateurs financiers ont perdu des milliers et des milliers de milliards de dollars [remboursés par le contribuable] lors de la crise financière de 2008 et de 2009. Ils ont quitté les bourses des valeurs et ont migré vers les bourses des matières premières agricoles. Légalement, avec les instruments spéculatifs ordinaires, ils réalisent des profits astronomiques sur les aliments de base. Actuellement, la tonne de blé meunier est à 270 euros. Il y a an, elle était de moitié. La tonne de riz a plus que doublé en un an et le maïs a augmenté de 63 %. Les pays pauvres ne peuvent donc même plus acheter les aliments à même de constituer des réserves. Ils sont impuissants lorsque la catastrophe arrive..."
Les banques spéculent aussi sur les récoltes par Jean-Pierre Alliot.
"Depuis quelques années, la spéculation sur les produits agricoles a atteint des proportions qui provoquent la panique dans les sommets des Etats les plus puissants de la planète. Pour favoriser le commerce international, les institutions de la finance et de l'assurance ont créé des instruments financiers, les dérivés de matières premières. A l'origine ce n'étaient que des instruments de couverture contre le risque. Ils sont devenus progressivement des instruments de placement financier, qui s'achètent et se vendent. Les volumes de transactions qu'ils provoquent ont pris une importance qui dépasse sans doute bien des prévisions. Et le plus grave, c'est qu'ils sont de plus en plus souvent déconnectés des échanges réels de matières premières. A la bourse de Chicago, il s'échange chaque année sur les marchés dérivés l'équivalent de quarante-six fois la production annuelle mondiale de blé..."
Sur les dérivés, voir également plus haut.
Comment Goldman Sachs a provoqué la crise alimentaire par Frederick Kaufman.

1er août 2011 : Comme prévu dans le scénario écrit par les banksters, Obama et le Congrès "finissent par se mettre d'accord" sur un relèvement du plafond d'endettement public de 14,3 à 16,4 billions de dollars, assorti d'une réduction des dépenses sociales de 2,1 billions sur les dix prochaines années.
Au cours des longs "débats" parlementaires qui ont accompagné ces mesures, la seule proposition intelligente est venue du représentant républicain indépendant Ron Paul, conservateur "à l'ancienne", plusieurs fois candidat aux primaires présidentielles mais sans aucune chance de succès. Ron Paul, qui préside à la Chambre la Commission de la politique monétaire, a demandé l'annulation pure et simple de la dette fédérale matérialisée par les bons du Trésor acquis par la Fed au cours des derniers mois - voir 9 février 2011. Entre-temps, ce ne sont plus 773 milliards de dollars (comme en novembre 2010) ni 1.077 milliards (comme en février 2011) mais 1.635 milliards que détient la Fed (+ 112 % en neuf mois). Si l'on écoutait Ron Paul, ce qui ne risque pas d'arriver, la dette publique totale en serait allégée de plus de 11 %. (Le total du bilan de la Fed est maintenant de 2.867 milliards, contre 870 milliards quatre ans plus tôt).
Interview de Ron Paul du 22 juillet 2011 (lien vidéo).
3 août 2011 : Interview de l'analyste financier Max Keiser sur la chaîne russe anglophone RT - Russia Today (lien vidéo).
Résumé : Les bons du Trésor US vont être rétrogradés. Ils perdront leur note AAA. Et c'est exactement ce que veulent les banquiers de Wall Street, comme Lloyd Blankfein [PDG - juif - de Goldman Sachs] ou Jamie Dimon [PDG de JPMorgan Chase et directeur de la Fed de New York - d'origine "grecque", comme la mère de Sarkozy]. Car plus la note est mauvaise, et plus les marges sont élevées. L'idéal pour les banksters serait que la dette publique américaine ait le niveau de junk bonds (obligations pourries). Les marges astronomiques et l'extrême volatilité de ce marché leur rapporteraient infiniment plus. [Ce qui en dit long sur le "patriotisme" de ces financiers "américains".]
Notation financière - AAA est la meilleure note, CCC la plus mauvaise (exception faite de D = en défaut).
5 août 2011 : L'agence de notation Standard & Poor's abaisse d'un cran la note des USA (AA+ au lieu de AAA). L'agence chinoise Dagong l'avait d'ailleurs précédée de deux jours, faisant passer la note des Etats-Unis de A+ à A. La Chine, premier créancier étranger des Américains (1.160 milliards de dollars de bons du Trésor), s'offre le luxe de faire la leçon aux Yankees (habituellement c'est le contraire) : "Les jours où l'oncle Sam, perclus de dettes, pouvait facilement dilapider des quantités infinies d'emprunts de l'étranger semblent comptés..." Pékin conseille fortement à Washington de réduire à la fois ses dépenses militaires (ce qui est raisonnable) et ses dépenses sociales (autrement dit, les Américains pauvres devraient, à l'avenir, se contenter d'un niveau de vie comparable à celui des pauvres de la Chine "communiste", tandis que les milliardaires américains, tout comme les milliardaires chinois, conserveraient leurs privilèges).
Les dirigeants politiques français, eux, sont fiers du AAA que la France détient encore. Ils n'ont pas compris que le tour de leur pays viendra dès qu'on aura réglé son compte à l'Italie, l'actuel "point faible" de la zone euro.
10 août 2011 : Les attaques contre le standing financier de la France arrivent plus rapidement que prévu. Pour permettre aux agences de notation d'abaisser la note de l'Hexagone, les spéculateurs s'en prennent aux valeurs françaises, en particulier au titre de la Société Générale, qu'ils vendent massivement à découvert, provoquant une chute du cours de plus de 20 % en quelques heures. Parallèlement, on lance la rumeur que la banque se trouverait au bord de la faillite.
Le lendemain, la France, la Belgique, l'Espagne et l'Italie interdisent les ventes à découvert, c'est-à-dire les ventes de titres qu'on ne possède pas, à un cours plus élevé que celui auquel on les achètera plus tard, afin d'empocher la différence (c'est l'illustration classique de l'effet de levier - voir plus haut). Comme en 2008, cette mesure est limitée dans le temps (15 jours) et surtout, elle n'empêche pas les spéculateurs qui "parient" contre la France pour s'enrichir, de passer par d'autres bourses où la chose est permise, ou d'utiliser d'autres instruments financiers (dérivés). C'est de la poudre au yeux...
Les agences de notation ont des liens plus ou moins discrets avec les géants de Wall Street, qui comptent bien sûr parmi leurs gros actionnaires. Standard & Poor's, qui a rétrogradé les USA quelques jours plus tôt, a pour PDG un homme d'origine indienne, ce qui suggère une certaine "indépendance" à l'égard du milieu financier habituel. Mais, Dieu merci, plusieurs de ses adjoints sont des "élus". Et surtout, le directeur de la notation pays, dont Reuters dit : "Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, mais tous les ministres des Finances du monde ont eu affaire à lui ", est un certain David Beers (David comme dans Etoile de David, et Beers comme dans De Beers, la plus grande entreprise diamantaire du monde, propriété de Nicholas Oppenheimer, le plus grand milliardaire juif sud-africain). Donc, aucune crainte à avoir à ce sujet : si la rating agency qui emploie Beers prend une décision capitale pour les marchés, c'est que les gens qui dominent ces marchés ont donné le feu vert. Et chez Goldman Sachs, on ne fait rien au hasard...
12 août 2011 : Grèce, Irlande et Portugal : pourquoi les accords conclus avec la Troïka sont odieux par Eric Toussaint (politologue) et Renaud Vivien (juriste). Inutile d'ajouter que le prochain candidat est la France... (La Troïka comprend la Commission européenne, la BCE et le FMI.)
"Ces accords, qui génèrent de nouvelles dettes et imposent aux peuples des mesures d'austérité sans précédent, peuvent être remis en cause sur la base du droit international..." Encore faudrait-il que les dirigeants des pays touchés ne soient pas des serviteurs de la Troïka... Une vue "légaliste" du problème qui ne tient pas compte du fait que c'est tout simplement la loi de la jungle qui régit ces questions.
15 août 2011 : Le château de cartes s’effondre : la prochaine fin de l’euro par François Asselineau.
Pour "résoudre" le problème de la dette dans la zone euro, on n'a rien trouvé de mieux que d'obliger les pays les plus solvables à "aider" les plus endettés, c'est-à-dire à s'endetter eux-mêmes davantage : une politique absurde et désastreuse qui ne peut déboucher que sur une insolvabilité générale. "Sarkozy et son gouvernement n'ont pas d’autre objectif que de vouloir, coûte que coûte, la survie de l'euro, sans même savoir pourquoi d’ailleurs..." Asselineau estime que l’Allemagne - dernier maillon de la chaîne - va "siffler la fin de partie très rapidement. La fin de l'euro n'est sans doute plus une question d'années mais de mois, sinon de semaines..." L'avenir le dira.
En attendant, on coupe partout dans les budgets, créant ainsi volontairement la récession, voire pire. On coupe et on coupe sans arrêt, et on s'étonne que l'habit économique soit toujours trop court...
16 août 2011 : Comme pour contredire la prédiction faite la veille par François Asselineau, la chancelière allemande annonce, conjointement avec Sarkozy, des mesures en faveur de l'euro, dont la prochaine mise en place d'un "gouvernement économique européen" qui pourrait sonner le glas de l'indépendance (relative) des Etats membres en matière d'économie et de finance. Tous les pays de la zone euro, y compris les plus puissants, devraient donc se plier à l'avenir à une autorité supranationale qui leur dicterait la politique à suivre, avec des conséquences sans doute pires que celles qui frappent déjà la Grèce et le Portugal. C'est bien sûr une étape vers cette gouvernance mondiale que les banquiers veulent nous imposer dans tous les domaines. La crise actuelle sert également cet objectif.
Max Keiser : Les banques françaises sont insolvables (lien vidéo). Dans cette interview, l'analyste financier dissèque sans concession le comportement des spéculateurs qui s'en prennent à présent à la France. Ce que nous avons là est une guerre, financière sans doute, mais c'est une guerre. Et les armes utilisées sont des armes financières de destruction massive. Les banques françaises [mais cela vaut également pour beaucoup d'autres] ont des bilans en apparence sains. En réalité, elles regorgent de dérivés toxiques qui leur ont été vendus par les banques d'investissement américaines et qui ne figurent pas dans leurs bilans. Ces mêmes banques américaines, associées aux hedge funds et aux agences de notation, utilisent maintenant les dits actifs toxiques comme une arme contre les banques françaises (Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole).
Les banksters ne profitent pas seulement de la volatilité des marchés, ils l'ont eux-mêmes créée en dégradant la note des pays attaqués. La volatilité était le but à atteindre. Le Financial Times rapporte que le volume des dérivés est en train d'exploser, il n'a jamais été aussi élevé que ces jours-ci. Et les banquiers de la City et de Wall Street s'enrichissent comme jamais - grâce à la volatilité créée par leurs dérivés spéculatifs.
Tandis que l'inflation réelle (produits alimentaires, énergie) est évacuée des statistiques, les taux bancaires créditeurs restent proches de zéro, ce qui enrichit les banquiers et appauvrit les épargnants. En Suisse et aux Etats-Unis, et bientôt partout ailleurs, on commence à imposer des intérêts négatifs aux épargnants. De la sorte, on les incite à investir dans des produits spéculatifs spécialement créés pour enrichir les terroristes et les pillards financiers.
Les pillards qu'on a vus à l'œuvre dans les rues de Londres ne font qu'imiter, à leur façon, les pillards de Goldman Sachs, dit Max Keiser. La banque de Wall Street devrait les recruter pour travailler chez elle...
Ce que l'on entend ici - sur la chaîne russe RT - est à la fois direct et décapant, et surtout lucide. Rien à voir avec les fadaises et la langue de bois des télés occidentales qui vous racontent que le dernier discours de Sarkozy a rassuré les marchés.

20 août 2011 : Que font les pillards de Wall Street quand ils ne pillent pas ?... Ils font la fête : Billionaire throws party on Long Island par David Walsh, sur le site trotskiste wsws.org.
Tandis que plus de 300 millions d'Américains sont priés de se serrer la ceinture, le milliardaire [juif] Leon Black, patron du private equity fund Apollo Global Management, engagé dans les opérations financières les plus parasitaires qui soient, vient de fêter son 60ème anniversaire dans sa propriété de Southampton (sur Long Island, près de New York). Parmi les invités de marque, on notait : Michael Milken, ancien patron [juif] de Leon Black, condamné à 10 ans de prison (et relâché au bout de 22 mois) dans une affaire d'escroquerie aux junk bonds ou obligations pourries ; Lloyd Blankfein, PDG [juif] de la banque Goldman Sachs ; Stephen Schwarzman, milliardaire [juif] et patron du Blackstone Group (private equity fund) ; Michael Bloomberg, milliardaire [juif] et maire de New York ; le sénateur démocrate [juif] de New York Charles Schumer ; le célèbre roi des médias Howard Stern [également juif] ; etc...
Les voisins de Leon Black sont le couturier [juif] Calvin Klein [de son vrai nom Richer Klein - ça ne s'invente pas] et le milliardaire [juif] David Koch [qui finance le mouvement des Tea Parties]. L'article ne dit pas s'ils étaient présents.
Elton John [malheureusement pas juif, mais on a au moins deux bonnes raisons de lui pardonner : 1) il admire et soutient Israël - 2) il est pédéraste, "marié" à un autre pédéraste et "père" d'un petit garçon "adopté" - c'est ce qu'on appelle le libre accès à la chair fraîche...] Sir Elton, donc [alias Sœur Eltonne] a donné en l'honneur de Leon Black un concert privé de 90 minutes pour la modique somme d'un million de dollars.
Après la fête dans les Hamptons...

on retourne travailler à Wall Street.
30 août 2011 : La crise des ânes ou comment raconter la crise à ceux qui ne connaissent rien aux lois du marché, par Âne-onyme.
Le début (cinq premiers paragraphes) rappelle une vieille histoire juive qu'on se racontait autrefois dans le shtetl à la veillée, en riant de la lourdeur des paysans russes. Ce n'étaient pas toujours des ânes que l'on achetait et revendait, les prix étaient différents, et on payait en roubles. La suite de l'histoire n'aurait pas été possible de cette façon-là ; on a fait des progrès depuis. A l'époque, il y avait parfois un retour de bâton, mais on préférait ne pas en parler. Personne n'aimait parler des pogromes.
Encore une histoire d'âne : Le coup de pied de l’âne des Américains. Pour punir Hugo Chávez d'avoir rapatrié les réserves d'or qui se trouvaient à Londres et New York, Standard & Poor's rétrograde la note du Venezuela. Mais le Venezuela s'en fout, vu qu'il n'a nul besoin d'emprunter aux banksters.
15 septembre 2011 : L'UBS annonce qu'un de ses traders de Londres a effectué pour 10 milliards de dollars d'opérations non autorisées, générant une perte potentielle de 2,3 milliards de dollars. Le record de Kerviel (50 milliards d'euros de positions spéculatives pour 5 milliards de pertes, soit respectivement 70 et 7 milliards de dollars) est loin d'être battu, mais il pourrait l'être prochainement si les banques continuent de négliger les contrôles.
20 septembre 2011 : Standard & Poor's abaisse la note de l'Italie de A+ à A (tableau). La guerre spéculative contre la monnaie européenne et ses maillons les plus faibles continue de plus belle. Un défaut de paiement de la Grèce et sa sortie de l'euro deviennent de plus en plus probables.

L'agonie de l'euro par Jacques Sapir.
Bien entendu, la mafia financière internationale s'oppose à l'idée d'un défaut ou d'une "restructuration" de la dette, car elle veut que les contribuables supportent la totalité des pertes qu'elle a causées et qu'elle cause encore chaque jour ; il n'est pas question pour elle de renoncer à une partie de ses créances. La crise dont elle est responsable lui sert de prétexte pour réclamer ouvertement l'instauration d'une gouvernance globale, d'abord au niveau européen puis au niveau mondial. (Il n'y a pas si longtemps, seuls les "conspirationnistes" et autres "lecteurs de Protocoles" osaient aborder ce sujet.)
26 septembre 2011 : Tandis que la fin approche, on nous repasse en boucle le spectacle de l'euro en danger, avec toujours les mêmes grandes constantes orwelliennes :
► Il faut à la fois réduire la dette publique de façon drastique (sur le dos des citoyens) et s'endetter de façon non moins drastique en versant des sommes toujours plus grandes dans le tonneau des Danaïdes du fonds de soutien.
► Les centaines et les centaines de milliards offerts aux banksters ont pour but de sauver la Grèce, l'euro, l'Europe.
► L'Etat doit continuer de s'endetter au prix fort auprès des banques afin d'être en mesure de leur prêter (directement ou indirectement) tout cet argent à un taux proche de zéro (ou de leur en faire tout simplement cadeau).
► Pour pallier au manque de souveraineté nationale en Europe, il faut supprimer les derniers restes de souveraineté en confiant tout pouvoir de décision à des instances internationales.
► Le fait que les politiciens (de tous bords), les gouvernements et les parlements font exactement le contraire de ce que veulent les peuples, est la preuve que nous vivons en démocratie.
27 septembre 2011 : De temps à autre, un homme politique semble se réveiller, comme par exemple le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. En réponse à son homologue américain Tim Geithner (délégué des banksters de Wall Street et du lobby innommable) qui demandait que les moyens mis à la disposition du Fonds européen de stabilité financière (FESF) passent de 440 milliards à 2.000 milliards d'euros, Schäuble déclare que l'idée est stupide et que Washington ferait mieux de balayer devant sa porte avant de donner de pareils conseils aux autres... Ce qui n'empêchera pas l'Allemagne d'obtempérer à brève échéance : tout cela fait partie du spectacle.
28 septembre 2011 : La Commission européenne prépare la mise en place d'une taxe sur les transactions financières, dont le taux serait paraît-il de 0,1 % pour les actions et les obligations et de 0,01 % pour les "produits" financiers. Elle rapporterait une cinquantaine de milliards d'euros par an, ce qui est peu en comparaison des 440 ou 2.000 milliards discutés la veille. L'avantage pour les banksters, outre l'effet "poudre aux yeux" : la taxe serait entièrement supportée par la clientèle, et elle pénaliserait dix fois moins les dérivés et autres créations à haut risque que les valeurs mobilières traditionnelles.
C'est à l'économiste américain James Tobin (Prix Nobel, décédé en 2002) que l'on "doit" l'idée de cette taxe. Afin d'en propager la réalisation, on a spécialement fondé, en 1998, l'association internationale ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne). Les gens qui pensent que l'invention de nouvelles taxes est une expression de la volonté citoyenne, croient aussi qu'ATTAC est une organisation "de gauche".
29 septembre 2011 : Deux jours après le faux duel Schäuble-Geithner, le montant total alloué au fonds de "sauvetage" est déjà de 780 milliards, dont 27,1 % à la charge de l'Allemagne et 20,4 % à la charge de la France. Des pourcentages qu'il faudra revoir à la hausse en cas de défaillance d'un pays membre. Si la Grèce est en défaut, tous les autres Etats encore solvables devront prendre à leur compte sa quote-part de 2,8 %. Si le Portugal, l'Irlande, l'Espagne ou l'Italie suivent, ce sera la même chose avec leurs 2,5 %, 1,6 %, 11,9 % et 17,9 %. Que cela arrive, et le fardeau des "meilleurs" s'alourdira d'autant, c'est-à-dire de plus de la moitié. Ce qui aura pour conséquence de couler d'autres pays, dont la France. Et à la fin, l'Allemagne devra supporter presque seule la totalité des charges, ce qui la coulera également.
Il existera au moins quatre manières différentes pour le FESF de canaliser ces centaines de milliards de la poche des contribuables vers celle des banksters : 1) en accordant aux pays endettés une aide "directe" qui servira en fait à rembourser leurs créanciers (les banquiers) afin de permettre à ces derniers d'accorder à ces mêmes pays de nouveaux crédits (crédits directs ou souscription d'emprunts obligataires) - 2) en rachetant aux banksters, et sans perte pour eux, des obligations sans valeur émises par les Etats au bord de la faillite - 3) en recapitalisant les banques (c'est-à-dire en leur faisant cadeau des "fonds propres" qu'elles auraient dû elles-mêmes accumuler pour faire face à la dépréciation de leurs actifs pourris) - 4) en collaborant avec le FMI (c'est-à-dire en appliquant, sans contrôle, les mesures décidées à Washington).
Dans l'esprit de la mafia financière internationale, le FMI est l'embryon du gouvernement économique mondial, et le FESF sa section européenne. Comme il n'y a plus grand-chose à soutirer des pays pauvres de l'UE et de la zone euro, on oblige les pays plus riches à payer automatiquement pour tous. C'est la solution la plus efficace et la plus rapide pour imposer partout un nivellement par le bas. Une France ou une Allemagne souveraines n'accepteraient jamais de s'aligner sur les standards "sociaux" slovaques, bulgares ou lituaniens. Avec la gouvernance globale, c'est possible et réalisable en quelques années. A part quelques révoltes spontanées et facilement manipulables, personne ne troublera la mise en œuvre de cet agenda. Les vingt dernières années ont montré qu'une véritable opposition organisée n'existe plus, pas même en Grèce. Dans ce pays, les dirigeants syndicaux font tout pour étouffer les protestations sérieuses. Alors que seul un mai 68 aurait des chances de faire reculer les banksters et leurs complices, on préfère s'en tenir à la grègrève mensuelle sans conséquences.
30 septembre 2011 : Avant même que le FESF ne soit une réalité (certains pays membres ne l'ont pas encore ratifié), on discute déjà des moyens d'augmenter les sommes en jeu, "sans injecter d'argent frais, en utilisant un effet de levier". Les détails ne sont pas connus, mais il pourrait s'agir de permettre au fonds de se porter caution auprès d'autres institutions (BCE, FMI) afin de permettre à celles-ci d'accorder des crédits aux "nécessiteux". Le FESF ne fonctionnerait donc plus comme une simple caisse, dans laquelle on ne peut prélever que ce qui s'y trouve, mais un peu à la manière d'une banque.* Alors que l'octroi d'un prêt de 100 milliards par le FESF à un Etat n'est en principe possible que si ce montant est immédiatement refinancé en totalité, la fourniture d'une caution ou garantie de 100 milliards n'implique aucun décaissement de la part du fonds (du moins pas dans l'immédiat) et ne nécessite de ce fait qu'une contrepartie réduite, de seulement 10 % par exemple. De la sorte, avec 780 milliards disponibles, le FESF pourrait théoriquement émettre pour 7.800 milliards de cautions, qui se solderaient, ailleurs, par un décaissement effectif de 7.800 milliards. Mais il est évident que si le débiteur ne rembourse pas, c'est le FESF qui devra le faire, en totalité et non pour seulement 10 %. Nous retrouvons là l'argument mensonger, omniprésent depuis trois ou quatre ans, qui consiste a dire que "tout cela est purement virtuel" et que "ça ne coûte rien au contribuable".
* Même si l'effet de levier ne joue pas encore à fond et de manière officielle, il est déjà effectif, quoiqu'à un niveau très bas. Pour simplifier, disons que nous avons d'un côté, au passif du FESF (ressources), pour 780 milliards de fonds propres (contributions des Etats membres, effectives ou promises - correspond à P3 dans le bilan schématique ci-dessus) plus 18 milliards d'obligations émises sur les marchés financiers (P1) ; ce qui permet en face, à l'actif (emplois), des engagements de crédit (réels ou potentiels) de 798 milliards (A2). D'ores et dèjà, le taux de couverture (théorique) n'est donc plus de 100 % mais seulement de 97,7 %. On dira que la différence n'est pas bien grande, mais ce n'est évidemment qu'un début, qui montre que le FESF tend déjà à se comporter comme le ferait une banque. Si les emprunts obligataires (P1) n'étaient pas si difficiles à placer, leur total serait beaucoup plus élevé, et le ratio fonds propres / risques de crédit du FESF (P3/A2) ne tarderait pas à fondre comme neige au soleil.
1er octobre 2011 : Europe Must Fight Back Against US-UK Speculative Attacks par Webster Tarpley.
Pour l'auteur, la crise actuelle n'a pas sa source dans les fondamentaux économiques des pays européens. Elle est la conséquence d'une attaque systématique, d'une guerre écononomique totale, cyniquement planifiée et exécutée par Wall Street et la City de Londres, qui s'efforcent de déplacer l'épicentre du séisme de leur territoire vers celui de l'Europe continentale, en utilisant pour cela leurs dérivés générateurs de dépression, leurs CDS, leurs agences de notation corrompues et toute leur panoplie de sales coups financiers.
Tarpley, qui n'est pas contre l'euro, prône au contraire une défense commune des Etats européens s'émancipant de la tutelle anglo-américaine pour éviter le suicide collectif - belle utopie... Son programme - réponse à la question Que faire ? posée plus haut - est aussi raisonnable qu'irréalisable dans le cadre existant :
Non à l'austérité, non au sauvetage des spéculateurs, non aux euro-obligations, non à la recapitalisation des banques, non aux "réformes" à la six-pack, non à l'effet de levier du FESF, non à l'ingérence du FMI, oui à la liquidation des banques zombies [à condition de protéger l'épargne], oui à la taxe "Tobin" de 1 % [à condition de ne pas la reporter sur l'utilisateur], oui à l'annulation de la dette des dérivés, oui à l'interdiction des CDS et CDO, oui à la fermeture des agences de notation, oui à un moratoire pour les pays en difficulté, oui à la transformation de la BCE en arme pour la relance et contre la spéculation, oui à l'investissement d'un billion (mille milliards) d'euros de fonds publics pour la modernisation de l'infrastructure, oui à la création de 40 millions d'emplois productifs, oui à la cessation de toutes les guerres et interventions coloniales en Afghanistan, en Libye, au Kosovo et ailleurs.
SAUVETAGE :

5 octobre 2011 : Après avoir souvent fait parler d'elle au cours des dernières années (faillite évitée de justesse grâce à une aide publique de 6,4 milliards d'euros en septembre-octobre 2008, financement des colonies juives de Palestine occupée, escroquerie des emprunts structurés), la banque franco-belge Dexia est de nouveau en difficulté. Cette fois, elle a besoin d'une perfusion de 100 milliards d'euros (rien que ça) pour se remettre d'une grave intoxication due à la consommation excessive d'emprunts grecs et autres actifs avariés.
6 octobre 2011 : Calling for an EU Federal Budget - le programme à court terme du mondialo-sioniste Jacques Attali exposé sur le site du club élitaire CFR (interview du 11 août 2011) : un budget fédéral européen, une stricte coordination des budgets nationaux, la mutualisation des dettes publiques à l'aide d'euro-obligations.
Petit aveu : "Quand nous avons créé le marché commun [en 1957], nous savions qu'il ne pouvait fonctionner sans harmonisation des normes techniques ; c'est pourquoi nous avons créé le marche unique. Quand nous avons créé le marche unique, en 1984, nous savions qu'il ne pouvait fonctionner sans monnaie unique ; c'est pourquoi nous avons créé la monnaie unique. Et quand nous avons créé la monnaie unique [en 1999], nous savions que cette monnaie unique ne pourrait survivre sans budget fédéral."
Suite logique : quand nous aurons le budget fédéral, il ne pourra fonctionner que si toutes les mesures économiques, fiscales, "sociales" sont prises depuis un centre unique... Quand nous aurons le gouvernement économique unique, il ne pourra fonctionner que si toutes les décisions politiques, diplomatiques, militaires, culturelles sont prises depuis un centre unique... Quand nous aurons le gouvernement mondial unique, il ne pourra fonctionner que si personne ne le remet en question, ni à l'intérieur du monde globalisé, ni à l'extérieur dans les rares îlots de résistance... Et quand le monde entier sera sous notre coupe...
Pour comprendre l'idéologie de cet économiste "français" (les guillemets sont de rigueur puisque Jacob Attali considère que "la France est un hôtel"), il faut écouter ce qu'il dit ici : lien vidéo. Pour lui, ce sont les Juifs qui ont inventé Dieu et la Banque (c'est pour cela d'ailleurs que le reste du monde, par dépit, a opté pour l'ingratitude et l'antisémitisme). Mais un jour, heureusement, "Jérusalem deviendra la capitale de la planète unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial..."
10 octobre 2011 : Depuis quelque temps, un mouvement de protestation s'est établi à New York et dans d'autres villes américaines. Spontané au départ, il a très vite été repris par les habituels manipulateurs, comme le milliardaire juif "de gauche" George Soros, par exemple. Soros finance tous les mouvements "alternatifs" : des "révolutions" colorées en Europe de l'Est à la révolu-sion arabe en passant par ATTAC, les Partis Pirates et les Indignés, y compris les plus indignés et les plus vaillants d'entre eux, ceux du boulevard Rothschild de Tel Aviv.
Si le mouvement "Occupy Wall Street" attire aussi des protestataires authentiques, que le maire juif Bloomberg fait régulièrement matraquer et arrêter, le gros des participants est tout à fait conformiste et obéit docilement aux animateurs délégués par le monde du spectacle, comme l'inénarrable Michael Moore - ce que l'on voit sur cette vidéo dépasse l'entendement.*
L'indignation new-yorkaise et la dénonciation des excès de Wall Street deviennent de jour en jour plus grotesques. C'est ainsi que l'actrice Roseanne Barr veut obliger les banquiers à restituer ce qu'ils ont volé... mais en leur permettant de conserver un minimum vital de 100 millions de dollars (ne fais surtout pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même). Tous les banksters qui refuseraient de se plier à cette sévère contrainte seraient envoyés en camp de rééducation ; les plus récalcitrants seraient guillotinés... On ne sait pas comment Goldman Sachs a réagi à cette revendication hautement antisémite de l'actrice, mais comme elle est juive elle aussi, on a dû se contenter de hausser les épaules sans faire intervenir l'AIPAC et la Homeland Security.
* Si vous pensez qu'on a atteint le fond avec Michael Moore, détrompez-vous ; Ivan Marovic est encore pire. Il s'agit d'une de ces marionnettes serbes que les services américains (CIA, NED) ont utilisées à Belgrade en 2000 pour faire tomber Slobodan Milosevic. Plus tard, le mouvement "révolutionnaire" OTPOR a été recyclé dans d'autres pays, notamment en Egypte début 2011. Comme on peut le voir maintenant, il est toujours actif. Cette fois, la CIA l'envoie "combattre les banquiers de Wall Street" - et des centaines de perroquets répètent en chœur ses slogans débiles. On ne sait trop s'il faut en rire ou en pleurer...
12 octobre 2011 : La dictature européenne prend place (vidéo en allemand, sous-titres français) - une excellente analyse du traité établissant le soi-disant Mécanisme européen de stabilité (MES), appelé à succéder au FESF et définissant les principes de gouvernance de la zone euro :
Le MES est doté d'un capital initial de 700 milliards d'euros, payable par les signataires irrévocablement et sans condition, sur simple demande et dans un délai de sept jours. Le Conseil des gouverneurs du MES peut, seul et quand bon lui semble, décider d'augmenter le capital au-delà de 700 milliards, sans limitation de montant, pour paiement dans les mêmes conditions que le capital initial. Le MES peut intenter des procédures judiciaires contre les Etats mais il est, lui, inattaquable. Il jouit de la pleine immunité, qui vaut également pour son personnel et ses dirigeants, lesquels n'ont de compte à rendre à personne. Les biens du MES sont à l'abri de toute saisie, réquisition ou expropriation de la part des gouvernements, administrations et tribunaux. Les actes et documents du MES sont confidentiels.
27 octobre 2011 : Moins d'un mois après avoir été fixée à 780 milliards d'euros "maximum" (voir plus haut 29 septembre 2011), la "puissance de feu" du FESF passe à 1.000 milliards "dans un premier temps".
Simultanément, les créanciers de la Grèce renoncent à 50 % de leurs créances, ce qui, comme nous l'apprend la presse, "correspond à 100 milliards d'euros sur un total d'endettement public du pays de 350 milliards". Pas besoin de savoir compter pour être expert... La somme "effacée" (100 ou 175 ou 250 milliards) le sera bien sûr sur le dos des contribuables, car : ou bien les obligations grecques ont été rachetées au prix fort par la BCE et ne valent plus que la moitié ; ou bien elles sont dans le portefeuille des banques et ont donné lieu à la constitution de provisions pour dépréciation (ce qui diminue la charge fiscale des dites banques). Sans compter que les Etats vont probablement "aider" ces mêmes banques à "se" recapitaliser.
Pire encore, les pertes résultant de ce "haircut" de 50 % ne sont pas comprises dans les 1.000 milliards alloués au FESF, mais viennent s'y ajouter. Et comme chacun sait que ce billion d'euros ne suffira pas, on reparle de l'effet de levier évoqué le 30 septembre. Mais cette fois, vu que l'idée de faire fonctionner le FESF à la manière d'une banque qui crée de l'argent à partir de rien, inquiète les Allemands (ou une partie d'entre eux), on enfume le public en parlant d'assurances, ce qui n'a aucun sens dans ce contexte. En effet, on prétend que le FESF "assurerait" à hauteur de 20 % les futurs emprunts publics de la Grèce (ou du Portugal ou de l'Italie) afin d'inciter des investisseurs chinois ou brésiliens à acheter ces titres. Pourquoi diable un fonds souverain de ces pays devrait-il dépenser des milliards d'euros pour acquérir des obligations grecques (ou autres) dont il sait que 20 % seulement sont garantis, alors que les mêmes titres émis un peu plus tôt viennent de perdre 50 % de leur valeur ?... Si les Chinois ou les Brésiliens acceptent d'intervenir, c'est qu'on aura promis de les rembourser à 100 % - à nos frais et sans nous l'avouer.
7 novembre 2011 : Les euro-obligations dont on discute depuis quelque temps, en se demandant s'il faut en émettre ou pas, existent déjà, mais sous un autre nom : il s'agit des emprunts FESF assortis d'une garantie commune des Etats membres. Le premier de ces emprunts, d'un total de 5 milliards d'euros (pas grand-chose compte tenu des besoins) a été placé sur les marchés financiers en février 2011 au taux de 2,75 %. L'emprunt du 7 novembre, de 3 milliards, n'a trouvé preneur qu'au taux de 3,6 % (le double de ce que doit payer l'Allemagne pour ses emprunts d'Etat). L'argumentation des défenseurs des euro-obligations, selon laquelle une garantie commune permettrait à tous les pays de bénéficier des conditions accordées au meilleur, s'effondre donc d'elle-même. La moyenne d'une classe comportant des élèves de force différente, ne pourra jamais être égale à la note du premier.
Le FESF est un véritable flop : "Lorsqu’ils ont créé le FESF, les eurocrates pensaient qu'il serait la panacée pour les maux de l'Europe. Mais au lieu de créer un dispositif simple et limpide, ils ont créé un outil très technique, qu'ils n’ont cessé de complexifier, étape par étape... Le FESF est conçu comme les produits les plus techniques des marchés financiers : sa complexité le rend totalement opaque et décourage les investisseurs..." Noté AAA à sa création, le FESF risque maintenant d'être rétrogradé.
9 novembre 2011 : Conférence de Michel Drac (vidéo - 1 h 34 mn).
L'avenir est bien sombre : "On n'empêchera pas la catastrophe..." Pour Michel Drac, ce qui nous attend sous peu, est beaucoup plus qu'une crise à la 1929, c'est un effondrement. Avec, au bout du compte, une chute dramatique du pouvoir d'achat des populations occidentales à un tiers du niveau actuel. Le tout, bien sûr, accompagné de guerres. Le rôle de la Chine dans tout cela reste encore assez flou, mais il y aura soit une confrontation armée entre ce pays et l'Empire occidental, soit un arrangement...
La thèse de Michel Drac est assez plausible, même si le prétendu "épuisement des ressources" dont il parle, est une diversion par laquelle l'oligarchie masque son agenda. En fait, ce sont les banksters et autres spéculateurs qui génèrent ou attisent la crise alimentaire. Ils manipulent les cours du pétrole et sont à l'origine des mythes du pic pétrolier et du réchauffement climatique dû au CO2.
Les porte-parole des maîtres du monde donnent parfois l'impression de dire n'importe quoi ou de ne pas savoir ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas trop s'y fier. Ce qui paraît drôle a posteriori, peut très bien relever de l'enfumage intentionnel :

Extrait du rapport Attali de 2008 (voir plus haut)
14 novembre 2011 : Tandis que les attaques contre l'Italie se multiplient, les banksters ont déjà la France dans leur collimateur et s'apprêtent à rétrograder sa note. D'ores et déjà, l'Etat français doit payer plus (3,5 %) pour emprunter à dix ans. (Le taux correspondant est de 1,8 % pour l'Allemagne et de 7 % pour l'Italie et l'Espagne).
15 novembre 2011 : Oligarchie mondialiste : Goldman Sachs impose ses valets pour asservir définitivement les peuples européens
○ Mario Draghi, nouveau président de la BCE, a été vice-président de Goldman Sachs pour l'Europe. A ce titre, il a mis sur pied la manipulation comptable des "currency swaps" (voir plus haut - 16 février 2010) laquelle a permis à la Grèce de maquiller une partie de sa dette, et à GS de s'enrichir davantage.
○ Lucas Papadémos, nouveau Premier ministre grec, a été gouverneur de la banque centrale de son pays au moment de l'Opération GS dont il est complice.
○ Petros Christodoulos, gestionnaire de la dette grecque, est un ancien trader de GS.
○ Mario Monti, nouveau Premier ministre italien, a été consultant pour GS.
Et nous n'avons là que la pointe de l'iceberg.
EUROPE, UNION EUROPÉENNE, ZONE EURO :
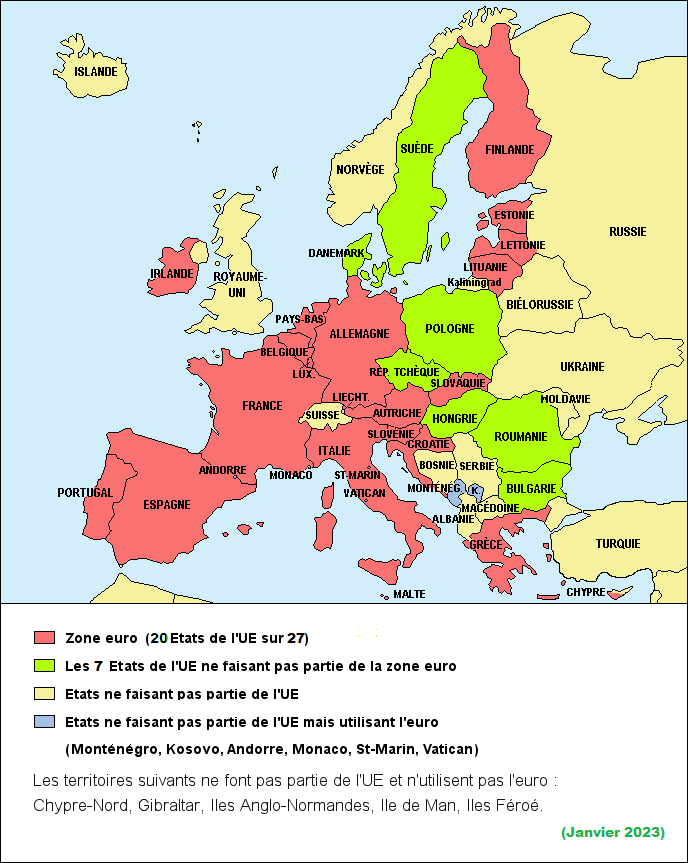
Cette carte existe aussi en version GS :
L'Europe goldman-sachsodomisée
16 novembre 2011 : A peine s'est-on habitué au sigle FESF, que la mafia financière européenne, représentée par Vitor Constâncio, vice-président de la BCE, réclame la mise en place d'un nouveau fonds de "sauvetage" européen, pour les banques cette fois.* Comme le relèvement permanent et illimité du plafond du FESF a du mal à passer, on invente autre chose. Au final, le résultat sera le même, tant pour les pillards que pour les contribuables. Parallèlement, les pressions s'accentuent sur les gouvernements européens pour qu'ils renoncent irrévocablement à leur souveraineté (toute relative) en matière de budget, de fiscalité et d'endettement, et confient ces tâches à une autorité centrale (que l'on pourrait appeler Goldman Sachs Europe).
* C'est une manière comme une autre de nous faire comprendre que le fameux renforcement des fonds propres des banques à 9 % "durs", dont on parle beaucoup ces derniers temps, est déjà dépassé avant d'avoir vu le jour. Cette augmentation elle-même rendait inefficace l'accord Bâle III de septembre 2010, qui prévoyait 4,5 % de fonds propres "durs" (Core Tier 1)... pour 2015 - voir plus haut. Une nouvelle chasse l'autre : ce qui compte, en politique, ce sont moins les actes concrets que les annonces fracassantes.
En attendant, la BCE rachète en grande quantité de la dette italienne, tandis que son nouveau patron, le goldman-sachsophoniste Draghi, raconte à qui veut l'entendre que sa banque rejette ce type d'intervention "afin de ne pas détruire son efficacité". C'est ce que Le Figaro appelle "faire le grand écart" (en français normal, on dit tout simplement : mentir).
Les pontes de la Banque centrale européenne s'indignent quand on les accuse d'actionner la planche à billets. Pourtant, d'après leurs propres statistiques, la quantité totale de monnaie fiduciaire (billets et pièces) mise en circulation par la BCE dans la zone euro s'élève désormais à 866 milliards, contre 740 en 2009 et 600 en 2007 (+ 17 % en deux ans, + 44 % en quatre ans).
17 novembre 2011 : Aux Etats-Unis, le géant General Electric, qui avait obtenu l'aide de l'Etat il y a trois ans (voir plus haut 11 novembre 2008), se porte à merveille et continue de profiter de la générosité publique : en 2010, malgré un bénéfice de 14 milliards de dollars, GE n'a pas payé d'impôts. Le "prix" de cette exonération : une déclaration fiscale de 57.000 pages - détails. Les patrons de General Electric devrait demander une indemnisation pour cette "paperasse" (électronique) aussi coûteuse que superflue.
19 décembre 2011 : Les pays de la zone euro décident de prêter 150 milliards supplémentaires au FMI afin de permettre au Fonds de Mme Lagarde de prêter cet argent à ceux d'entre eux qui en ont besoin - logique...
22 décembre 2011 : La BCE (président : Mario "Goldman Sachs" Draghi) décide de prêter 489 milliards d'euros sur trois ans à plus de 500 banques de la zone euro (à 1 %) afin de permettre à ces banques de placer l'argent (à 6, 7 ou 8 %) en obligations des Etats européens au bord de la faillite - logique... Dans un premier temps, les profits bancaires grimperont, mais dès qu'on s'apercevra qu'il n'est pas si génial que ça pour les banques de rajouter de la dette pourrie à des actifs douteux, il faudra mettre en place un énième plan de "sauvetage"...
Depuis plus de quatre ans, on sait que le problème ne réside pas dans le manque de liquidités bancaires (il y en a au contraire beaucoup trop), mais dans l'utilisation incontrôlée qui est faite de ces liquidités (création permanente de nouvelles bulles). On sait aussi que le fait pour un Etat de prêter aux banques de l'argent qu'il n'a pas, dans le seul but de permettre à ces banques de lui avancer ce même argent à un taux bien supérieur, ne conduit pas du tout à une réduction de l'endettement, qui est paraît-il la priorité numéro un de l'Etat.
Conclusion : pour mieux résoudre ces deux contradictions, il faut absolument les ignorer et continuer comme avant afin que tout change... George Orwell, qui n'était ni banquier ni ministre des Finances, serait bien surpris de voir quelle influence il exerce aujourd'hui sur les décideurs-profiteurs...
Page II (Suite de la chronologie - à partir de 2012)
Renflouement :

Bien sûr, la Bank of America symbolise ici l'ensemble du système bancaire.
(Bailout, un mot que l'on entend cent fois par jour depuis un certain temps, c'est le fait de
se porter caution pour quelqu'un, de le tirer du pétrin - pas sûr que le terme soit bien choisi.)
Le "président" américain
restaure la confiance sur les marchés :

"Pas de panique... C'est juste du papier..."
(Ou comme il disait il y a quelques années :
"Cet argent est à vous, vous avez payé cher pour l'avoir...")
(En matière d'ignorance et d'incompétence, Bush n'est pas un cas isolé. En septembre 2008, Joe Biden, candidat démocrate à la vice-présidence, déclare sur CBS : "Quand la bourse s'est effondrée, en 1929, le président Roosevelt [démocrate lui aussi] est aussitôt intervenu à la télé pour expliquer à ses concitoyens ce qui s'était passé..." Le problème, c'est que Roosevelt n'a été élu que trois ans plus tard, et que la télévision n'existait pas encore en 1929 - si ce n'est au stade purement expérimental, en Allemagne.)


